-
Par Marc81 le 10 Mai 2024 à 11:24
Avez-vous remarqué que, de nos jours, l'adjectif nombreux est employé plus souvent qu'à son tour comme un pronom indéfini ? Les exemples abondent dans la presse :
(en emploi absolu, comme nominal indéterminé ou comme représentant d'un nom précédemment exprimé) « 108 joueurs [sont] venus participer au concours de manille [...]. Nombreux n'ont pas hésité à venir d'assez loin » (journal Le Pays, 2014), « Nombreux estiment que la victoire [de Zapatero] est en partie due aux attaques terroristes » (Les Échos, 2015), « Même si nombreux doutent de son efficacité » (RFI, 2015), « Comment [Messi] est-il devenu celui que nombreux considèrent aujourd'hui comme le "meilleur joueur du monde" ? » (Le Figaro, 2017), « Nombreux envisagent d'assister à une réunion de quartier » (Le Parisien, 2017), « Nombreux voient en cet établissement une bonne table » (La Dépêche, 2018), « Nombreux se demandaient la raison de son absence » (Télé Star, 2021), « [Il] vit ce que nombreux considèrent comme la belle vie » (Télé 7 Jours, 2021), « Nombreux estiment que le sujet mérite mieux » (Europe 1, 2021), « Au PS, nombreux accusent les Insoumis de faire preuve de relativisme » (Le Figaro, 2021), « Nombreux doutent de la fiabilité totale de ces engagements » (Le Monde, 2021), « Nombreux disent se sentir désemparés » (Valeurs actuelles, 2022), « Nombreux dénoncent une éviction » (Ouest-France, 2023), « Nombreux espèrent encore des assouplissements » (France Bleu, 2023), « La pêche est un plaisir que nombreux partagent » (Le Dauphiné libéré, 2023), « Les questions sont les mêmes, alors que nombreux se débrouillent seuls » (France Info, 2023), « Nombreux pensent qu'ils [= les extraterrestres] sont déjà présents sur Terre » (RTL, 2024), « Nombreux dénoncent un texte raciste » (L'Humanité, 2024),
(avec un complément partitif introduit par de ou d'entre, parmi et précisant le groupe auquel il est fait référence) « Nombreux des soldats hospitalisés dans l'établissement scolaire y ont perdu la vie » (La Dépêche, 2013), « Nombreux parmi eux considèrent [le général Mladic] comme leur héros » (site Place publique, 2015), « Nombreux d'entre nous prennent un joli hâle » (Europe 1, 2018), « Nombreux de nos compatriotes se retrouvent dans une situation précaire » (La Dépêche, 2021), « Nombreux d'entre eux ne bénéficient pas des aides auxquelles ils ont droit » (Radio France, 2022), « Nombreux d'entre eux souffrent de stress » (BFM TV, 2022), « Nombreux de mes ancêtres avaient été tisserands » (Ouest-France, 2023), « Les mercenaires se font très discrets, et nombreux d'entre eux étaient exilés au Belarus » (Midi Libre, 2024),
(avec dont partitif) « Les anciens élèves, dont nombreux ont quitté la cité minière » (La Montagne, 2014), « Des protestataires, dont nombreux étaient cagoulés » (AFP, 2016),
et jusque sous des plumes que l'on aurait pu croire plus avisées :
« Ce que vous avez écrit dépasse en abondance matérielle et en diversité l'œuvre de nombreux d'entre nous » (Émile Henriot, académicien, Réponse au discours de réception de Robert Kemp, 1958), « Nombreux d'entre eux [= des dictionnaires] écrivent dessèchement en harmonie avec la prononciation » (à l'article « dessèchement » du TLFi, 1971), « Nombreux parmi nous s'étaient déguisés en bonnets blancs » (Jean-Edern Hallier, La Cause des peuples, 1972), « Nombreux parmi vous ont assisté [à...] » (Jean Peyrard, historien, 1979), « Nombreux parmi vous s'étonnent [que...] » (Gérald Messadié, 2004), « Nombreux passent par moi » (Graham Robert Edwards et Philippe Maupeu, médiévistes traduisant l'ancien français de Guillaume de Deguileville, 2015), « Nombreux découvrent avec stupéfaction ce qu'ils ont voté » (Christian Sorrel, historien, 2020), « Nombreux doutent de la capacité de ces principes à garantir [...] une paix durable » (Laurent Fabius, allocution, 2023), « Nombreux [y] ont vu l'influence de Morny » (Marie-Hélène Baylac, historienne, 2024), « Nombreux estiment qu'il vaudrait mieux une concentration des troupes » (Julie d'Andurain, historienne, 2024).
Il ne vous aura pas échappé que, dans tous ces exemples (à l'exception de celui d'Henriot), nombreux est employé, au masculin pluriel, comme sujet d'une proposition (principale, relative, complétive, etc.) (1). Le mot connaît pourtant la variation en genre et peut occuper d'autres fonctions dans la phrase :
« Nombreux et nombreuses ont essayé depuis » (Ouest-France, 2014), « Nous débarrasser de ce que nombreuses considèrent encore comme des "emmerdes" [il est question des menstrues] » (Christèle Perrot, 2020), « [Les paronymes] sont la cause de nombreuses de nos petites fautes quotidiennes » (Le Figaro, 2021), « Nombreuses d'entre elles [= des collectivités] décident donc d'augmenter cette taxe des ordures ménagères » (RMC, 2022), « Nombreuses et nombreux ont fait le déplacement » (journal La Marseillaise, 2024), « Le coiffage des cheveux fins [est] difficile pour nombreuses d'entre vous » (Femme actuelle, 2024), « La pratique [du fitness] que nombreuses pensent bénéfique » (Elle), « Nombreuses parmi elles [= des maisons d'édition] ont malheureusement cessé leur activité » (Benoît Couzi, éditeur).
« On en rencontre nombreux sur les terrains de sports [il est question de jeunes] » (André Carrel et Claude Lecomte, 1992), « Mélange d'émotion et − pour nombreux − de dévotion » (Olivier Cébe et Philippe Lemonnier, 2015), « Pinterest a vu nombreux de ses concurrents [...] croître plus rapidement » (Les Échos, 2017), « [Telle association] a rassemblé nombreux de ses membres en cette assemblée générale » (Le Républicain lorrain, 2018), « Parce que chacune peut parler à nombreux » (Pauline Machado, 2020), « J'en ai aperçu nombreux s'laisser tenter par l'obscurité » (Eddy de Pretto, 2021), « Hier matin nous étions nombreux de ses amis.es et collègues à accompagner Joel Le Bigot pour ses dernières heures de radio » (Monique Giroux, 2022), « [Avoir envie] de le faire à nombreux » (Wajdi Mouawad, 2022), « Un jeu à faire à nombreux » (Mélanie Fragata, 2023), « Le retrait des dépôts de nombreux de ses clients » (La Tribune, 2023), « L'OM, privé de nombreux de ses cadres » (Le Parisien, 2024), « [Les écrans] se sont invités chez nombreux d'entre vous » (France Bleu, 2024), « Sa vie privée a beaucoup joué sur nombreux de ses titres » (Cosmopolitain, 2024).
Notons enfin que, comme nominal, nombreux ne se dit que des personnes, mais que, comme représentant, il peut aussi se dire des choses : « Nombreux des échantillons [...] allaient à l'encontre des critères de qualité » (La Montagne, 2017), « Nombreux de ces différents types de médicaments sont pris simultanément » (Santé Magazine, 2018), « Un plan de réhabilitation de nombreux de ses établissements scolaires » (Les Échos, 2021), « Nombreux de ses ouvrages sont récompensés » (La Nouvelle République, 2022), en plus de l'exemple du TLFi.
Voilà pour le constat. Reste à comprendre comment on en est arrivé là.
Commençons par observer que nombreux sont les adjectifs quantitatifs susceptibles de pronominalisation (aucun, certains, maints, nul, plusieurs...) :
Plusieurs experts pensent que... → Plusieurs (d'entre eux) pensent que...
Certaines femmes disent que... → Certaines (d'entre elles) disent que..., etc.Mais l'on perçoit vite que le cas de nombreux est différent, puisque l'on ne peut dire sans déterminant (de, les, ces...) : nombreuses personnes pensent que... (2) Qu'à cela ne tienne ! Deux solutions se sont présentées à l'usager désireux de forcer l'analogie.
I/ Maintenir le déterminant (nous nous en tiendrons ici à l'article indéfini de) mais pas le substantif, dans un tour elliptique dont le sens est précisé par le contexte ou qui prend, par défaut, celui indéterminé de « un grand nombre de personnes » :
« Puisqu'à [sic] ce genre de remparts de nombreux ont l'air de tenir [il est question d'architectes] » (Centenaire de l'Académie de Vaucluse, 1901), « De nombreux croient servir la cause catholique » (La Croix, 1922), « De nombreux estiment [que...] » (journal Le Peuple, 1925), « De nombreux ont vu le jour [il est question de comités] » (Bulletin du Secours populaire français, 1965), « De nombreux disent que [...] » (Serge Andolenko, 1967), « De nombreux ont péri [il est question d'artistes] » (Wladimir Berelowitch, 1977), « On se rend compte que de nombreux ont échoué [il est question d'attentats] » (Régis Le Sommier, 2016), « De nombreux attendent les derniers instants pour [il est question de journalistes] » (Le Parisien, 2018), « De nombreux refusent [il est question de cogérants] » (Ouest-France, 2022), « De nombreux ont été fabriqués [il est question de pin's] » (France Bleu, 2024), etc.
Les occurrences avec un complément partitif sont encore plus nombreuses :
« Une lettre, identique à celles que de nombreux de nos compatriotes ont reçues » (journal Le Bonhomme limousin, 1902), « C'est sur elle [= la tentation] que de nombreux de vos collègues [comptent] » (journal Le Cri de Marseille, 1909), « Aniline, Benzène, etc., et de nombreux de leurs dérivés » (Bulletin de la Société chimique de France, 1962), « De nombreux parmi nous ont voulu le faire » (Le Nouvel Obs, 2004), « De nombreux d'entre eux [= des gènes] sont liés directement ou indirectement à une fonction immunitaire » (Pierre Lucien Masson, 2008), « De nombreux parmi vous vont vouloir faire plusieurs choses » (Marc Thouvenin, 2011), « De nombreux d'entre eux sont venus consulter le géomètre » (Charente Libre, 2013), « Parmi les 357 participants, de nombreux ont couru costumé [sic] » (La République du Centre, 2019), « De nombreuses de mes histoires y font référence » (Ouest-France, 2021), « Le néon, qui servira de base à de nombreuses de ses œuvres » (Ouest-France, 2021), « De nombreuses de ses décisions politiques ont été critiquées » (Le JDD, 2023), « Après y avoir passé de nombreuses de leurs vacances » (Libération, 2023), « De nombreuses d'entre elles pointent du doigt les infrastructures sanitaires » (France Inter, 2023), « L'Alliance rurale a perdu de nombreux de ses membres » (Midi Libre, 2024), « Comme de nombreux de ses camarades » (Philippe Chapleau, 2024),
« Quant à ces guerriers [...], ce ne sont pas des clichés folkloriques. J'en ai croisé de nombreux » (Jean-Christophe Rufin, 2009), « Des milliers de partisans, dont de nombreux ont été formés dans ses écoles » (Ouest-France, 2016), « Venir en aide aux sinistrés, dont de nombreux ont passé la journée à faire la queue » (Le Figaro, 2019), « Quant aux normes européennes, j'en ai vu de nombreuses se créer » (Le JDD, 2024).
II/ Supprimer audacieusement le déterminant et traiter nombreux non plus comme un adjectif mais comme un pronom indéfini. Renseignements pris, cette seconde solution (consistant donc à aligner nombreux sur plusieurs, certains...) se révèle plus ancienne que ce que j'avais d'abord imaginé :
« Nombreux se croient dignes de ce titre » (Gilbert Bideaux, L'Équipe, 1950), « Nombreux croient posséder le remède miracle » (Michel Bernard, Introduction à une sociologie des doctrines économiques, 1963), « Nombreux se croient, en effet, investis d'une mission » (Karl Petit, écrivain belge, 1968), etc.
et plus encore quand l'intéressé est en relation avec un complément partitif :
« Nombreux d'entre vous ont pu voir à l'œuvre l'infatigable président » (Rapports du Conseil général de la Vienne, 1864), « La police correctionnelle, connue de nombreux d'entre eux » (Le Journal du Tarn, 1870), « Nombreux d'entre mes vieux amis [...] en viennent à [...] » (journal Le Mémorial diplomatique, 1875), « La troupe Barrow que nombreux de nos lecteurs connaissent déjà » (L'Écho de l'Orne, 1900), « Nombreux de ces cas ont été pris pour des cas avérés de choléra » (Traité d'hygiène, 1906), « Cette année encore nombreux de nos élèves sont partis à la conquête des marchés étrangers » (Armand Megglé, 1928).
Mais voilà que d'autres emplois pronominaux de nombreux, certes moins fréquents, viennent semer le trouble :
« Le fondateur de l'unité allemande, que nombreux de tableaux et gravures populaires associent à M. de Moltke » (journal Le Rappel de l'Aude, 1890), « Nombreux de Ruffecois et d'habitants de la région se rendront à la semaine commerciale d'Angoulême » (journal L'Avenir de la Charente, 1933), « Le journaliste a reçu le soutien de nombreux de confrères » (Le Monde, 2010), « Nombreux de participants ont une grande affection pour les tatouages » (Closer, 2013), « Lauréat de nombreux de prix littéraires » (Le Bon Air latin, 2016), « Sa présence en finale n'a pas été du goût de nombreux de téléspectateurs » (RTL, 2016), « Un homme de 25 ans est soupçonné d'avoir tué sa mère de nombreux de coups de couteau » (Sud Ouest, 2022), « Auteur de nombreux de livres » (France Bleu, 2023).
Contrairement aux précédents exemples avec complément partitif, on ne peut soupçonner ici l'influence de plusieurs (on ne dit pas : plusieurs de tableaux, plusieurs d'habitants, etc.). D'autres modèles doivent être à l'œuvre : on pense évidemment aux adverbes de quantité, en particulier à beaucoup.
Une question me vient à l'esprit : d'autres adjectifs traditionnellement exclus du processus de pronominalisation sont-ils touchés par ce phénomène ? Je ne vois guère que l'antonyme rare, dont les exemples d'emploi analogique sont toutefois nettement moins... nombreux (3) :
« Mais ce que rares savent, c'est que [...] » (Yann Moix, 1996), « Rares d'entre eux ont été élus » (Christian Jacob, interview, 2006), « Rares y pensent comme une destination de prédilection pour le surf » (Louisa Gicquel, 2020), « Rares d'entre nous ont le temps » (Jérôme Llopis, 2022), « Rares d'entre eux expriment leurs avis » (Wafa Naat, thèse, 2022), « [Il] manie l'aérosol et la peinture comme rares savent le faire » (Le Progrès, 2022).
Il doit donc exister un trait propre à l'adjectif nombreux, une particularité qui facilite son extension pronominale. Et tout porte à croire que cette particularité n'est autre que sa paronymie avec le mot nombre. « Ce dernier, on le sait, peut être employé sans déterminant avec une valeur quantitative voisine de nombreux, à condition qu'il soit suivi d'un complément introduit par la préposition de », confirme le linguiste Ambroise Queffélec dans un article sur la grammaticalisation de nombreux comme pronom en français du Congo (2004).
Arrêtons-nous un instant sur ladite locution à valeur adjective : « Nombre de + substantif (+ verbe au pluriel), quantité de, beaucoup de », lit-on dans le TLFi. Voilà qui est bien réducteur. Car enfin, c'est oublier que le substantif (toujours au pluriel) peut être précédé d'un adjectif démonstratif ou possessif : nombre de ces femmes, nombre de mes amis, et la préposition de, remplacée par d'entre (voire par parmi) : nombre d'entre eux, nombre d'entre les vivants, (bon) nombre parmi vous, pour exprimer l'idée partitive. Allez vous étonner, avec pareille proximité phonique, sémantique et syntaxique, que d'aucuns en soient venus à suspecter une confusion entre nombre de et nombreux de !
Plusieurs éléments plaident en faveur de cette thèse :
- les exemples d'invariabilité en genre de nombreux de + substantif féminin :
« Alors que nombreux de personnes avaient fait acte de candidature » (Le Journal catalan, 2015), « [Il] est l'auteur de nombreux de revues » (Mélissa Fletgen, 2020), « Un sentiment de souillure que partagent nombreux de femmes » (Berenice Peñafiel, thèse, 2022), « Nombreux de ces entreprises ont pour principal défaut de [...] » (Guillaume Fonteneau, 2023), « Nombreux d'entre elles [= des familles] se tournent vers le comité » (RFI, 2023),
- la graphie fautive bon nombreux de :
« Le tournoi de pétanque a attiré bon nombreux de joueurs » (Sud Ouest, 2014), « Leur papa qui comme bon nombreux de baixanencs est fier de ses champions » (Midi Libre, 2014), « [L'agriculture industrielle] est défendue par bon nombreux de candidats » (L'Humanité, 2019), « En présence de bon nombreux de spectateurs » (La Provence, 2021), « [Tel mot] fait partie du quotidien de bon nombreux de Français » (La Dépêche, 2021),
- la correction apportée dans Le Monde du 28 mars 1958 à la citation d'Henriot : « L'œuvre de nombre d'entre vous » et, à l'inverse, la faute relevée dans la récente édition, parue chez Le Manuscrit, du Camp de la mort lente de Jean-Jacques Bernard : « C'était le cas de nombreux de mes compagnons » (l'édition originale comporte nombre de) ou encore celle figurant dans la publication par La Dépêche de Brest (1917) du Bâtard de Mauléon d'Alexandre Dumas : « Bon nombreux de leurs compagnons avaient vu des lettres de ce prince » (l'édition originale comporte bon nombre de).
Les choses auraient pu s'arrêter là. Mais il était écrit qu'à force d'hésiter entre la construction avec déterminant (de nombreux pensent...) et celle sans déterminant (nombreux de... pensent...) la langue finirait par accoucher d'un monstre. Jugez-en plutôt :
« Les manifestants, parmi lesquels de nombreux de jeunes » (L'Humanité, 2002), « Elle avait sauvé de nombreux de Chiliens » (Ouest-France, 2013), « De nombreuses de personnes se sont rassemblées » (Le Monde, 2013), « Ces grandes bâtisses où logent de nombreuses de familles » (France Inter, 2015), « De nombreux de Français se laissent tenter par [l'île Maurice] » (Les Échos, 2019), « Comme de nombreux de clubs de la région, nos locaux ont été visités » (France Bleu, 2020), « Comme dans de nombreuses de villes » (Ouest-France, 2021), « De nombreux de Français optent pour les poêles à bois » (France Info, 2022), « De nombreuses de familles y ont participé » (BFM TV, 2023), « 60 000 billets distribués et de nombreux de jeunes déçus par l'opération » (La Voix du Nord, 2023), « C'est dans les villes que de nombreux de grands défis contemporains se manifestent » (La Tribune, 2023), « De nombreux de Français font ce lundi leur retour au travail » (BFM TV, 2023), « De nombreuses de bouteilles sont affichées à prix ultra-attractifs » (Le Parisien, 2024), « Les orchidées ont conquis de nombreux de visiteurs » (La République du Centre, 2024).
De nombreux de + substantif (au pluriel) en lieu et place de de nombreux + substantif (au pluriel) ! Belle illustration de l'expression « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? », ironiseront les mauvaises langues. Et Dieu sait qu'elles sont... nombreuses.
(1) Queffélec en vient à se demander si « la tendance de nombreux pronom à occuper en tant que sujet la position liminaire de la proposition [...] ne dérive pas de l'usage de nombreux adjectif détaché en tête de phrase comme attribut d'un sujet postposé au verbe d'état » : Nombreux sont les cas à envisager. Nombreux semblent ceux qui pensent le contraire.
(2) Force est toutefois de constater que l'emploi sans déterminant commence à se répandre : « [Ce travail est] salué par nombreux anciens élèves de la rue d'Ulm » (site des éditions Rue d'Ulm), « Les chercheurs ont constaté que nombreux gènes ont des profils épigénétiques très différents » (France Info, 2016), « Une annonce qui arrive trop tard, alors que nombreux événements ont déjà annoncé leur annulation » (Public Sénat, 2020), « Ce principe est utilisé par nombreux sportifs » (magazine Pleine Vie, 2021), « Il l'a côtoyé à nombreuses reprises » (Europe 1, 2021), « [Il] laisse entendre que nombreux clients ont déjà été victimes de cette arnaque » (Le Point, 2023), « L'intervention des forces de l'ordre, dénoncée par nombreux étudiants et associations » (RMC, 2024). Négligence ? Méconnaissance de la grammaire ? Ou alignement de nombreux sur plusieurs déterminant indéfini ?
(3) L'emploi de divers comme pronom, autrefois mentionné par l'Académie, est présenté par le TLFi comme « rare » : « [Jésus] avoit apparu douze fois à divers d'entre eux » (Méditations, 1677), « Divers de nos amis ont racheté [...] le peu d'effets que nous possédions » (Jean-Gabriel Peltier, 1799), « Divers de vos amis m'ont parlé de "Paludes" » (Gide, 1895), « Divers pensent que... » (Dictionnaire de l'Académie, 1932), « Vingt-cinq lettres inédites de Mme de Sévigné, adressées à divers » (Émile Gérard-Gailly, 1957).
Les occurrences sont encore plus rares avec différent : « Différents de mes clients ont pour cibles les femmes de plus de 35 ans », « Différents de mes collègues ont gagné des points »...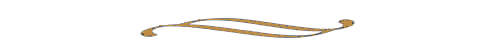
Remarque : Si l'on excepte Queffélec (dont l'étude précédemment citée porte sur le français du Congo), rares sont, à ma connaissance, les spécialistes à évoquer le phénomène de pronominalisation de l'adjectif nombreux. Et quand ils le font, c'est de façon sommaire : « "De nombreux d'entre eux" est une impropriété » (Jean Delisle, La Traduction raisonnée, 2003) ou particulièrement confuse : « Plusieurs et nombreux peuvent être tous les deux adjectifs ou pronoms [...]. Plusieurs peut fonctionner comme pronom, en général comme représentant d'un nom précédemment exprimé, précédé par de [?]. J'ai écrit à tous mes amis, plusieurs m'ont répondu. Il y avait beaucoup de jeunes, de nombreux (beaucoup) pleuraient » (Françoise Bidaud, Nouvelle Grammaire du français pour italophones, 2008).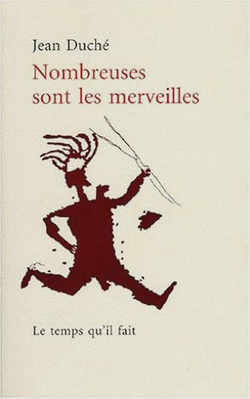
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Marc81 le 24 Mars 2024 à 18:03
À en croire le Dictionnaire historique de la langue française, le verbe discriminer « est un emprunt tardif (1876) au latin discriminare ("séparer, diviser" et "distinguer"), dérivé de discrimen ("ce qui sépare", d'où "ligne de partage, de démarcation", au figuré "différence, distinction" et sur un plan temporel "moment où il s'agit de prendre une décision"), [lui-même dérivé] du supin (discretum) de discernere ». Et l'équipe d'Alain Rey de préciser : « Ce sont les mathématiciens qui ont introduit le mot en français, d'abord sous la forme du participe présent discriminant, peut-être d'après l'anglais discriminant attesté dès 1852. »
Vérification faite, l'influence de l'anglais to discriminate fait moins de doute que celle du discriminant des mathématiciens. Qu'on en juge :« Sacre ! ils ne peuvent jamais discriminer » (exclamation mise dans la bouche d'un Français par Christopher Edward Lefroy dans son roman Outalissi, 1826), « Deux états de choses qu'il sera facile d'apprécier et de discriminer » (Charles Girard, médecin français naturalisé américain, 1860), « [Le journal anglais The Academy trouve que M. Taine] écrit sans discriminer l'époque » (revue Le Livre, 1881), « C'est par un accroissement continu de la faculté de discriminer que l'intelligence humaine s'est élevée » (traduction de l'anglais du philosophe Herbert Spencer, 1895) (1).
Mais il y a plus gênant. Il ne vous aura pas échappé que discriminer, dans ces exemples, s'entend au sens « neutre » (ou, selon les sources, « étymologique », « cognitif », « littéraire ») de « différencier (deux ou plusieurs choses, deux ou plusieurs personnes) d'après des caractères distinctifs ». Partant, pourquoi accueillir un mot nouveau qui « fait double emploi avec distinguer et différencier », qui « n'ajoute rien à discerner, différencier, séparer » ? s'offusquent plus d'un observateur de la langue (respectivement Étienne Le Gal, dans Vous pouvez dire... mais dites mieux, 1935, et André Moufflet, dans Encore le massacre de la langue française, 1935). Par snobisme, par attrait pour les termes savants à coloration philosophico-psychanalytique ? C'est oublier un peu vite que l'intéressé est plus couramment employé avec une idée de traitement inégal, aux sens négatifs de « prendre des mesures économiques (contre un pays, un client...), par exemple en pratiquant la discrimination des prix » et, surtout, de « séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal » :
(contexte économique) « Imposer un tarif différentiel aux produits américains, ce serait se placer sous le coup de la loi qui permet au président d'exclure [...] du territoire des États-Unis les produits des pays qui discrimineront contre l'Amérique » (Le Temps, 1890), « En tolérant que l'Europe discrimine, c'est-à-dire maintienne les restrictions financières et commerciales contre les États-Unis tout en abaissant ces restrictions entre pays membres de l'OECE » (L'Univers économique et social, 1960) ;
(autres contextes) « Ces malades ont comme un sentiment de honte [...]. On sent qu'ils se discriminent » (Charles Féré, in Archives de neurologie, 1889), « Édicter des lois pour discriminer entre les travailleurs, vous n'avez pas ce droit » (Observateur louisianais, 1895), « Ne pas "discriminer" contre les étrangers » (journal Paris-midi, 1922), « On ne tente pas [...] de se faufiler parmi les nôtres pour discriminer contre les radicaux-socialistes » (Albert Milhaud, 1937), « Certains voudraient discriminer les juifs étrangers de "leurs" juifs » (revue Paru, 1949), « Cette attitude conduit à discriminer dans les républiques [soviétiques] tous ceux qui ne sont pas membres de la nationalité titulaire » (Hélène Carrère d'Encausse, 1990), « Discriminer est un acte raciste » (Regards africains, 1999), « "Discriminer", le mot sonne plus fasciste que "sélectionner" » (Frédéric Schiffter, 2014), « C'est une campagne dont les instigateurs n'ont d'autre but que de discriminer, délégitimer, diaboliser [Israël] » (Bernard-Henri Lévy, 2015), « Si la culture émancipe, elle peut aussi classer, discriminer. Publics exclus, éloignés, accès à la culture : les mots le disent » (Erik Orsenna, 2019).
Allez savoir pourquoi, cette connotation péjorative, que tous les dictionnaires reconnaissent au substantif discrimination, est curieusement absente des articles qu'ils consacrent au verbe discriminer. Deux ouvrages de référence font toutefois exception : le Dictionnaire historique de la langue française, qui précise que « [discriminer] revêt, dans l'usage commun, la même valeur négative que discrimination », et le TLFi, qui signale avoir rencontré dans la documentation « un emploi absolu avec nuance péjorative de discriminer » (celui daté de 1960).
Mais venons-en au point le plus délicat : la syntaxe du verbe discriminer. Force est de constater que les spécialistes ne nous aident pas davantage à y voir clair. Prenez la définition du Larousse en ligne : « Verbe transitif. Établir une différence entre des personnes ou des choses en se fondant sur des critères distinctifs. » Vous, je ne sais pas, mais moi, la transitivité, elle ne me saute pas aux yeux, là !
« Les ouvrages de langue deviennent étrangement vagues quand ils traitent de ce verbe [et ne donnent] aucun exemple clair pour attester son utilisation courante », confirme le Québécois André Racicot sur son site Internet (2014). Mieux vaut encore consulter l'usage des auteurs :(Discriminer les X) « [Tels noms] n'étaient pas discriminés par le sens, à l'origine » (Albert Dauzat, 1927), « Commençons par dénombrer et discriminer les problèmes » (Charles Du Bos, 1928), « C'était une autre affaire de discriminer les visiteurs » (Jean Guéhenno, 1952 ; notez l'emploi de discriminer au sens neutre avec un complément d'objet désignant une personne, qualifié de rare par le TLFi), « [Il se demande] de quoi les choses sont faites ; il les discrimine, les spécifie » (René Huygue, 1955), « [Les] hommes dont le métier est justement de discriminer, parmi la foule des manuscrits, ceux qui sont dignes d’être retenus » (Maurice Genevoix, 1960), « Exclure (discriminer, ségréguer) tous les Juifs [sous le régime de Vichy] » (Pierre-André Taguieff, 2014), « C'est pour ça qu'on discrimine les musulmans ! » (Marc Weitzmann, 2018).
(Discriminer les X et les Y) « [Il a] judicieusement discriminé les créatures et les écrivains du second ou troisième rayon » (Émile Henriot, 1953), « Discriminer rhumatismes infectieux et arthrites microbiennes » (Ravault et Vignon, 1956).
(Discriminer les X des Y) « [L'homme] apprendra à discriminer les uns des autres » (Georges Matisse, 1938, parlant des animaux dangereux et de ceux qui ne le sont pas), « Discriminer le vrai du faux » (Raymond Aron, 1966), « [L'enfant] n'avait aucune possibilité de discriminer le bien et le mal de l'agréable et du désagréable » (Françoise Dolto, 1985), « Une règle servant à discriminer les Noirs des Blancs dans les autobus des états du sud des États-Unis » (David El Kenz, 2020).
(Discriminer les X d'avec les Y) « Discriminer les mots corrects d'avec les mots déformés » (Revue neurologique, 1964), « Discriminer le sensible d'avec l'intelligence » (Catherine Salles, 2009).
(Emploi absolu) « Quand la vie nous laissera-t-elle le temps de nuancer et de discriminer ? » (Charles Du Bos, 1927), « Tchang-Tzev l'eût loué d'avoir passé "de l'intelligence qui discrimine" (et nul ne discriminait mieux que lui) à "l'intelligence qui englobe" » (Marguerite Yourcenar, 1981), « Je sais discriminer entre les qualités de silences, chez mes persécuteurs téléphoniques » (Guy Hocquenghem, 1987), « Ils veulent discriminer, exclure en fonction des origines, de la race et des nationalités » (Jules Gheude, 2013, citant l'homme politique belge Marino Keulen).
On le voit, discriminer a hérité de la syntaxe du verbe distinguer (2)... à une exception près : discriminer contre, calque de l'anglais to discriminate against, où la préposition vient lever toute ambiguïté sur le caractère, forcément défavorable, du traitement infligé à autrui. Cette construction, surtout en usage chez nos cousins québécois, peine à s'imposer de ce côté-ci de l'Atlantique, en dehors de certains domaines spécialisés (économie, droit, sociologie, etc.) (3). D'aucuns soupçonnent une discrimination à l'embauche, dans la langue courante...
(1) Et aussi : « Ce qui discrimine d'autant la gastrostomie » (Louis-Henri Petit, 1879), « Tout procédé qui oblige le sujet à être attentif à un certain groupe d'impressions augmente son aisance à discriminer entre elles avec finesse et précision les impressions de ce groupe » (Léon Marillier, in L'Année biologique, 1897).
(2) « Distinguer, précise Girodet, peut se construire avec de ou avec d'avec : Distinguer la grenouille du crapaud. Distinguer la couleuvre d'avec la vipère. La construction avec de est plus légère. Elle est préférable à la construction avec d'avec, sauf quand il peut y avoir équivoque ou quand les deux termes sont séparés par plusieurs mots ou surtout quand il importe d'éviter une succession de mots précédés de la préposition de [...]. La construction avec et est à déconseiller, car elle donne lieu à des équivoques : Dans les vertébrés inférieurs, il faut distinguer les batraciens et les reptiles. Cette phrase peut signifier ou bien "il faut distinguer les batraciens d'avec les reptiles" ou bien "il faut mettre à part des autres vertébrés inférieurs les batraciens et les reptiles". La construction avec entre implique, en général, une nuance particulière. La distinction ne porte pas seulement sur la nature des personnes ou des choses considérées, mais aussi sur la manière dont on les traite. Comparer : Un juge capable doit savoir distinguer l'innocent du coupable (= discerner celui qui est innocent et celui qui est coupable) et Un juge intègre ne doit pas distinguer entre les riches et les pauvres (= traiter différemment). »
(3) « Discriminer contre les Noirs » (Pierre Mutignon, juriste français, 1968), « Éviter qu'une majorité ne discrimine contre une minorité » (Pierre Lemieux, économiste canadien, 1987), « Discriminer contre les femmes » (Marie Gratton, théologienne québécoise, 1991), « Autoris[er] les autres pays à discriminer contre les importations en provenance du pays à monnaie rare » (Michel Herland, économiste français, 1991), « Ces portes [à fermeture hydraulique] discriminent contre les personnes très faibles » (Bruno Latour, sociologue français, 1996), « Ne pas discriminer contre un employé ou un candidat à l'embauche » (Georges de Ménil, économiste français, 2007).
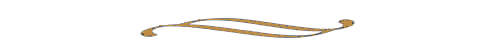
Remarque 1 : Il convient de noter que discriminer s'écrit avec trois i (la graphie fautive discréminer peut s'expliquer par l'attraction de discret) et n'est pas l'antonyme de incriminer : « Se garder comme de la peste d'employer discriminer dans le sens de disculper » (journal L'Œuvre, 1940).
Remarque 2 : Voir également l'article Discrimination.
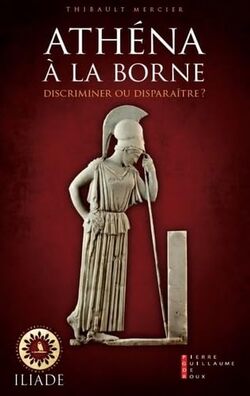
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Marc81 le 14 Décembre 2023 à 13:40
Il n'aura échappé à personne, et surtout pas aux auteurs de comédies, que le rejet du pronom je après certains verbes à l'indicatif présent prête facilement aux jeux de mots et aux effets comiques :
« Miserable que je suis, ou cours-je ? à qui le dis-je ? » (Pierre de Larivey, 1579), « Je sers ; mais à quoi sers-je ? » (Paul-Louis Courier, 1820), « Qu'entends-je ? qu'ouïs-je ? » (Michel Delaporte, 1845), « Que ne vous assom'je, Mère Ubu ! » (Alfred Jarry, 1896), « — Pourquoi, m'étonne-je et tonne-je, envoyer [...] ? » (Luc Lang, 2003), « Le jeune prof fait rire les adolescents chaque fois qu'il se lance dans une de ses tirades pédagogiques préférées : — Que veux-je ? Vers où cours-je ? Vers quoi tends-je ? » (Josette Carpentier, 2015).
C'est pourquoi il est d'usage de remplacer par un é euphonique (1) la voyelle finale de la forme conjuguée, quand celle-ci est un e muet : « Parlé-je ? [et, à l'imparfait du subjonctif,] puissé-je ? eussé-je ? dussé-je ? fussé-je ? » (Grevisse), ou, quand la forme verbale se termine par une syllabe sourde (en, on, ou...), une consonne liquide ou les sons [j], [ch] rendant la prononciation difficile ou équivoque, de tourner la phrase autrement :
« À la première personne du singulier de l'indicatif présent, l'inversion du sujet je, pronom atone, produit des locutions que l'usage n'admet pas en général, surtout quand il s'agit de monosyllabes. Ainsi on ne dira pas : Cours-je ? Prends-je ? Sors-je ? Romps-je ? Mens-je ? Pars-je ? etc. On élude ces formes en recourant à la périphrase est-ce que : Est-ce que je cours ? Est-ce que je prends ? etc., ou à quelque autre tour : Croyez-vous que je prenne ? Me voit-on courir ? etc. Toutefois l'usage admet l'inversion de je après quelques verbes très usités : Ai-je ? Dis-je ? Dois-je ? Fais-je ? Puis-je ? Suis-je ? Vais-je ? Vois-je ? etc. » (Grevisse).
« Il n'est pas d'usage de dire, interrogativement : ris-je ? dors-je ? cours-je ? etc. Il faut employer le tour est-ce que je ris ? est-ce que je dors ? etc. Cela est valable pour les verbes dont la première personne du singulier est monosyllabique et se termine par plusieurs consonnes. (On dit bien : qu'entends-je ? que réponds-je ?, mais non rends-je ? prends-je ?) Il en est de même pour les verbes dont la première personne du singulier se termine par -ge : est-ce que je songe ? » (Thomas).
« L'inversion de je dans l'interrogation directe [...] ne peut se produire avec certains verbes en raison des risques de calembours involontaires ou de cacophonies, tels que cours-je ? mens-je ? etc. » (Jean-Paul Colin).
« Au présent de l'indicatif, l'inversion du sujet je est de rigueur avec les formes verbales monosyllabiques suivantes : ai, dis, dois, fais, puis, sais, suis, vais, veux, vois. L'inversion n'est en revanche pas possible avec les autres formes monosyllabiques (dans une interrogation directe, on pourra avoir recours à la forme est-ce que). Si le verbe se termine par un e, il convient de changer ce e final, habituellement muet, en é (que l'on prononce è) : pensé-je, ajouté-je, dussé-je. Depuis les rectifications de l'orthographe de 1990, la graphie avec accent grave est également admise : aimè-je, puissè-je, trompè-je » (site Internet de l'Académie).
Seulement voilà : le é (ou è) euphonique s'est étendu − « par confusion ou par commodité », écrit René Georgin − aux formes conjuguées qui n'avaient pas de e final. Pour preuve ces (nombreux) exemples trouvés jusque chez de bons auteurs :
(accomplir) « Accomplissé-je un acte selon lequel [...] ? » (Natalie Depraz et Pol Vandevelde, 1998), à côté de « Aussi accomplis-je ma marche » (Jules Gourdault, 1895),
(agir) « Aussi agissé-je en tout avec la plus grande circonspection » (Jean-Augustin Amar du Rivier, 1831), « En quoi agissé-je à l'image du Christ [...] ? » (Hubert Aupetit, 2023), à côté de « N'agis-je pas conformément à mon état [...] ? » (Armand Boisbeleau de La Chapelle, 1725),
(aller) « Qu'allé-je faire, hélas ! » (Nicolas-François Guillard, 1788), « Par quelle force inconnue, Allé-je infiniment mieux ? » (Verlaine, 1894), à côté de « Que vais-je rapporter à ma femme ? » (Jules Renard, 1897),
(apercevoir) « Quel terme y apercevé-je ? » (Jean-François Bareille, 1879), « Du moins ne m'en apercevè-je pas » (Jean-Pierre Cléro, 2000), à côté de « Mais qu'aperçois-je ? » (Voltaire, 1763),
(attendre) « Qu'attendé-je [...] ? » (Robert Garnier, 1573), « Qu'attendé-je pour sortir ? » (Charles Le Quintrec, 1996), à côté de « Aussi attends je d'elle le semblable » (Charles IX, 1569),
(boire) « Ainsi mangé-je et buvé-je par procuration » (Albert Bensoussan, 1996), à côté de « Mais que bois-je ? » (Eugène Scribe, 1829),
(combattre) « Ne combatté-je pas aussi pour une sainte cause ? » (Eugène des Essarts, 1838), à côté de « Et qui combats-je ici ? » (Claude-Prosper Jolyot de Crébillon, 1734),
(concevoir) « Encore concevé-je [que...] » (Jacques Saurin, avant 1730), à côté de « Que conçois-je quand je pense à vous ? » (Nicolas Malebranche, 1683),
(conclure) « Donc, conclué-je, [...] » (Joseph-Adrien Lelarge de Lignac, 1760), à côté de « Aussi conclus-je que [...] » (Adolphe d'Avril, 1886),
(confondre) « Sans doute confondé-je [...] ces circonstances » (Philippe Jaccottet, 1994), à côté de « Ne confonds-je point des choses distinctes [...] ? » (Robert Arnauld d'Andilly, 1649),
(connaître) « Combien en cognoissé-je à qui tout est de mise [...] ? » (Mathurin Régnier, avant 1613), « Connaissé-je le catholicisme ? » (René Bazin, 1921), « Qui connaissé-je dans ce service ? » (Frédéric Hoffet, 1954), « Et encore ne me connaissé-je que sur le moment » (Robert Pinget, 1993), à côté de « Aussi connais-je bien mon monde » (Jean-Baptiste Gresset, 1747),
(coudre) « Ai-je cousu, cousé-je, coudrai-je dans du cuir ? » (Colette, 1949), à côté de « Mais que couds-je ? » (Louis Mermaz, 1969),
(courir) « Parcouré-je avec vous ces bords où [...] ? » (Anne-François-Joachim Fréville, 1810), « Où couré-je, haletant ? » (Joseph Gaucet, 1842), à côté de « Ne cours-je pas le risque de [...] ? » (Philippe Schneider, 2017),
(craindre) « Encore craigné-je que [...] » (Maximilien de Béthune, 1606), à côté de « Que crains-je donc ? » (Chateaubriand, 1836),
(croire) « Aussi ne croyé-je pas aux mères qui [...] » (Balzac, 1841), « Peut-être me croyé-je en bien meilleure santé » (André Daniel Tolédano, 1965), « Du moins le croyé-je » (Charles Morazé, avant 2003), à côté de « Que crois-je entendre ? » (Boris Vian, 1950),
(dire) « La pluie, que disè-je, la grêle » (Revue des Basses-Pyrénées et des Landes, 1885), à côté de « C'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ?... C'est une péninsule ! » (Edmond Rostand, 1898),
(dormir) « — Veillé-je, ou dormé-je disait-il » (Mlle Motte, 1775), « Dormé-je ? Non, je ne dormais pas » (Antonin Artaud, avant 1948), à côté de « Veillay-je, ou dors-je ? » (Jean Loret, 1651),
(écrire) « Et encore presentement ne vous escrivé-je rien de particulier » (Henri IV, 1602), « Pourquoi écrivé-je toujours de la même manière [...] ? » (François Guizot, 1862), « Il est des "négligences souveraines", écrivè-je » (Bernard Grasset, 1954), « Aussi écrivé-je un roman aérien » (Queneau, 1968), « — [...], écrivé-je à Kennedy » (De Gaulle, avant 1970), à côté de « Pourquoi écris-je cela ? » (Éric-Emmanuel Schmitt, 2011),
(s'enquérir) « — Quelle concurrence ? m'enquéré-je » (Alain Clouet, 1970), à côté de « — Il était coiffeur de profession ? m'enquiers-je » (Yasmina Khadra, 1997),
(entendre) « Quel tumulte entendé-je entre vous ? » (Robert Garnier, 1573), « Mais qu'entendé-je icy ? » (Christophe de Gamon, 1609), « Encore entendé-je tous les jours [...] » (Jean-Baptiste-Antoine Suard, 1806), à côté de « Qu'entends-je ? » (Voltaire, 1718),
(interrompre) « Aussi interrompé-je mon travail » (Henri de Régnier, 1928), « — Et qui en vaillent la peine, interrompé-je » (Henry de Monfreid, 1933), à côté de « — Comment ! l'interromps-je » (Gustave Broussais, 1885),
(lire) « — N'est-ce pas bien étrange, lisé-je dans une lettre [...] ? » (Louis Edmond Duranty, 1876), « Que vois-je !... Que lisé-je ! » (Georges Chauvin, 1877), à côté de « Que lis-je, page 39 ? » (René Étiemble, 1988),
(mettre) « À quelles épreuves metté-je par ce récit votre sensibilité [...] ? » (Mlle de Morville, 1773), « Aussi metté-je toujours quelques chiffons rouges dans ma parure » (Balzac, 1831), « Aussi ne me permetté-je à son égard qu'une simple supposition » (Julie Delafaye-Bréhier, 1844), « Que diable prometté-je ainsi ? » (Henri Vernoy de Saint-Georges, 1863), à côté de « Aussi la mets-je à fort haut prix » (Philippe Néricault Destouches, 1737), « Aussi [...] me promets-je de le recevoir au mieux » (Élie Berthet, 1866), « — On peut dire aussi, me permets-je d'ajouter [que...] » (Gide, 1904),
(perdre) « Mais encore ne les perdé-je pas » (Nicolas de Montreux, 1594), « Si ne perdé-je pas pourtant le souvenir » (Jean Godard, 1624), « Que ne perdé-je point ! » (Mme de Grignan, Correspondance, 1696 ; certaines éditions donnent la graphie perdai-je), « Perdé-je la tête ? » (Henry de Farcy de Malnoë, 1899), à côté de « Que n'en pers-je ainsi la souvenance » (Mellin de Saint-Gelais, avant 1558), « Perds-je la tête ? » (Edmond Rostand, 1917),
(plaire) « Ô Jupiter, vraiment, vous plaisé-je ? » (Giraudoux, 1929), à côté de « Aussi me plais-je très peu dans l'accomplissement d'un devoir si violent » (Louis Veuillot, 1867),
(poursuivre) « — Je ne suis qu'un pauvre être comme vous, poursuivé-je » (Pierre Nothomb, 1922), à côté de « Aussi bien ne poursuis-je d'autre but [que...] » (Michel del Castillo, 1966),
(pouvoir) « Pouvé-je penser à celui qui [...] ? » (P.-A. Michel, 1854), à côté de « Qu'en peux-je mais, quoy ce soit ? » (Jean Godard, 1594), « Puis-je vous déposer quelque part en passant ? » (Blaise Cendrars, 1948) (2),
(prendre) « Aussi comprené-je à merveille que [...] » (Julien Munier-Jolain, 1890), « Aussi prené-je délibérément la parole » (Natalie Depraz, 2014), à côté de « Où pren-je mon espoir ? » (Olivier de Magny, 1557), « Aussi comprends-je les télégrammes de Pierre Louÿs » (Henri de Régnier, 1894),
(prétendre) « Aussi ne prétendé-je point en faire la matière d'une discussion » (Pierre Nicolas Anot, 1821), « Ne prétendé-je point être écrivain ? » (André Brincourt, 1957), à côté de « Mais de quoi m'entretiens-je ? et que prétens-je faire ? » (Antoine Houdar de La Motte, 1723),
(punir) « Ne la punissé-je pas assez ? » (Louis Edmond Duranty, 1873), à côté de « Ne les punis-je pas assez [...] ? » (Claude Jordan, 1709),
(recevoir) « Quel prix recevé-je de toi ? » (Charles Potvin, 1846), à côté de « Aussi reçois-je en ce sens tout ce que vous me dites » (Honoré d'Urfé, 1607),
(rendre) « Ne rendé-je pas témoignage pour la douleur même [...] ? » (Étienne Souriau, 1956), « Me rendé-je bien compte de ce que cela signifie...? » (Pierre Ancenis, 1967), à côté de « Rends-je bien mes eaux ? » (Mme de Sévigné, 1676), « Aussi lui rends-je quelques services » (Frédéric Dard, 1951),
(répondre) « — Il est vrai, répondé-je d'une voix altérée par les sanglots » (Fanny Raoul, 1813), « — Je n'en doute pas, Jacques, répondé-je en souriant » (Henry de Monfreid, 1933), à côté de « — Rassurez-vous, réponds-je en souriant » (Rousseau, 1762),
(rire) « Regardez-moi : rié-je vraiment ? » (Véra Volmane, 1964), à côté de « Et pourquoi ris-je ? » (Jean Cau, 1963),
(rugir) « — En va-t-il ainsi ? rugissé-je » (Jacques Chastenet, 1961), à côté de « — Si, je peux quelque chose, rugis-je » (Gary Victor, 1998),
(saisir) « Me saisissé-je, causa mei [...] ? » (Georges Poulet, 1971), à côté de « Peut-être ne saisis-je point toute la majesté des tragiques » (Auguste Germain, 1892),
(sentir) « Aussi ne me senté-je avoir que bien petite part en leurs graces » (Robert Garnier, 1582), « De quelles passions me senté-je esmouvoir ? » (Mathurin Régnier, avant 1613), « Quel rude poil senté-je à ce menton » (Alexandre Hardy, 1623), « Aussi senté-je fréquemment le désespoir de l'impuissance » (Charles de Villers, 1803), « Pourquoi ressenté-je cette sensation de froid ? » (M. Maryan, 1877), « Senté-je plus qu'un autre [...] Tout ce qu'un petit pied peut avoir de charmant ? » (Jacques Normand, 1882), « Ainsi me senté-je et me trouvé-je » (Michel Rachline, 1965), « Aussi ne me senté-je nullement responsable » (Barbara Buick, 1971), « Me senté-je à l'intérieur de ce qui m'est extérieur ? » (Augustin Jeanneau, 1975), à côté de « Et comment sens-je si bien ce que je ne puis t'exprimer ! » (Montesquieu, 1721), « Déjà ne ressens-je pas plus de plaisir à [...] » (Colette, 1922),
(servir) « Dans un pacte infernal te servé-je d'otage ? » (Henry Marcel, 1886), à côté de « Comment sers-je Jésus-Christ [...] ? » (Jean-Baptiste Lasausse, 1819),
(sortir) « Mais d'où donc sorté-je ? » (Queneau, 1937), à côté de « Aussi ne sors-je presque pas, si j'ose m'exprimer ainsi » (Lucien Aressy, 1923),
(souvenir) « Peut-être me souvené-je de son Gringoire ? » (Philippe Andrès, 1993), à côté de « Aussi me souviens-je [que...] » (Charles Sorel, 1630),
(tendre) « Quels pièges me tendé-je tout seul [...] ? » (Pierre Fayard et Éric Blondeau, 2014), à côté de « Aussi, ne tends-je point à l'Académie, mais à un siège directorial » (François Signerin, 1921),
(tenir) « De qui, de quoi tené-je une conscience si dure [...] ? » (Pierre Guyotat, 2018), à côté de « De combien de nos Samson modernes ne tiens-je pas la chevelure sous le ciseau ! » (Pierre Choderlos de Laclos, 1782),
(valoir) « Ne valé-je pas cet effort ? » (Jules de Glouvet, 1883), à côté de « Ne vaux-je pas mieux que toi ? » (Restif de la Bretonne, 1776),
(vendre) « Aussi vendé-je une grande quantité de ces instruments » (Charles Desprez, 1858), à côté de « A qui vends-je mes coquilles ? » (Fleury de Bellingen, 1656),
(venir) « Ne vené-je pas de commander une nouvelle bibliothèque [...] ? » (Agnès Siegfried, 1932), à côté de « Ne viens-je pas de voir son pere [...] ? » (Corneille, 1645),
(vivre) « Pourquoi vivé-je encor ? » (Évariste Boulay-Paty, 1844), « Cornecul, pourquoi survivé-je ? » (Pierre Desproges, 1985), à côté de « Mais comment vis-je ? » (La Fontaine, 1657), « Pourquoi survis-je à tant de honte et de remords ? » (Mme Roland, 1800),
(voir) « Le voyé-je mieux ? » (Giraudoux, 1920), à côté de « Aussi ne vois-je pas la fin de cet état honorable qui appauvrit et abêtit l'Europe » (Anatole France, 1897),
(vouloir) « Depuis combien de jours voulé-je te devancer ! » (Henri Ghéon, 1899), « Que voulé-je faire d'elle ? » (Giraudoux, 1931), « Où voulé-je en venir ? » (François Nourissier, 2000), à côté de « Aussi veux-je bien [...] » (Malherbe, vers 1590). (3)
Ces formes analogiques, pourtant attestées depuis au moins la seconde moitié du XVIe siècle, « sont considérées comme des barbarismes », lit-on à l'article « je » du TLFi. C'est oublier un peu vite que la position des grammairiens sur ce sujet a longtemps été très confuse. Jugez-en plutôt :
« Il y a des verbes qui, prononcez selon les vrayes reigles, sont fort rudes et font des equivoques comme cours-je, qui se rapporte à courge ; vends-je, qui sonne comme venge de venger. Et toutefois il est mieux d'observer la netteté du langage, ou de se servir plustost de circonlocutions [que d'écrire couré-je, vendé-je] » (Antoine Oudin, Grammaire françoise, 1632).
« Plusieurs disent menté-je pour dire ments-je, perdé-je pour dire perds-je, rompé-je pour dire romps-je. Nous n'avons pas un seul autheur ny en prose, ny en vers, je dis des plus mediocres, qui ayt jamais escrit menté-je, ny perdé-je, ny rien de semblable » (Vaugelas, Remarques sur la langue françoise, 1647 ; le grammairien pouvait-il ignorer les œuvres de Robert Garnier ?).
« J'ay changé d'avis, particulierement à l'égard de quelques-uns de ces mots, qui sont si rudes de la façon que les Provinciaux les disent qu'on a peine à les prononcer, comme romps-je, ments-je, et qui d'ailleurs sont equivoques, car romps-je et ments-je se prononcent comme ronge et mange ; et presentement j'aimerois mieux dire [à la Parisienne] rompé-je et menté-je [...]. Mais pour ces autres mots sens-je, perds-je, etc. qui ne sont pas si difficiles à prononcer, et qui ne sont point d'équivoque [...], je ne puis encore blâmer ceux qui s'en servent » (Gilles Ménage, Observations sur les Poësies de Malherbe, 1666).
« On ne dit pas senté-je, perdé-je, entendé-je, etc. [pour sens-je, pers-je, entens-je ? Mais] on peut inserer é, dans certains mots qui sont trop rudes autrement, et qui d'ailleurs sont équivoques, comme rompé-je, menté-je, servé-je, dormé-je » (Jean d'Aisy, Le Génie de la langue française, 1685).
« Pour ments-je, perds-je, romps-je, sents-je, dors-je, ceux qui parlent bien ne les peuvent souffrir, non plus que menté-je, perdé-je, rompé-je, senté-je, dormé-je, qui sont tous formez contre les regles de la grammaire, ils veulent que l'on prenne un autre tour » (Thomas Corneille, Notes sur les Remarques de Vaugelas, 1687).
« [On ne dit pas :] pourquoi ne sens-je pas. On dit : pourquoi ne senté-je pas » (Dominique Bouhours, Critique de l'Imitation de Jésus-Christ, 1688).
« Je ne suis point de l'avis de la Remarque, et l'usage est au contraire, si en joüant à la boule vous demandiez le perds-je on ne vous entendroit pas » (Olivier Patru, Remarques sur les Remarques de Vaugelas, édition posthume de 1692).
« Perdé-je mon argent n'est point du bel usage » (Edme Boursault, Lettre à Esprit Fléchier, 1697).
« Le sens-je me dévorer de M. Malherbe n'a point plû, il est grammatical mais dur à l'oreille et plusieurs [académiciens] ont dit que s'il falloit choisir necessairement entre ments-je, perds-je, romps-je, dors-je et menté-je, perdé-je, rompé-je et dormé-je, ils diroient plustost le dernier contre la regle, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent ainsi. Cependant le plus seur est de chercher un autre tour » (Observations de l'Académie françoise sur les Remarques de Vaugelas, 1704).
« Il ne faut pas dire sens-je, dors-je, romps-je, parois-je ; mais senté-je, dormé-je, rompé-je, paroissé-je. Et même ceux qui ont de la délicatesse pour la langue condamnent aussi ces façons de parler. Il vaut mieux se servir d'un autre tour, et dire est-ce que je sens, etc. » (Pierre-Charles Berthelin, Abrégé du Dictionnaire universel françois et latin, 1762).
« Si je, après le verbe, fait un son dur, ou équivoque, l'usage le condamne : il ne faut point dire cours-je, perds-je, mens-je, dors-je, sors-je, ni courré-je [sic], perdé-je, menté-je, dormé-je, sorté-je ; mais il faut prendre un autre tour, et dire : est-ce que je cours, est-ce que je perds ? » (Féraud, Dictionnaire critique, 1788).
« Ne dites pas dormé-je ? mouré-je ? c'est des barbarismes » (André Bonté, Grammaire françoise, 1788).
« Je crois que cette expression ne sens-je ne serait plus admise aujourd'hui, et qu'il faut dire : Ne senté-je pas » (Jean Edme Serreau et François-Narcisse Boussi, La Grammaire ramenée à ses principes naturels, 1824).
« Ne dites pas : sens-je, dusse-je, dors-je, etc., mais : senté-je, dussé-je, dormé-je » (Les Omnibus du langage, édition de 1833).
« On dit : sens-je, qui se trouve dans quelques auteurs, ou est-ce que je sens. Senté-je est un grossier barbarisme [même remarque à propos de lisé-je] » (Littré, Dictionnaire, 1863).
« Ne dites pas : sens-je, dors-je ? mais senté-je, dormé-je ? [ou mieux] est-ce que je dors ? » (Raoul Rinfret, Dictionnaire de nos fautes contre la langue française, Montréal, 1896).
Et si, depuis le XXe siècle, la position de Vaugelas et de Littré semble l'avoir emporté chez les spécialistes de la langue :
« Les barbarismes tels que : sentè-je, perdè-je, que certains grammairiens n'eussent pas répugné à substituer à sens-je, etc., n'ont pu s'introduire [!] » (Ferdinand Brunot, La Pensée et la langue, 1922),
« De nos jours, cette formation [analogique en -é-je] est exclue de la langue littéraire [!] » (Jacques Damourette et Édouard Pichon, Des mots à la pensée, 1935),
« Ce pis-aller [= le é euphonique] a fait commettre plus d'un barbarisme » (les Le Bidois, Syntaxe du français moderne, 1935),
« À la forme interrogative, la première personne du singulier de l'indicatif présent est : Sens-je ? ou Est-ce que je sens ? Il faut se garder de dire : Senté-je ? » (Hanse, Dictionnaire des difficultés grammaticales et lexicologiques, 1949),
« Malgré l'autorité de leurs auteurs, ces emplois [analogiques] peuvent être considérés comme barbares » (Dupré, 1972),
« Certains auteurs ont commis des barbarismes [suivent deux citations de Giraudoux] » (Jean-Paul Colin, 1994),
« [Les tours interrogatifs avec inversion du pronom je] frôl[e]nt la dérision [avec des verbes autres que être, avoir, aller... ou sont] déviants : *Cours-je ?/ ? ?Couré-je ?, *Pars-je ?/ ? ?Parté-je ?, *Sors-je ?/ ? ?Sorté-je ? » (Marc Wilmet, Grammaire critique du français, 1997),
« Ce qui était une rareté considérée comme un barbarisme à l'époque classique [!] ne l'est pas moins de nos jours (cf. perdé-je ? dormé-je ? voulé-je ?) » (Hervé-Dominique Béchade, Syntaxe du français moderne et contemporain, 1986),
« Non sans raison, on considère comme un "barbarisme littéraire" la solution consistant à modeler les verbes irréguliers sur les verbes en -er » (Goosse, Le Bon Usage, 2011),
quelques voix discordantes se font encore entendre :
« Ne pensez-vous pas qu'il eût été plus euphonique [...] d'écrire "Aussi attendé-je" que de sortir ce fort incongru "Aussi attends-je" [...] ? » (lettre du journaliste français Julien Buat à l'écrivain québécois Victor Barbeau, vers 1920).
« Il est bien sûr qu'on ne dira pas, sans rire : Cours-je ? Prends-je ? Sors-je ? Pars-je ? Cependant reste, en l'occurrence, possible, rappelons-le, la postposition du sujet, en gratifiant le verbe de la désinence vocalique é [...]. Ainsi peut-on dire couré-je ? prené-je ? sorté-je ? parté-je ? » (Jean Tribouillard, Défense de la langue française, 1996).
« [Dans certains cas,] la réalisation est incertaine : rendé-je ou rends-je ?, cours-je ou couré-je ? » (Pierre Le Goffic, Préalables morphologiques à l'étude du verbe français, 1998).
« Je finis, finissé-je (forme interrogative) » (à l'article « finir » de la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie, 2000).
C'est dire si tout cela est affaire d'oreille et d'époque... Mais arrêtons-nous un instant sur ce finissé-je de curieuse facture, qui ne laisse pas de surprendre sous les ors de l'Académie. Car enfin, la forme finis-je attendue est-elle à ce point ridicule − comme l'affirme Albert Dauzat dans Phonétique et grammaire historique de la langue française (1950) − ou imprononçable qu'elle n'ait pas droit de cité ? On la trouve pourtant sous quelques bonnes plumes : « Que ne finis-je alors mes jours dans ces flots irritez [...] ? » (Gilbert Saulnier Du Verdier, 1632), « — Ah ! ça, finis-je par lui dire impatienté » (Zola, 1880), « — Qu'avez-vous ? finis-je par lui demander » (Pierre Benoit, 1936), « Comment et pourquoi finis-je par me laisser prendre au piège ? » (Yves Gandon, 1968) et dans les tableaux de conjugaisons interrogatives de plusieurs grammaires : Grammaire françoise (1750) de Claude Roger, Abrégé de la grammaire française (1803) de Pierre-Claude-Victor Boiste, Nouvelle Grammaire française (1823) de François Noël et de Charles-Pierre Chapsal, Grammaire générale (1838) de Napoléon Caillot, Grammaire nationale (édition de 1841) de Louis-Nicolas Bescherelle, La Grammaire française pour les Nuls (2011) de Marie-Dominique Porée. Plus généralement, le rejet du pronom je après un verbe du deuxième groupe « [est possible] quand la forme n'est pas monosyllabique » selon Girodet, « [est à] évite[r] » selon les Le Bidois et René Georgin (4), « semble exclue » selon le TLFi, « n'est pas admise par l'usage : *Finis-je ? » selon Goosse. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'unanimité dans toute cette affaire...
Il n'empêche, tâchons de comprendre, à travers l'exemple de finissé-je, sur quel modèle exact ces graphies en -é-je sont formées. Ne souriez pas : la chose n'a rien d'évident, et ce n'est pas l'explication donnée à l'article « je » du TLFi qui va nous aider à y voir clair : « Par analogie, avec les verbes du 1er groupe, on ajoute quelquefois un é aux radicaux du 3e groupe. » Mais à quel radical précisément ? se demande-t-on en pensant à tous les verbes qui en ont plusieurs (boire, coudre, devoir, pouvoir, prendre, tenir, venir, vouloir...).Là encore, les grammairiens − ceux, du moins, qui ne tiennent pas ces formes pour des barbarismes − ont bien du mal à parler d'une seule voix. Les uns (5), glosant lesdites combinaisons par « est-il possible que je coure ? que je perde ? etc. », penchent pour le radical de la première personne du singulier du présent du subjonctif ; les autres (6), soupçonnant une confusion homophonique entre (aim)é et (aim)ez, optent pour le radical de la deuxième personne du pluriel de l'indicatif présent. Avec finir, me direz-vous, le résultat est le même : finissé-je, dans les deux cas. Mais des anomalies se font jour, en particulier avec l'analyse par le subjonctif. Je pense à tous les verbes du premier groupe présentant une altération du radical au présent de l'indicatif et du subjonctif :
acheter > (est-il possible que) j'achète > acheté-je,
appeler > (est-il possible que) j'appelle > appelé-je,
employer > (est-il possible que) j'emploie > employé-je,
jeter > (est-il possible que) je jette > jeté-je,
préférer > (est-il possible que) je préfère > préféré-je, etc.,et aux formes allé-je (par exemple chez Verlaine), prené-je (par exemple chez Depraz), tené-je (par exemple chez Guyotat), voulé-je (par exemple chez Giraudoux), etc., qui ne correspondent ni à une première personne de l'indicatif présent ni à une première personne du subjonctif présent − du moins, en français moderne (7).
Même l'analyse par le pluriel de l'indicatif présent, qui semble mieux rendre compte de l'usage, se heurte à deux exceptions : dire (vous dites, en regard de disé-je) et faire (vous faites, en regard de fesé-je) − encore qu'il s'agisse là de deux exceptions théoriques, ces verbes figurant dans la courte liste de ceux, monosyllabiques, après lesquels le rejet de je est traditionnellement admis : dis-je, fais-je.À la réflexion, une troisième analyse est possible, plus séduisante encore que les deux autres. Elle m'est inspirée par une remarque de Vaugelas : « [Il ne faut pas escrire] aimay-je au lieu de aimé-je. Car qui ne voit qu'aimay-je fait une équivoque avec la première personne du preterit simple ou defini [= notre passé simple], et qu'en escrivant aimé-je, il fait le mesme effet pour la prononciation [...] sans qu'on le puisse prendre pour un autre ? » Tout porte ainsi à croire, comme l'écrit Lucien Foulet, que la langue, guidée par une fausse analogie, s'est d'abord servie du radical du passé simple : « Sur le modèle de aimé-je [qu'on écrivait souvent aimai-je], on créa menté-je, perdé-je, rompé-je. Comme nous l'avons indiqué, on avait le sentiment d'une vague parenté avec la forme du prétérit : de là allé-je pour vais-je » (Comment ont évolué les formes de l'interrogation, 1921). Mais ce que nos deux spécialistes oublient de prendre en compte, c'est qu'à l'oral les formes aimé, aimai, aimay sont également très proches de aimois, aimais (8). Autrement dit, à l'équivoque avec le passé simple est venue s'ajouter celle avec l'imparfait (qui explique par exemple les formes buvé-je, lisé-je, finissé-je). En témoignent cette mise en garde de Féraud : « [Plusieurs] donnent en cette occasion au présent la terminaison de l'imparfait ou de l'aoriste [= notre passé simple], et écrivent oubliois-je ou oubliai-je, au lieu de oublié-je. Ce sont des fautes grossières » (Dictionnaire critique, 1788), cette remarque de Georgin : « Chanté-je sonne comme un imparfait » (Difficultés et finesse de notre langue, 1952) et ces exemples de confusion de conjugaison qui ne cessent de se multiplier à l'écrit :
« — Je voulais [...] que nous restassions avec mon père. Quelle folie, leur disai-je [sic] à tous les deux, de perdre sa liberté » (Élisabeth Guénard, 1816).
« Et je sais par cœur votre histoire. Mais où pensez-je [sic] en venir En m'en jetant le souvenir ? » (Clovis Michaux, avant 1874).
« [Mon père] m'a maudit à peine sortai-je [sic] de l'enfance » (Victor Tissot, 1880).
« Je serrai la main du Corse [...]. — Et les maris ? car il y a souvent des maris, interrompai-je [sic] énervé » (Jean Lorrain, 1904).
« Je présentais à peu près en ces termes l'un des aspects [...] de cette philosophie historique. "Le point de départ de M. Spengler, écrivai-je [sic], est [...]" » (Ernest Seillière, 1927).
« Je l'interrompis [...]. — Pour vous reconnaître, poursuivai-je [sic], il faudrait que je vous aie connu » (Jean Lasserre, 1939).
« — Je ne sais pas ce que je dis ! m'écriai-je [...]. — Pourquoi m'inquiétez-vous ! gémissai-je [sic] » (Jacques Robert, 1951).
« J'attendai [sic] l'invitation à me mettre en route mais rien ne venait » (René-Jean Clot, 1953).
« — [...] tu le sauras toujours à temps, me défendai-je [sic] contre ses remontrances. Elle avait bazardé [tel objet] » (Arthur Bernard, 1993).
« Puis il toussota. — Je suis vraiment confus, dit-il. J'aurais dû y penser. — À quoi ? soupiré-je [sic] » (Catherine Clément, 2000).
« Elle me demanda [...]. — Vous voulez dire que [...], répondai-je [sic] » (Michel Fauquier, 2009).
« J'écris un roman au présent et à la première personne, ce qui est un vrai calvaire lorsque je souhaite introduire des incises. À part le "dis-je", je ne sais pas quoi mettre d'autre [...]. Est-ce que je peux mettre "demandais-je" ? » (forum consacré aux écrivains en herbe, 2015).
Aussi est-il permis de supposer que les combinaisons en -é-je ont été forgées sur le radical de la première personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif, par confusion homophonique entre les finales -é, -ai, -ois et -ais.
Mais laissons là ces querelles d'experts et terminons notre tour d'horizon. Qu'en est-il de l'inversion du pronom je de nos jours ? Quasiment absente de la langue parlée, qui l'évite autant que possible en marquant l'interrogation par la seule intonation ou par le tour est-ce que ? afin de maintenir l'ordre sujet-verbe dans la suite de la phrase, elle serait réservée, à l'écrit, au seul registre littéraire ou archaïsant, nous assure-t-on :
« Ces formes inversées de la première personne se rencontrent surtout dans la langue littéraire classique. [Elles ne sont] cependant pas proscrite[s] de la langue littéraire moderne : Parlé-je ainsi pour moi ? (Michelet). Mais dans la langue parlée on préfère interroger à l'aide de est-ce que ? » (René Georgin, Difficultés et finesse de notre langue, 1952).
« Les formes correctes, mais peu usuelles que voici : Ne parlé-je pas d'eux comme d'autant d'adversaires ? (Colette, 1941), Causé-je trop longuement avec un ami ? (Georges Duhamel, 1922) [...] ont quelque chose d'affecté qui "sent la littérature" » (Robert Le Bidois, L'Inversion du sujet dans la prose contemporaine, 1952), « Seule la langue littéraire recourt encore occasionnellement à ce pis-aller » (Id, Le Monde, 1964).
« On sait que l'usage contemporain, qui manifeste une tendance générale à éviter l'inversion, n'emploie qu'exceptionnellement et toujours avec une tournure ironique les expressions chanté-je, et même puissé-je, dussé-je, etc. Sens-je et tiens-je sont impossibles de nos jours. Dors-je et sers-je qui n'ont jamais été fréquents sont complètement disparus » (Dupré, 1972).
« Lorsque la voyelle finale du verbe était un e muet, on l'accentuait dans la langue littéraire ancienne [...] ; la langue actuelle ne pratique plus guère cette forme que dans certaines formules figées de souhait ou de concession : Puissé-je... Dussé-je... » (Grand Larousse, 1973).
« Signalons, pour mémoire, le caractère souvent non naturel de l'inversion du pronom de 1re personne du singulier, à l'indicatif présent (*sors-je ? *réponds-je ?), qui n'est pas spécifique aux interrogatives et apparaît par exemple en incise » (Nelly Danjou-Flaux et Anne-Marie Dessaux, L'Interrogation en français, 1976).
« Toutes ces tournures [avec é euphonique] appartiennent exclusivement à la langue littéraire » (Grevisse, Le Bon Usage, 1980).
« Si la 1re personne se termine par e, l'inversion de je est théoriquement possible, mais exceptionnelle, qu'il s'agisse ou non d'une phrase interrogative, à condition de changer e en é » (Hanse, Nouveau Dictionnaire des difficultés du français moderne, 1983).
« L'interrogation avec inversion du sujet [...] est surtout réservée à l'écrit, en particulier littéraire [...]. La possibilité [du é euphonique] est peu exploitée en français courant, car elle combine l'inversion et une forme verbale énigmatique pour un présent » (Grammaire méthodique du français, 1994).
« The forms donné-je, aimé-je, parlé-je, prené-je, voulé-je are now considered archaic » (Monique L'Huillier, Advanced French Grammar, 1999).
« La solution [du é euphonique] est aujourd'hui tombée en désuétude » (Jesse Tseng, L'inversion pronominale, 2008).
« Des tournures telles que aimé-je, puissé-je, veux-je, etc. ne se rencontrent plus guère que dans certains écrits littéraires et/ou archaïsants » (Encyclopédie grammaticale du français, 2015).
« Cette construction, très littéraire, est peu attestée dans le registre oral » (Goosse, Le Bon Usage, 2016).
« Il existe une forme spécifique chantè-je, mais elle est aujourd'hui archaïque » (La Grande Grammaire du français, 2021).
« La forme en é employée avec je à la première personne de l'indicatif présent [de certains verbes], dans l'interrogation ou l'exclamation avec inversion du pronom, appartient au registre littéraire ou très soutenu » (Larousse en ligne).
« Cette construction [en -é-je] reste cependant très littéraire et est peu employée dans le langage courant si ce n'est justement pour provoquer un effet de moquerie vis-à-vis du "beau langage" » (site Le Conjugueur du Figaro).
Et pourtant... Il n'est que de consulter la production de « romances » et de « fantasies » qui inondent le marché du livre (papier et numérique) depuis les années 2010 et l'apparition de sites d'autopublication pour constater que la situation actuelle est autrement complexe : la langue écrite contemporaine se trouve tiraillée entre deux tendances contraires.
D'un côté, le recours décomplexé à l'inversion de la première personne du singulier et à ses formes accentuées :
(formes régulières) « aboyé-je », « accentué-je », « accepté-je », « accordé-je », « l'accueillé-je », « l'accusé-je », « m'acharné-je à leur rappeler », « achevé-je », « acquiescé-je », « affirmé-je », « m'agacé-je », « l'agressé-je », « ajouté-je », « l'alerté-je », « allégué-je », « m'amusé-je », « m'angoissé-je », « annoncé-je », « l'apostrophé-je », « l'appelé-je », « approuvé-je », « argué-je », « argumenté-je », « arrivé-je à articuler », « articulé-je », « assené-je », « assuré-je », « attaqué-je », « avancé-je », « l'avisé-je », « avoué-je », « bafouillé-je », « balancé-je », « balbutié-je », « baragouiné-je », « bégayé-je », « biaisé-je », « blagué-je », « bougonné-je », « le bousculé-je », « me braqué-je », « bredouillé-je », « le brocardé-je », « calculé-je », « cautionné-je », « certifié-je », « changé-je de sujet », « chantonné-je », « cherché-je à savoir », « chevroté-je », « chouiné-je », « chuchoté-je », « cinglé-je », « clamé-je », « lui commandé-je », « commencé-je », « commenté-je », « lui communiqué-je », « complété-je », « compté-je », « concédé-je », « confessé-je », « lui confié-je », « confirmé-je », « le conforté-je », « lui conseillé-je », « considéré-je », « le consolé-je », « constaté-je », « continué-je », « le contré-je », « le corrigé-je », « couiné-je », « le coupé-je », « craché-je », « crevé-je d'envie de lui souffler », « crié-je », « me crispé-je », « débité-je », « débuté-je », « décidé-je », « déclaré-je », « découvré-je », « décrété-je », « me défilé-je », « demandé-je », « démarré-je », « dénoncé-je », « déploré-je », « me désespéré-je », « désigné-je d'un doigt », « me désolé-je », « détaillé-je », « deviné-je », « lui dévoilé-je », « lui dicté-je », « divulgué-je », « lui donné-je raison », « douté-je », « éclaté-je de rire », « m'écrié-je », « m'efforcé-je d'admettre », « m'égosillé-je », « éludé-je », « m'embrouillé-je », « m'emporté-je », « m'empressé-je de répondre », « enchaîné-je », « l'encouragé-je », « m'énervé-je », « enfoncé-je le clou », « m'entêté-je », « m'enthousiasmé-je », « entonné-je », « entré-je en matière », « énuméré-je », « envisagé-je », « envoyé-je », « épelé-je », « m'époumoné-je », « éructé-je », « m'esclaffé-je », « espéré-je », « essayé-je », « estimé-je », « m'étonné-je », « m'étouffé-je », « m'étranglé-je », « évalué-je », « évoqué-je », « m'exclamé-je », « m'excusé-je », « l'exhorté-je », « exigé-je », « explicité-je » (rare), « expliqué-je », « explosé-je », « lui exposé-je », « lui exprimé-je », « m'extasié-je », « extrapolé-je », « me fâché-je », « fanfaronné-je », « le félicité-je », « feulé-je », « me forcé-je à lui dire », « formulé-je », « fredonné-je », « fulminé-je », « lui glissé-je à l'oreille », « gloussé-je », « grimacé-je », « grincé-je », « grogné-je », « grommelé-je », « grondé-je », « haleté-je », « hasardé-je », « le hélé-je », « hésité-je », « hoqueté-je », « hurlé-je », « imaginé-je », « l'imploré-je », « lui imposé-je », « m'indigné-je », « lui indiqué-je », « l'informé-je », « m'inquiété-je », « insinué-je », « insisté-je », « m'insurgé-je », « l'interrogé-je », « lui intimé-je », « l'invectivé-je », « l'invité-je à poursuivre », « ironisé-je », « jugé-je », « lâché-je », « laissé-je échapper », « me lamenté-je », « lancé-je », « le manipulé-je », « manqué-je de m'étrangler », « marmonné-je », « martelé-je », « le menacé-je », « mentionné-je », « me moqué-je », « me morigéné-je », « murmuré-je », « nié-je », « noté-je », « nuancé-je », « objecté-je », « m'obligé-je à dire », « observé-je », « m'obstiné-je », « obtempéré-je », « offré-je », « m'offusqué-je », « opiné-je », « lui opposé-je », « ordonné-je », « osé-je lui demander », « lui ouvré-je davantage mon cœur », « le pardonné-je », « pensé-je », « percuté-je », « péroré-je », « persévéré-je », « persiflé-je », « persisté-je », « le persuadé-je », « pesté-je », « piaillé-je », « plaidé-je », « plaisanté-je », « pouffé-je », « précisé-je », « préconisé-je », « le pressé-je », « présumé-je », « le prié-je », « proclamé-je », « prononcé-je », « lui proposé-je », « protesté-je », « le provoqué-je », « quémandé-je », « questionné-je », « le rabroué-je », « raconté-je », « le raillé-je », « râlé-je », « lui rappelé-je », « lui rapporté-je », « le rassuré-je », « réalisé-je », « me rebiffé-je », « récapitulé-je », « récité-je », « lui réclamé-je », « recommencé-je », « lui recommandé-je », « le réconforté-je », « me récrié-je », « rectifié-je », « reformulé-je », « refusé-je », « réfuté-je », « regretté-je », « réitéré-je », « relaté-je », « relativisé-je », « relevé-je », « remarqué-je », « le rembarré-je », « me renfrogné-je », « le renseigné-je », « lui renvoyé-je », « répété-je », « répliqué-je », « le réprimandé-je », « lui reproché-je », « résumé-je », « rétorqué-je », « lui retourné-je », « révélé-je », « ricané-je », « rigolé-je », « riposté-je », « me risqué-je à lui demander », « ronchonné-je », « ronronné-je », « rouspété-je », « ruminé-je », « rusé-je », « le salué-je », « sangloté-je », « scandé-je », « le sermonné-je », « sifflé-je de rage », « le sollicité-je », « le sommé-je », « songé-je », « soufflé-je », « souhaité-je », « souligné-je », « le soupçonné-je », « soupiré-je », « suggéré-je », « le supplié-je », « supposé-je », « sursauté-je », « susurré-je », « le taquiné-je », « tempéré-je », « tenté-je », « tergiversé-je », « terminé-je », « tiqué-je », « tonné-je », « tranché-je », « trouvé-je à dire », « vociféré-je », « zozoté-je », etc., à côté de « dis-je », « fais-je », « lis-je »...
(formes analogiques) « admetté-je » (ou, plus fréquemment, « admets-je »), « l'avertissé-je » (ou, plus fréquemment, « l'avertis-je »), « compatissé-je » (rare à côté de « compatis-je »), « conclué-je » (à côté de « conclus-je »), « consenté-je » (rare à côté de « consens-je »), « me défendé-je » (ou, plus fréquemment, « me défends-je »), « déglutissé-je » (rare à côté de « déglutis-je »), « l'enjoigné-je [sic] » (ou, plus fréquemment, « lui enjoins-je »), « m'enquéré-je » (ou, plus fréquemment, « m'enquiers-je »), « l'entendé-je déclarer » (rare à côté de « l'entends-je... »), « feigné-je de m'étonner » (ou, plus fréquemment, « feins-je... »), « finissé-je par murmurer » (ou, plus fréquemment, « finis-je... », n'en déplaise à Goosse et à l'Académie), « gémissé-je » (ou, plus fréquemment, « gémis-je »), « glapissé-je » (ou, plus fréquemment, « glapis-je »), « l'interrompé-je » (ou, plus fréquemment, « l'interromps-je »), « intervené-je » (ou, plus fréquemment, « interviens-je »), « menté-je » (ou, plus fréquemment, « mens-je », n'en déplaise à Grevisse...), « me plaigné-je » (ou, plus fréquemment, « me plains-je »), « poursuivé-je » (ou, plus fréquemment, « poursuis-je »), « prétendé-je » (ou, plus fréquemment, « prétends-je »), « le prévené-je » (ou, plus fréquemment, « le préviens-je »), « prometté-je » (ou, plus fréquemment, « promets-je »), « reconnaissé-je » (rare à côté de « reconnais-je »), « réfléchissé-je » (rare à côté de « réfléchis-je »), « me réjouissé-je » (rare à côté de « me réjouis-je »), « renchérissé-je » (rare à côté de « renchéris-je »), « répondé-je » (ou, plus fréquemment, « réponds-je »), « reprené-je » (ou, plus fréquemment, « reprends-je »), « requéré-je » (rare à côté de « requiers-je »), « me ressaisissé-je » (ou, plus fréquemment, « me ressaisis-je »), « réussissé-je » (ou, plus fréquemment, « réussis-je »), « rugissé-je » (ou, plus fréquemment, « rugis-je »), « me senté-je obligé de rectifier » (ou, plus fréquemment, « me sens-je... », n'en déplaise à Dupré), « sourié-je » (ou, plus fréquemment, « souris-je »), « soutené-je » (ou, plus fréquemment, « soutiens-je »), etc. (9)
Cette longue liste d'exemples (tous authentiques) montre assez que, si l'inversion du pronom je revient en force sous certaines plumes, c'est d'abord en tant que procédé syntaxique permettant d'éviter la répétition lassante de dis-je (ou de pensé-je) dans les dialogues (ou les réflexions) rapportés à la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Voilà pourquoi il s'agit essentiellement de verbes de parole (ou impliquant l'idée de parole, fût-ce au prix d'une ellipse : grimacé-je pour « dis-je en grimaçant », etc.) et de verbes de pensée (ou d'opinion, de jugement), employés en incise. Pour autant, les autres cas d'inversion ne sont pas absents de ces écrits :
(dans une interrogation totale) « Ne subissé-je autant que vous ces désagréments ? » (Francis Thievicz, 2011), « Mais le pensé-je vraiment ? » (traduction de l'anglais de Mina Shepard, 2014), « Le connais-je seulement ? » (Ange Edmon, 2021), « Ne risqué-je pas de [...] ? » (Stefan Platteau, 2021), « Souhaité-je vraiment commencer [...] ? » (Kate Owyn, 2022), « Songé-je vraiment au bonheur de ma fille ? » (Corentine Dumaine, 2022 ; n'en déplaise à Thomas...), « Ne prends-je pas le risque [que...] ? » (Alice Lipsey, 2023 ; n'en déplaise à Grevisse et à Thomas...),
(après un mot interrogatif) « Pourquoi ne mouré-je pas ? » (Benoit P. Thomas, 2012), « Pourquoi songé-je à lui ? » (Éloïse Averty, 2014), « Qui sers-je en premier ? » (Davy Artero, 2017 ; n'en déplaise à Dupré...), « Qu'attendé-je de lui ? » (Jessica Hailey, 2019), « À quoi pensé-je [...] ? » (Linda Catherine, 2021), « Quels risques prends-je en t'accompagnant ici ? » (Angel Arekin, 2021), « Mais de quelle clef parlé-je ? » (Franz Woland, 2022), « Où me trompé-je ? » (Laurie Alice Dumas, 2022), « Pourquoi, chaque semaine, m'enfoncé-je un peu plus dans le mensonge ? » (Mady Flynn, 2022), « Pourquoi douté-je autant ? » (Julie Will, 2023), « Qu'espéré-je au fond de moi ? » (Lila Collins, 2023), « Pourquoi finis-je toujours par [...] ? » (Plume D. Serves, 2023), « Depuis quand rêvé-je de cela ? » (Avril Morgan, 2023), « Pourquoi, alors, souffré-je toujours de cette faiblesse humaine ? » (Jacques Collin traduisant l'anglais de Namina Forna, 2023), « Pourquoi ne parviens-je pas à me conduire comme un être civilisé ? » (Pierrette Lavallée, 2023), « À quoi m'attends-je réellement pour la suite ? » (Mel D., 2023), « Depuis quand envisagé-je de faire entrer de plain-pied une femme dans ma vie ? » (Gwen Delmas, 2023),
(après un adverbe ou une locution adverbiale) « Aussi ne réponds-je rien » (Emma Paule traduisant l'anglais de Kayla Perrin, 2013), « Peut-être me trompé-je » (Cécile Chomin, 2015), « Aussi tiens-je à les asssurer [que...] » (Claude Mamier traduisant l'anglais de D. Nolan Clark, 2018 ; n'en déplaise à Dupré...), « Aussi tenté-je de retrouver un ton badin » (Jenny Rose, 2020), « Aussi trouvé-je normal de lui demander franchement » (Angel.B, 2020), « Du moins essayé-je de m'en convaincre » (Mélodie Smacs, 2022), « Aussi m'enquiers-je d'une voix douce [...] » (Karine Marcé, 2022), « Peut-être ne lui plais-je pas autant que je m'en étais fait l'idée » (Lhattie Haniel, 2022), « Aussi m'attends-je à ce qu'il s'explique » (Clara Nové, 2022), « À peine pensé-je cela que les bruits [...] s'estompent » (Laëtitia Danae, 2023), « Aussi prends-je la direction de l'ascenseur » (Frédérique de Keyser, 2023), « Peut-être laissé-je échapper un gémissement étranglé » (Odile Carton traduisant l'anglais de Meg Clothier, 2023).
Aucune intention humoristique ici (si ce n'est, peut-être, dans le choix des pseudonymes...), seulement l'application mécanique d'une règle débarrassée de toute restriction euphonique : postposition du pronom je à la forme conjuguée (quel que soit le verbe envisagé), avec accentuation de la voyelle finale quand il s'agit d'un e et, dans la plupart des autres cas (à l'exception notable de avoir, dire, faire, etc.), possibilité d'opter pour la variante analogique en é (formée sur le radical de la première personne du singulier de l'imparfait de l'indicatif).
Les mauvaises langues ne manqueront pas de voir dans cette mode (ou ce retour de mode) une tentative aussi artificielle que dérisoire pour donner un semblant de cachet à un genre littéraire qui en est trop souvent dépourvu. Les esprits plus indulgents préféreront invoquer les limites de la solution préconisée par les grammaires traditionnelles. Il est vrai que la périphrase est-ce que ? ne brille ni par sa légèreté : « Elle alourdit sensiblement l'énoncé interrogatif » (Robert Le Bidois, 1952), « [Elle donne même] une impression de vulgarité ou de négligence après les adverbes interrogatifs (pourquoi, quand, où, etc.) » (Dupré, 1972), ni par son aptitude à rendre précisément la pensée : « Sens-je ? et Est-ce que je sens ? ne sont pas deux interrogations identiques. La première exprime plus positivement le doute et s'emploie, en outre, dans les interrogations implicites : Suis-je assez malheureux ! Tombez-vous dans le malheur, chacun vous abandonne » (Jules Dessiaux, Examen critique de la Grammaire des grammaires de M. Girault-Duvivier, 1832), « Rigoureusement parlant, l'interrogation directe et l'interrogation faite par la circonlocution est-ce que n'ont pas le même sens. Celui qui dit : pleut-il ? est dans le doute sur l'existence de la pluie. Celui qui dit : est-ce qu'il pleut ? croit au contraire qu'il ne pleut pas, et il exprime sa surprise relativement à la pluie » (Charles-Pierre Chapsal, Syntaxe française, 1842). Surtout, son emploi n'est acceptable que dans les interrogations directes, en dehors desquelles le scripteur n'a souvent d'autre choix que de recourir à l'inversion du pronom je.De l'autre, le désir instinctif de conserver l'ordre canonique sujet-verbe (en dehors des traditionnels dis-je, fais-je...), jusque dans les incises de narration : « — Vous faites quoi ? je demande en désignant la lampe » (Ruberto Sanquer, 2018), « — T'es qui au juste ? je lâche avec ce ton antipathique que je maîtrise à la perfection » (CS Quill, 2018), « — Peut-être ? je fais » (Angie Thomas, 2022), « — Hum, hum, je lui réponds à mon tour » (Louisiane Reignier, 2023), « — Un accent ça ne s'entend que par les autres, je lui explique avec logique » (Nina Leroy, 2023). Le procédé n'est pas nouveau ; on le trouve, par exemple, chez Léo Malet : « — Pourquoi dites-vous cela ? je lance, brutalement » (Casse-pipe à la Nation, 1957). Mais il était jusque-là réservé au registre familier, voire, avec l'introducteur que, franchement populaire : « — Pauvre bête, que je lui dis » (Sand, 1849), « — J'ai ma dignité moi ! que je lui réponds » (Céline, 1932), « — Et c'est comme ça que vous parlez, non ? que je fais » (Roger Nimier, 1950), « — T'as tout de même pas fait ça, qu'il s'écrie » (Raymond Queneau, 1959). Qui plus est, il est source d'amphibologie : « Dans [certains] passages, les verbes en incise pourraient très bien s'interpréter comme appartenant aux paroles rapportées », observe avec raison l'auteur de La Grammaire de Forator.
Parfois, les deux tendances se manifestent chez un même auteur et dans un même texte, de façon aléatoire (?) : « — Vous avez besoin de jeux martiaux, je rétorque » à côté de « — Je suis homme de cordes, non d'épée ! rétorqué-je » (Stefan Platteau, 2014), « — Mon loup fait des siennes, je finis par dire » à côté de « — J'ai préféré la ménager, finis-je par répondre » (Samantha Morgan, 2022), ou de manière plus raisonnée : « — On dirait une galaxie, dis-je », « — La ferme, fais-je en rougissant », à côté de « — Qu'est-ce qu'on va faire ? je lui demande », « — Soph..., je l'interromps » (Alexandra Maillard traduisant l'anglais de Sara Wolf, 2017).
Et que dire encore de ces exemples de graphie non accentuée qui défient les lois de la prononciation : « — Analyse par toi-même, renchérisse-je » (Adeline Léo, 2018), « À peine envisage-je de clore ce paragraphe [que...] » (Rick Fapatello, 2018), « Pourquoi pense-je que c'est vrai ? » (Julia Noyel, 2021) ?
On le voit : en l'absence de solution pleinement satisfaisante, l'usage n'en finit pas d'hésiter entre les différents procédés à sa disposition, dès lors que se profile l'éventualité d'une inversion du pronom je à l'indicatif présent : est-ce que je veux, veux-je, voulé-je, voulè-je, veuillé-je, veuillè-je, je veux... Elle n'est pas belle, la langue française ?
(1) L'ancienne langue a d'abord dit aim jou ou aim jié, avec l'accent tonique sur le pronom personnel. Mais, après le changement de aim en aime et l'affaiblissement du pronom en je, on a dit aime-je, avec l'accent sur le radical du verbe. La syllabe accentuée était ainsi suivie de deux syllabes atones, « fait de prononciation que le français ne pouvait tolérer longtemps » (selon Hatzfeld et Darmesteter). Aussi en est-on venu à déplacer l'accent sur le premier des deux e. La transcription de ce phénomène se révélant malaisée en l'absence d'accents graphiques, on a d'abord eu recours à des terminaisons en ai, -ay, -ei : « Et fussei ge à Tours » (Chanson du XVe siècle, citée par Nyrop), « Ce cuiday je » (Le Franc-Archer de Bagnolet, 1470), « Sy portai ge assez d'yeulx » (Sottie de la fin du XVe siècle), « Comment le puissay-je sçavoir ? » (Farce de George le Veau, vers 1500). Condamnées par Vaugelas en raison de l'équivoque évidente avec le passé simple, elles furent remplacées progressivement (mais non sans résistance) par un é euphonique.
(2) En français moderne, précise le Dictionnaire de l'Académie, on emploie toujours puis au lieu de peux, à la première personne du présent de l'indicatif, quand le pronom je suit le verbe.
(3) Et aussi, avec les graphies parasites en -ai, -ay : « Or entenday je dire par ce lieu [...] » (Gabriel Dupréau, 1557), « Cela voy-je et sentay-je tous les jours » (François II, 1560), « Que pretenday-je dans ma passion ? » (Madeleine de Scudéry, 1654), « Mais pourquoi perdai-je Saint Louis de vue ? » (Esprit Fléchier, 1681), « Te paroissai-je ainsi ? » (Philippe Néricault Destouches, 1710), « Ne lisai-je pas que vous êtes encore enrhumée [...] ? » (Diderot, 1760), « Aussi [...] me sentai-je plus d'envie de rire que de pleurer » (Julie Delafaye-Bréhier, 1825), « À quelle profondeur ne sentai-je pas que [...] » (Charles Du Bos, 1931), « Heureuse, écrivai-je imprudemment » (Solange de Bressieux, 1960), « Lorsque Maurice Clavel se fait attaquer [...], pourquoi me sentai-je concerné ? » (Claude Mauriac, 1978).
(4) « On évite d'invertir je après les formes verbales se terminant par un e muet ou contenant dans leur désinence la voyelle i. Ainsi, cette phrase de Montaigne ferait, de nos jours, un effet légèrement comique : "Rougis-je ? escume-je ? [...] tressauls-je ? fremis-je de courroux ?" » (Georges et Robert Le Bidois, Syntaxe du français moderne, 1935), « Dans les verbes des deuxième et troisième groupes, l'inversion aurait un son étrange et même bouffon. On évitera de dire : Fuis-je ? Perds-je la tête ? Réponds-je bien ? Lui tends-je la main ? » (René Georgin, Difficultés et finesse de notre langue, 1952).
(5) Citons :
« Quand les verbes terminent à la premiére personne singuliére du présent de l'indicatif par deux ou trois consonnes, comme je dors, je sors, je sers, je perds, etc. s'ils sont suivis de je, alors au lieu du présent de l'indicatif on se sert du présent du subjonctif dont on ouvre l'é final. Dormé-je aussi longtemps que vous ? Servé-je aussi mal que lui ? Perdé-je ? Sorté-je autant qu'eux ? » (Joseph Valart, Grammaire françoise, 1744).
« Cependant, on ne dit pas cours-je ? couds-je ? Il faut se servir de est-ce que je cours, est-ce que je couds, ou bien de la première personne du présent du subjonctif, et dire couré-je ? cousé-je ? et ainsi de beaucoup d'autres verbes ; cette dernière manière n'est pourtant pas encore très généralement adoptée » (Pierre-Claude-Victor Boiste, Abrégé de la grammaire française figurant à la fin de son Dictionnaire, 1803).
« [Tous les grammairiens] veulent qu'on interroge par est-ce que ? les verbes qui, par raison d'euphonie, ne peuvent s'interroger par un é fermé. Je ne partage nullement cette opinion ; car, en interrogeant ces verbes par est-ce que ? la phrase devient dubitative. Je crois donc que, par raison d'euphonie, et pour généraliser la règle, on doit interroger la première personne du singulier du présent de l'indicatif par la première personne du singulier du présent du subjonctif, en changeant l'e muet en e fermé » (Jean-Noël Blondin, Manuel de la pureté du langage, 1823).
« Je crois pouvoir établir en principe que, dans tous les verbes en ir et en re qui se terminent par plus d'une consonne, à la première personne du singulier, présent indéfini, mode absolu, il faut, lorsqu'il y a interrogation, substituer à cette forme du présent absolu celle du présent du subjonctif [...]. Si ces expressions [dormé-je, rendé-je, etc.] sont usitées, je soutiens qu'elles n'ont pu être introduites qu'à la faveur d'une ellipse [...] ; c'est comme si je disais : Est-il présumable, croit-on, est-il vraisemblable, est-il possible, y a-t-il apparence, est-il supposable, peut-on dire que je dorme, que je rende ? etc. » (Jean Edme Serreau et François-Narcisse Boussi, Grammaire ramenée à ses principes naturels, 1824).
« [Il est d'usage de dire :] est-ce que je dors ? etc. Mais nous croyons qu'il est beaucoup mieux de prendre la personne du temps causatif présent, ou futur, de la tourner interrogativement, et, changeant l'e muet en é aigu, de dire : dormé-je ? couré-je ? sorté-je ? craigné-je ? etc. » (Napoléon Caillot, Grammaire générale, 1838).
« Quelques grammairiens [prétendent qu'il faut] dire, avec le subjonctif : Couré-je ? perdé-je ? senté-je ? dormé-je ? vendé-je ? etc., locutions qu'ils analysent ainsi : Est-il possible que je coure, que je perde, que je vende, etc. Aussi, séduits par ce raisonnement autant que gênés par la mesure des vers, quelques poètes se sont-ils permis cette licence » (Louis-Nicolas Bescherelle, Dictionnaire national, 1846).
(6) Citons :
« Apprenez aussi que le vulgaire, et beaucoup de personnes d'esprit, forment inconsiderément des pluriers au lieu de singuliers aux verbes terminez en consonnes à la premiere personne du present de l'indicatif, et le font pour la commodité de la liaison du pronom personnel : perdez-je pour pers-je, attendez-je pour attens-je, dormez-je pour dors-je, allez-je pour vay-je. Et cet erreur est si avant dans l'usage qu'il eschappe à quantité de bons discoureurs » (Antoine Oudin, Grammaire françoise, 1632).
« Cette licentieuse maniere de prononcer et d'écrire [parlé-je, prononcé-je, deussé-je], autorisée de l'usage pour la douceur et la facilité de la prononciation, a donné lieu à quelques Parisiens, et même à quelques gens de la Cour, de dire menté-je, rompé-je, senté-je, pouvé-je, fesé-je, etc. pour dire ments-je, romps-je, sents-je, puis-je, fais-je, croyant peut-être que lorsqu'on avoit commencé à prononcer parlé-je, au lieu de parle-je, pour faciliter la prononciation de ces deux e voisins, on se servoit de la seconde personne pluriere de ces temps presents, qu'on joignoit au pronom je, en retranchant le pronom vous [...] : parlez-je, prononcez-je, marchez-je, et qu'ainsi on pouvoit dire sentez-je, mentez-je, pouvez-je, de même [...]. Je n'ai commencé à faire cette remarque qu'en Alemagne, où des curieux, mais mal instruits, se récriant sur l'irregularité de notre langue, assuroient qu'on joignoit une seconde personne d'un temps present avec un pronom personnel de la premiere personne, comme parlez-je pour parle-je, ce qui m'a donné lieu de croire que, puisque les étrangers ont pu se faire une fausse regle là-dessus, il pourroit être qu'autrefois parmi nous quelques-uns s'en seroient aussi fait une de même » (Jean Hindret, L'Art de prononcer parfaitement la langue françoise, 1696).
« Par analogie, on a pu voir au XVIIe siècle des verbes terminés par consonne adopter la finale é : perdé-je ?, dormé-je ?, sur le radical du pluriel » (Hervé-Dominique Béchade, Syntaxe du français moderne et contemporain, 1986).
(7) Les anciennes formes du subjonctif présent (que) j'alle, (que) je prene, (que) je tiegne ont pu favoriser les graphies analogiques inversées allé-je, prené-je, tené-je. Le cas du verbe vouloir est plus complexe, dans la mesure où voulé-je entre parfois en concurrence avec une autre graphie analogique inversée : « Parce que, veuillé-je bien vous expliquer [...] » (Alphonse Allais, 1901), « Mais le veuillé-je bien [...] ? » (Pierre Borel, avant 1963), « C'est, veuillé-je dire, exactement au même endroit » (Fernand Combet, 1971). Les anciennes formes du présent de l'indicatif et du subjonctif (vueil[le], veuil[le]) ne sont sans doute pas étrangères à cette situation.
(8) Précisons à ce sujet que, d'après Goosse, l'ancienne désinence -ois de l'imparfait « était devenue [ε] dès le XIVe siècle », prononciation courante au XVIe siècle et « qui s'est tout à fait imposée au XVIIe siècle ».
Pour ce qui concerne l'épineuse question de la prononciation des formes en -é-je, voir le billet Dussé-je.(9) Force est de constater que la proposition du Conseil supérieur de la langue française de privilégier la graphie avec accent grave n'a été suivie d'aucun effet, en dépit de la caution de plus d'un excellent auteur : « Encore ne parlè-je ainsi que pour la commodité du langage » (Proust, avant 1922), « Je ne partirai pas de la cabane sans en avoir le cœur net, dussè-je y passer une seconde nuit » (Henry Bordeaux, 1923), « — Comme une mère, répétè-je » (Pierre Mille, 1930).
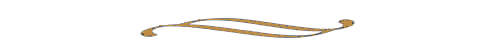
Remarque 1 : On lit çà et là sur la Toile que « la forme -é-je vaut pour les verbes du premier groupe ». Elle vaut en réalité pour tous les verbes dont la première personne du singulier se termine par un e muet : « À peine cueillé-je une fleur [que...] » (Poisson de La Chabeaussière et Raboteau, 1802), « Je dois vivre, fussé-je accablée d'ignominie ! » (Sand, 1832), « Qu'offré-je ? » (Henri-Frédéric Amiel, 1849), « De quoi souffré-je ? » (Edmond Jaloux, 1932), « Dussé-je en crever de honte, je le confesserai bien haut » (Marcel Aymé, 1950), « Que découvré-je, en page 8 ? » (Pierre Merle, 2007), etc.Remarque 2 : Les exclusions évoquées dans cet article ne concernent-elles que le présent de l'indicatif ? Chez Girodet, il faut, pour le savoir, lire entre les lignes : « Dans l'interrogation directe et dans l'exclamation, on ne peut employer je postposé après une forme monosyllabique d'un verbe du deuxième ou du troisième groupe, sauf ai-je ?, dis-je ?, dois-je ?, puis-je ?, suis-je ?, vais-je ?, vois-je ? » Hervé-Dominique Béchade se montre plus explicite : « On ne dit pas [au passé simple] fus-je ?, fis-je ?, mais est-ce que je fus ?, est-ce que je fis ? Ces refus dont dus essentiellement à la forme monosyllabique prise alors par ces verbes et qui entraîne des difficultés de prononciation. » L'ennui, c'est que les exemples contraires ne manquent pas : « Helas ! fus-je jamais si cruel que vous l'estes ? » (Racine, 1667), « Pourquoi fus-je en un jour si las de ses attraits ? » (Voltaire, 1736), « Que fis-je en cette occasion ? » (Rousseau, avant 1778), « Comment pus-je en voir approcher l'heure [...] ? » (Id., 1782), « Ne fus-je pas moi-même un parnassien » (Verlaine, 1893), « Que fis-je, braves gens ? » (Romain Rolland, 1919), « Ne fus-je pas initié à la règle du Carmel [...] ? » (Henry Bordeaux, 1943), « Comment fis-je pour l'oublier ? » (Henri Bosco, 1945), « Fus-je sensible à cette promiscuité ? » (Beauvoir, 1958), « Que lus-je ! » (François Giroud, 1973), « Pourquoi fus-je à ce point bouleversé ? » (Robert Sabatier, 1995). Il se trouve même des spécialistes qui affirment, tout de go, que « l'inversion du pronom je est toujours possible aux temps autres que le présent » (Charles Müller, OrthoTELjeux, 1985 ; mais aussi Anne Abeillé, Grande Grammaire du français, 2021). Entre ces deux extrêmes se situe un René Georgin : « Aux autres temps [que l'indicatif présent], ces formes inversées ne laissent pas de rendre aujourd'hui un son un peu insolite : Mais, crus-je pouvoir faire observer (Marcel Aymé, 1949). Que devins-je certain jour [...] ? (Gide, 1924) » (La Prose d'aujourd'hui, 1956).
Remarque 3 : Les grammairiens signalent également des exclusions relatives à l'inversion du pronom ce : « Des formes comme *furent-ce ou *fussent-ce sont rejetées. Mais on dit : sont-ce, fut-ce, etc. » (Hanse), « Pour des raisons d'euphonie, l'inversion de ce et du verbe n'est pas permise avec les formes du verbe être se terminant par [le son e muet : *furent-ce, *fussent-ce. Mais] les formes est-ce, était-ce, serait-ce, fût-ce, fut-ce, etc., sont tout à fait correctes ; il en est de même pour sera-ce, qui est cependant très rare » (Office québécois de la langue française).

(Albert Uderzo, Le Fils d'Astérix, 1983.) 4 commentaires
4 commentaires
-
Par Marc81 le 28 Avril 2023 à 09:55
Avez-vous remarqué comme arrêter tend à calquer sa syntaxe sur celle de empêcher ?
« Arrêter la terre de tourner » (Christian Goubault, 2007), « Plus rien ne pouvait plus [...] arrêter le mal de progresser » (Norbert Crochet, 2008), « Il ne s'arrête sur rien qui puisse l'arrêter de pleurer » (Dominique Eddé, 2012), « Rien ne peut L'arrêter de faire ce qu'Il fera parce qu'Il est ce genre de Dieu » (Anne Régent-Susini, 2013), « Défendre, [c'est] arrêter quelqu'un de faire quelque chose de mal » (Delphine Vuattoux, 2014), « Comment arrêter quelqu'un de ronfler (de boire, de fumer...) ? » (divers forums en ligne).
Le phénomène n'a pas échappé à l'Académie, qui s'est récemment fendue d'un avertissement sur son site Internet : « Si l'on peut dire arrêter quelqu'un, arrêter quelque chose et empêcher quelqu'un de faire quelque chose, la tournure arrêter quelqu'un de [faire quelque chose] est incorrecte » (rubrique Dire, ne pas dire, 2021). L'ennui, c'est que l'auteur dudit article aurait dû y regarder à deux fois avant d'émettre un avis aussi... arrêté.
1. D'abord, parce que la construction incriminée est dûment consignée dans le Littré (1863), le Grand Larousse (édition de 1866), le Nouveau Dictionnaire national de Bescherelle (édition de 1893) et le propre Dictionnaire historique (1888) de l'Académie. Excusez du peu !
On me rétorquera sans doute que ces dictionnaires, anciens, font tous référence à une même et unique citation, vieille de près de quatre siècles : « Je n'ai pas laissé d'en être un peu honteux, et cela m'a arrêté longtemps de vous écrire » (Vincent Voiture [1], 1647). Qu'en 1807, déjà, cet emploi du verbe arrêter passait pour un archaïsme : « On trouve quelquefois dans Voiture des tournures qui blessent la syntaxe adoptée depuis » (Le Mercure de France) (2). Et, partant, que les Larousse et Robert d'aujourd'hui ont toutes les raisons de lui fermer leurs colonnes. Qu'à cela ne tienne ! Grevisse, lui, l'accueille à bras ouverts : « Arrêter, au sens de "empêcher", admet la construction avec de et un infinitif : Aucune considération ne l'arrêtera de faire telle chose » (Le Bon Usage, 1959-1980) (3).
Vérification faite, l'exemple de Voiture est loin d'être isolé, et l'on peut affirmer sans trop se tromper que la construction arrêter quelqu'un (plus rarement quelque chose) de faire quelque chose est attestée de façon continue au sens de « l'en empêcher, l'en retenir » depuis au moins le milieu du XVIe siècle :
« Aquerir l'amitié [...] des Latins pour ne les arester de passer outre et poursuivre leur entreprise » (Jean Regnart, 1556), « [Qu'il plaise au roy] prester l'oreille aux plaintes et clameurs de son peuple pour les arrester de monter jusques au Ciel » (Remonstrances du Parlement, 1597), « Le groseiller desire [...] d'estre souvent tondu [...] pour l'arrester de monter trop hautement » (Olivier de Serres, 1600), « Qu'il arreste son œil de semer des desirs » (Agrippa d'Aubigné, avant 1630), « [La mort] l'a arresté de faire choses qui longuement peussent conserver sa memoire entre les hommes » (Nicolas Pasquier, avant 1631), « [Le manque de blé] les pouvoit arrêter de faire aucuns progrès » (Richelieu, avant 1642), « [La charité] bannit du cœur ou elle regne tout ce qui peut l'arrester de s'eslever au Ciel » (Bernardin de Paris, 1662), « C'est un frein qui nous arreste [...] de courir apres le peché » (Jacques Biroat, 1668), « Que rien ne t'arrête d'acomplir ton vœu » (La Sainte Bible, édition de 1687), « Je vous prie que [...] rien ne vous arrête de dire la messe » (Madame Guyon, avant 1717), « Qui que ce soit n'entreprendroit de les arrêter de le [= leur pasteur] suivre » (Robert Challe, 1721), « Rien ne pouvoit l'arrêter de passer en Italie » (Jacques Tailhé, 1755), « Rien ne l'arrête de passer le contrat que l'article des lods » (Budé de Boisi, 1758), « Rien ne nous arrêtera d'aller en avant » (Pierre-Zacharie Idlinger d'Espuller, 1762), « Rien ne m'arrête de m'acquitter envers Madame Rousseau de ce que je devais à son mari » (Michal Wielhorski, 1778), « Hâte-toi maintenant : que plus rien ne t'arrête D'aller droit au Beau-père » (Jean-Baptiste Avisse, 1797), « Que rien ne nous arrête D'approcher de l'époux » (Choix de cantiques, 1827), « Rien ne nous arrêtera d'insister là-dessus » (Feuille religieuse du Canton de Vaud, 1836), « Rien ne peut les arrêter de se rendre au lieu de réunion » (Samuel François Dentan, 1838), « Ceci ne devrait toutefois pas arrêter le gouvernement de tenter l'entreprise » (Revue de la Flandre, 1848), « Que rien ne les arrête De revenir au port » (Jules-Achille Sénéchal, 1858), « Rien ne m'arrête de le penser tout haut » (Émile Bergerat, 1880), « Rien ne l'arrêtait de les [= les pauvres] visiter » (Henri Monachon, 1890), « Il est aussi difficile de faire taire la presse que d'arrêter la terre de tourner » (journal La Justice, 1897), « Rien ne m'arrêtera d'aller recevoir de toi un enfant » (Ernest Daudet, 1912), « Que rien ne vous arrête de le suivre » (Bulletin de l'archidiocèse de Rouen, 1914), « Rien ne doit m'arrêter de préciser ce que je distingue » (André Rouveyre, 1933), « Que rien ne nous arrête d'être les témoins de la Vérité » (Louis Gourmaz, 1935), « J'arrête le sang de couler en mettant les mains en croix dessus » (Jean Gabus, 1935), « Rien ne l'arrêtait de mentir » (Emmanuel Bove, 1939), « Rien n'arrête un enfant de grandir » (André Rousseaux, 1942), « La conscience est destructrice, et rien ne l'arrête de détruire » (André Suarès, 1948), « Son intuition, que rien ne saurait l'arrêter de parfaire » (Raymond Bayer, 1953), « J'ai un mal de chien à l'arrêter de pleurer » (Jean Anouilh, 1955), « Rien n'arrête le jour de grandir » (Albert Ayguesparse, avant 1960), « Vous avez l'impression que vous pouvez arrêter l'eau de couler » (André Soubiran, 1967), « Rien ne peut l'[= un sanglot] arrêter de monter et de gonfler » (Claude Seignolle, 1984), « Jeanne ne peut l'arrêter de boire » (Henriette Jelinek, 1986). (4)
Le tour semble même connaître ces derniers temps un regain de faveur, sous l'influence probable de l'anglais to stop someone from doing something, parfois traduit par « arrêter quelqu'un de faire quelque chose » (501 French Verbs, 1982 ; 27 000 English-French Words Dictionary, 2018) (5).
2. Ensuite, parce que empêcher (« s'opposer à la volonté d'une personne, ne pas lui permettre d'agir comme elle l'entend ») semble moins pertinent que arrêter (« interrompre quelqu'un dans son action ») quand ladite action est déjà commencée (6). De là, sans doute, la tentation d'écrire : arrêter un enfant de pleurer (« faire que ses pleurs cessent ») plutôt que empêcher un enfant de pleurer (« faire qu'il ne puisse pas pleurer, éviter qu'il ne pleure »). Des usagers, partagés entre le respect des avis de l'Académie et le souci de la nuance, en viennent de bonne foi à privilégier la forme factitive faire arrêter : Il est difficile de faire arrêter un enfant de pleurer pour « il est difficile de faire qu'un enfant arrête de pleurer ». Ce faisant, ils rouvrent malgré eux un ancien débat : arrêter suivi d'un infinitif peut-il s'employer avec le sens de « cesser » ?
Non, avait d'abord répondu Hanse, rejoint par plusieurs disciples d'occasion (7).
« Arrêter ne signifie cesser que lorsqu'il est employé absolument, dans le sens de "cesser de marcher, de parler, d'agir" : Arrête ! (ou Arrête-toi). On ne peut donc dire : Il n'arrête pas de plaisanter. On dira : Il ne cesse (pas) de plaisanter » (Hanse, Dictionnaire des difficultés grammaticales et lexicologiques, 1949).
« Arrêter n'ayant pas le sens de "cesser de faire une chose", sauf quand il est employé d'une manière absolue, il faut dire : Il ne cesse pas de tousser (et non : Il n'arrête pas de tousser) » (Thomas, Dictionnaire des difficultés de la langue française, 1956).
« Arrêter de (ou s'arrêter de), suivi de l'infinitif. Ce tour, analogique de cesser de, est déconseillé. En revanche, l'emploi absolu est toléré » (Girodet, Pièges et difficultés de la langue française, 1986).
« Arrêter suivi d'un complément ne signifie pas "cesser de faire quelque chose" mais "interrompre ou faire cesser quelque chose". Il est donc plus correct de dire cesser de bavarder » (Françoise Nore, 2014).
Ces réserves ne laissent pas d'étonner, tant les contre-exemples sont légion depuis le milieu du XIXe siècle − non seulement dans la langue familière (dialogues de vaudeville, imitation du parler plus ou moins populaire), mais aussi dans l'usage courant et même littéraire :
« L'inconnu s'arrêta de parler » (Théophile Dinocourt, 1829), « Comment rester debout sous tant de ruines qui ne s'arrêtent pas de crouler ? » (George Sand, 1836), « Ses yeux n'arrêtaient pas de pleurer » (Joseph-Alexis Walsh, 1838), « Je n'arrête pas de travailler » (Adolphe d'Ennery et Clairville, 1845), « Je n'arrêtais pas de faire dire des messes » (Paul Lacroix, 1855), « J'peux pas m'arrêter de pleurer » (Adolphe Jaime, 1855), « Sans s'arrêter de parler » (Prosper Poitevin, 1856), « Il n'arrêta pas de discourir » (Flaubert [8], 1857), « Deux sexes, qui n'arrêtent pas de se dire mutuellement des sottises » (Eugène Hugot et Paul Boisselot, 1858), « La voix aigre d'une bouquetière qui n'arrête pas de crier» (Édouard Cadol, 1879), « La Maheude s'arrêta de crier » (Zola, 1885), « Voilà qu'elle s'arrête de rire » (Alphonse Allais, 1893), « Vous ne pouvez pas vous arrêter de pleurer » (Abel Hermant, 1899), « Arrêtez de me faire souffrir ! » (frères Tharaud, 1918), « Il n'a pas arrêté de parler » (Édouard Bourdet, 1923), « Ils n'arrêtaient pas de fumer » (Mauriac, 1923), « [Il semblait] s'être arrêté de vieillir vers soixante-dix ans » (Marcel Prévost, 1926), « Il n'a pas arrêté de vomir toute la nuit » (Gide, 1927), « Vous n'avez pas arrêté de sourire » (Jacques Deval, 1934), « Elle ne peut s'arrêter de courir » (Bernanos, 1936), « [Il] n'arrêtait pas de faire des plaisanteries » (Camus, 1942), « Elle s'arrête de rire » (Paul Valéry, avant 1945), « Qu'il arrête de me broyer les poignets » (Nicole Dutreil, 1949), etc.
De leur côté, les tenants de la position de Hanse ne manquent pas de se prévaloir de l'autorité des anciens. À leurs yeux, arrêter de ne peut signifier que « décider de » (selon le Dictionnaire du moyen français ou DMF) (9), « demeurer d'accord, convenir de » (selon le Dictionnaire historique de l'Académie) :
« J'arrestay de te choisir pour maistre » (Jean-Antoine de Baïf, 1573), « Ils arresterent premierement entre eux de combattre ; non pour vaincre, mais pour mourir » (Nicolas Coeffeteau, 1621), « On arrêta de créer pour ce prince un huitieme électorat et de lui restituer le bas Palatinat » (Condillac, 1775), « Après avoir bien examiné l'affaire, on arrêta de faire telle chose » (Dictionnaire de l'Académie, 1798-1878),
ne pas arrêter de, « ne pas manquer de » (selon le DMF) :
« Messieurs, allez vous tous disner, [...] Mais, s'il vous plaist, n'arrestez point De revenir » (Andrieu de la Vigne, 1496), « Je vous prie que pour moy vous n'arrestiez point d'executer vostre victoire » (Blaise de Monluc, avant 1570),
et s'arrêter de, « se contenter de, se borner à » (selon Godefroy), « se déterminer pour » (selon Wartburg) :
« Ils s'arrestent en cela de le souhaiter » (La Boétie, vers 1548), « Si je voulois icy m'arrester de vous descrire les gestes et faits des Seigneurs Saxons, [...] il m'en fauldroit faire un juste volume » (André Thevet, 1575), « Sans s'arrester de vouloir forcer le fort de Tergoviste » (Pierre Victor Palma Payet, 1608).
C'est oublier un peu vite que ces trois constructions sont également (quoique maigrement) attestées dans l'ancienne langue avec le sens de... « cesser » :
« Arrester de + inf., cesser de : Le gentil roy arresta un poy de parler (Jean le Bel, Vrayes Chroniques, manuscrit du XVe siècle) » (Heinz Studer, Étude descriptive du vocabulaire de Jean le Bel, 1971), « N'arrester de + inf., ne cesser de : Ilz n'arresterent en ceste nuyt de chevauchier (Perceforest, manuscrit du milieu du XVe siècle) » (Gilles Roussineau, Glossaire du Roman de Perceforest, 1979), « Cesser, ou arrester de faire quelque chose » (Christophe Plantin, Thesaurus Theutonicæ linguæ, 1573), « S'arrester de faire quelque chose, Desistere, Desinere, Cessare » (Robert Estienne, Dictionnaire françois-latin, édition de 1549), « Ladicte vescie s'arreste de faire son debvoir » (Isaac Brochart des Affix, 1612), « Il ne doit point s'arrester de faire ce qu'il estimera à propos » (Richelieu, 1639).
Démenti par l'usage ancien comme par l'usage moderne, Hanse n'eut d'autre choix, trente ans plus tard, que de faire marche arrière :
« Arrêter et s'arrêter peuvent signifier, en emploi absolu, "cesser d'avancer" ou "cesser d'agir" : Il m'a crié d'arrêter. Arrête ou Arrête-toi. L'autobus s'arrête. Devant de et un infinitif, arrêter et s'arrêter peuvent fort bien signifier aussi "cesser" [!] : Arrête de faire l'idiot. Il n'arrête pas de fumer. Il s'arrête de parler » (Nouveau Dictionnaire des difficultés du français moderne, 1983).
L'Académie attendit 1992 pour se ranger à ce nouvel avis : « Arrêter de, s'arrêter de, cesser de. Elle n'arrête pas, elle ne s'arrête pas de récriminer » (neuvième édition de son Dictionnaire).
L'histoire aurait pu s'arrêter là... mais c'était compter sans la résistance des esprits chagrins, lesquels cherchèrent à introduire des distinctions (parfois contradictoires) tantôt entre arrêter de et s'arrêter de :
« La couleur familière ou populaire de la première expression ne vient pas sans doute que de la prohibition qui pèse sur elle. On peut admettre d'ailleurs que s'arrêter de… prenne un aspect moins vulgaire. Comme il n'existe aucune raison à ce privilège, on pensera que simplement le tour, étant plus rare, paraît plus distingué. Mais il est vraiment impossible de réserver au pronominal s'arrêter l'indulgence qu'on refuse à arrêter. Mieux vaut la répandre sur les deux verbes » (André Thérive, Procès de langage, 1962),
« L'erreur commune est d'employer ce verbe [arrêter] au sens de cesser, qui demanderait le pronominal s'arrêter » (Henry de Julliot, Le Bon Langage, 1970),
« S'arrêter de + infinitif n'est pas correct ; il faut dire arrêter de + infinitif [...] : Nous devons arrêter de fumer (et non : nous arrêter de fumer) » (Jean-Paul Jauneau, N'écris pas comme tu chattes, 2011),
tantôt entre (s')arrêter de et cesser de :
« Cesser de et arrêter de appartiennent à des niveaux de langue différents. Cesser de est plus littéraire, arrêter de est plus familier » (Dupré, 1972),
« Cesser de serait plus littéraire [que arrêter de] » (Michèle Lenoble-Pinson, 2009),
« Dans l'expression soignée, on peut remplacer [arrêter de] par cesser de : j'ai cessé de fumer » (Larousse en ligne).
Le linguiste Jean-Jacques Franckel souligne notamment que, avec l'auxiliaire avoir, arrêter de et cesser de ne sont pas équivalents : « J'ai arrêté de le voir implique une intentionnalité, alors que j'ai cessé de le voir peut signifier qu'un objet a disparu de mon champ de vision » (Études de quelques marqueurs aspectuels du français, 1989). Et il ajoute : « Par conséquent, [...] seul cesser de est compatible avec un tour impersonnel : il a cessé de pleuvoir / ?il a arrêté de pleuvoir. » Il semblait pourtant à Hanse que « l'emploi impersonnel il n'arrête pas de pleuvoir [était] aussi correct que il cesse de » (1983)...
Vous l'aurez compris : il serait temps que les spécialistes de la langue arrêtassent de jouer avec nos nerfs et accordassent leurs violons.
(1) Et non pas Voltaire, comme on peut le lire çà et là.
(2) Il convient ici de préciser que la critique du Mercure de France ne porte pas sur la présence du complément d'objet direct (m'), mais sur la construction arrêter de + infinitif proprement dite : « On ne dit plus arrêter de faire quelque chose. » Celle-ci figure pourtant dans le Dictionnaire (1787) de Féraud et dans la cinquième édition (1798) du Dictionnaire de l'Académie... mais avec le sens de « demeurer d'accord, convenir de », comme nous le verrons par la suite.
(3) Curieusement, la remarque a disparu des éditions suivantes, sous la houlette d'André Goosse.
(4) Signalons également la variante avec arrêter pris cette fois au sens de « décider, déterminer » et suivi de la forme négative de l'infinitif (littéralement : « décider quelqu'un à ne pas faire quelque chose », d'où « le retenir, l'empêcher de faire quelque chose ») : « [Pour] l'arrester de ne rien entreprendre contre nous » (Lettres missives d'Henri IV, 1602), « S'il y a quelque difficulté qui le peut arrester de ne m'accorder pas ce que je souhaitte tant » (Gabriel Chappuys, 1608), « Ce qui nous arreste de ne faire deçà glisser plus avant la plume » (Jacques Severt, 1623).
(5) Cela pourrait expliquer la sur-représentation dudit tour sous les plumes québécoises : « Rien ne pouvait l'arrêter de parler » (Germaine Guèvremont, 1947), « Je voudrais arrêter la terre de tourner » (Élaine Audet, 1958), « Rien ne peut l'arrêter de trembler » (Julien Bigras, 1979), « J'ai arrêté le sang de couler » (Yves Thériault, 1980), « Pour arrêter une plaie de saigner » (Emmanuel Rioux, 1997), « Rien ne peut l'arrêter de glisser sur cette pente de dangerosité » (Guylaine Massoutre, 2007), « Il arrêta la pluie de tomber » (Anne Robillard, 2016), etc.
(6) « Arrêter signifie faire cesser l'action commencée » (Pierre-Benjamin Lafaye, Dictionnaire des synonymes, 1884).
(7) Hanse, au demeurant, ne fut pas le premier à avoir une dent contre cet emploi. Jugez-en plutôt : « Ne pas arrêter de faire quelque chose est de la langue vulgaire » (Emil Rodhe, Les Grammairiens et le français parlé, 1901), « Autre erreur peu distinguée dans Les Faux-Monnayeurs de M. André Gide : Une chose à laquelle, depuis des mois, je n'arrêtais pas de penser. Je préférerais : je ne cessais pas » (André Moufflet, Encore le massacre de la langue française, 1935).
(8) « C'est un des endroits où [Flaubert] parle normand sans s'en apercevoir », note Paul Eugène Robin dans son Dictionnaire du patois normand (1879).
(9) « Arrête de faire cela ne peut avoir qu'un sens correct : décide de faire cela, et non cesse de » (Henry de Julliot, Le Bon Langage, 1970).
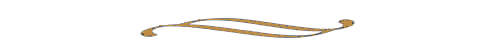
Remarque 1 : Selon André Thérive, « l'assimilation d'arrêter à cesser fut toujours naturelle en français. Elle était admise au sens absolu, intransitif [...] : Arrêtez tout court signifiait bien "cessez d'agir ou de parler" [...]. C'est donc bien artificiellement qu'on a proscrit arrêter de… au sens de cesser de… » (Procès de langage, 1962). Le Dictionnaire historique de la langue française (celui d'Alain Rey) confirme que la première valeur de arrêter intransitif est « cesser d'avancer, de marcher », tout en apportant la précision suivante : « S'arrêter de et infinitif correspond à cesser de ; cet emploi a été repris avec l'intransitif (arrêter de faire quelque chose), avec une valeur spéciale au négatif, qui correspond à "continuer, faire sans cesse" (il n'arrête pas de...). » Le hic, c'est que la chronologie avancée (s'arrêter de, puis arrêter de) n'est pas confirmée par les faits.
Par ailleurs, il est permis de supposer que, sous l'influence de arrêter quelqu'un de faire quelque chose (« l'en empêcher »), s'arrêter de faire quelque chose ait pu être interprété en « empêcher soi-même de faire quelque chose », d'où « cesser de ».Remarque 2 : Selon André Goosse (Le Bon Usage, 2011), arrêter de au sens de « cesser de » est courant à l'impératif et dans les propositions négatives, mais « relativement rare » sans la négation. Dupré, en 1972, s'en tenait prudemment à « moins fréquent »... L'Académie, quant à elle, se distingue en proposant dans la dernière édition de son Dictionnaire plus d'exemples à la forme affirmative qu'à la forme négative : « S'interrompre, arrêter de faire quelque chose » (à l'article « interrompre »), « Paul a arrêté de fumer » (à l'article « présupposé »), « Il avait arrêté de jouer » (à l'article « rechuter »).
Remarque 3 : Il convient de noter avec Knud Togeby que de est préposition dans s'arrêter de, mais indice de l'infinitif (COD) dans arrêter de.
Remarque 4 : Pour ne rien simplifier, (s')arrêter a pu aussi construire l'infinitif complément avec la préposition à. Le tour est attesté avec plusieurs acceptions, qu'il n'est pas toujours facile de distinguer et de déterminer :
- « tarder à » (selon Godefroy et le Dictionnaire historique de l'Académie) : « Il n'arresta pas long temps a recevoir le salaire deu a tels monstres » (Henri Estienne, 1566), « Je n'arresteray jamais a vous advertir de tout ce je pourray entendre » (Blaise de Monluc, 1569),
- « borner à » (selon Godefroy) : « J'arreste mon envie A ne servir qu'un prince » (Corneille, 1660),
- « retenir, occuper à » (selon le Dictionnaire historique de l'Académie) : « Une goutte [...] qui vous arreste huit jours à manger des figues et des melons » (Vincent Voiture, avant 1648),
- « s'attarder à » (selon le DMF et le TLFi), « s'arrêter [au sens propre] pour » (selon Togeby) : « Seroit ce [...] chose vaine et pou profitable soy arrester a reciter et reprouver tous les opinions qui ont esté en ceste matere » (Nicole Oresme, vers 1370), « S'arrester a penser choses honnestes » (Robert Estienne, 1539), « Puis-je m'arrêter à vous parler des progrès de la raison [...] ? » (Condorcet, 1784), « La dame au mezzaro s'était arrêtée dans la rue à questionner quelqu'un » (Prosper Mérimée, 1840), « Il s'arrêtait à reprendre haleine » (Flaubert, 1857), « Je m'arrête pendant quelques instants à écouter la conversation de deux consommateurs » (Ludovic Halévy, 1872), « Cette troublante créature est si connue qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à décrire ici sa beauté » (Ernest Daudet, 1891)... et encore de nos jours : « S'arrêter à exposer les faits de l'espèce » (Jacques Picotte, Juridictionnaire, 2009),
- « se restreindre, se borner à » (selon le Grand Larousse du XIXe siècle), « fixer son comportement dans une certaine attitude, s'appliquer à » (selon Annie Bertin) : « En peché ne veulx assister Jamais […] Në a mal faire m'arrester » (Andrieu de la Vigne, 1496), « Qu'il [= l'homme] ne s'arreste donc pas à regarder simplement les objets qui l'environnent. Qu'il contemple la Nature entiere » (Pascal, avant 1662),
- « se déterminer à » : « Il s'arrête à en attribuer la possession [d'un patrimoine] à cet aîné » (Joseph de Pesquidoux, 1937).
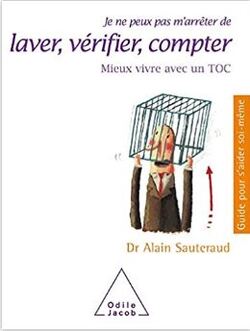
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Marc81 le 6 Décembre 2022 à 21:14
Rarement verbe aura donné autant de fil à retordre aux grammairiens et aux lexicographes. Il n'est que d'interroger lesdits spécialistes sur la construction de l'intéressé pour mesurer l'étendue de leurs désaccords :
« Augurer, verbe transitif direct » (Hanse, 1987 ; Bescherelle La Conjugaison pour tous, 2019).
« Augurer, verbe intransitif [au sens de "qui n'admet pas de complément d'objet"] » (Le Bescherelle pratique, 2006).
« Lorsque le verbe augurer est suivi d'un complément, les grammairiens (en tout cas, ceux qui parlent de ce point de grammaire) prônent la construction avec la préposition de (du, de la…) : Cela augure mal du résultat final. La forme transitive directe ne semble pas être donnée » (Jean-Pierre Colignon, 2020).
Allez vous étonner, devant pareille cacophonie, que le commun des mortels ne sache plus à quel augure se fier ! « Que faut-il dire : "Cela augure d'une situation compliquée" ou "Cela augure une situation compliquée" ? », « J'ai vu à deux reprises dans la presse, qui n'est certes pas un maître pour le bien parler, que le verbe augurer était employé intransitivement. Ne doit-on pas dire augurer l'avenir ? », « Augurer est un verbe transitif direct. On ne dit pas "augurer de quelque chose" mais "augurer quelque chose" », « Contrairement à ce que l'on peut entendre autour de soi, le verbe augurer est transitif indirect, c'est-à-dire qu'il nécessite l'ajout de la préposition de devant son complément d'objet. On augure DE quelque chose », lit-on sur les forums de langue...
Les sibylles, pythonisses et autres prophétesses consultées à distance (quelques kilomètres à peine, à vol d'oiseau) seront au moins d'accord sur un point : une clarification s'impose.Employé au sens de « pressentir, prédire, conjecturer » − donc avec un nom de personne comme sujet −, augurer est un verbe transitif direct, tout comme son compagnon d'infortune et synonyme présager : « J'augure un heureux butin et une heureuse conquête ! » (Georges Duval, 1909), « Il inclinait à présager le pire » (Paul Valéry, 1938). Il n'est pas rare cependant que le complément d'objet direct soit accompagné d'un second complément, généralement introduit par la préposition de et désignant tantôt le signe, l'évènement d'après lequel on forme la prévision, tantôt la chose ou la personne à laquelle se rapporte ladite prévision : quelqu'un augure / présage quelque chose de quelque chose ou de quelqu'un.
(Avec de = "d'après") « De ce soupir que faut-il que j'augure ? » (Racine, 1674), « De ce premier succès, j'augure la réussite de votre projet. Qu'augurez-vous de son attitude ? − Je n'en augure rien de bon » (Larousse en ligne), « Nous pouvons augurer son succès de ses premiers essais ; nous pouvons en augurer son succès » (Grand Robert) ; « On peut de ces temperatures de l'air presager que l'année suivante sera abondante » (Noël Chomel, 1709), « Des premiers résultats, il présage la victoire » (neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie), « Nous présagions cette éventualité des nouvelles qui nous sont parvenues » (Larousse en ligne), « Je ne présage rien de bon de son silence prolongé » (Girodet).
(Avec de = "à propos de") « Je voudrais bien savoir ce que vous augurez de mon avenir » (Victor Hugo, 1826), « Voilà ce que vous augurez de moi ! » (George Sand, 1845), « Je ne sais quoi augurer des heures qui vont suivre » (Patrick Grainville, 1986), « Augurer quelque chose de (= à propos de) quelque chose ou quelqu'un » (TLFi) ; « On pouvait tout présager de lui dès ce jeune âge » (Louis Baunard, 1886), « Je ne présageais rien de bon de ce rendez-vous » (Alfred Fabre-Luce, 1957).
Ce second complément est-il un complément d'objet (indirect) ? Oui, selon Togeby et Blinkenberg, qui présentent respectivement augurer comme un verbe « doublement transitif » (c'est-à-dire susceptible de prendre à la fois un objet direct et un objet indirect) et comme un verbe « à objet tantôt direct, tantôt indirect ». Non, selon Girodet qui, s'exprimant sur la syntaxe du verbe présager, y voit un « complément [circonstanciel] d'origine ou de cause ». Plaide, me semble-t-il, en faveur de cette dernière analyse l'existence de constructions avec d'autres prépositions (ou locutions prépositives) que de pour introduire ce qui autorise ou ce sur quoi porte la prévision :
(avec à) « [Il] augura leur future grandeur à leur modestie » (Nicolas Perrot d'Ablancourt, 1651), « J'augure à certains signes que le temps nous est désormais étroitement mesuré » (Anatole France, 1912) ; « On peut présager à certains signes à peu près infaillibles si la vérole sera forte ou faible » (Melchior Robert, 1861) ;
(avec à partir de) « Louis XIV [...] pouvait augurer à partir des dépêches de Constantinople [...] qu'il y avait de très fortes chances pour que [...] » (Le Soleil, l'aigle et le croissant, 1983) ; « Aussi n'est-il pas illicite de présager [les] événements futurs à partir de leur cause » (traduction de la Somme théologique de Thomas d'Aquin, aux éditions Eslaria, 2013) ;
(avec d'après) « J'augure d'après votre lettre que vous vous portez bien » (Anatole France, 1917) ; « À ce qu'on peut présager d'après les signes que nous voyons » (Pierre Grappin, 1943) ;
(avec par) « Augurer la grandeur future d'un monarque par les circonstances qui accompagnerent son entrée au monde » (Gabriel Seigneux de Correvon ?, 1760), « On y faisait galoper de jeunes poulains, afin d'augurer par leur course à quel parti resterait la victoire » (Pierre-Michel-François Chevalier, 1844) ; « Un avocat, seul compétent pour présager, par l'étude des décisions anciennes, la décision prochaine du juge actuellement constitué » (Élie Halévy, 1901) ;
(avec sur) « Il y en eut qui auguroient sur ledict brouillard qu'il signifioit qu'on alloit prendre terre dans un royaume brouillé » (Brantôme, avant 1614), « Je ne crois pas que l'on puisse rien augurer sur des signes si différents » (Joseph Adde-Margras, 1855) ; « Les connaisseurs [...] n'osaient rien présager sur l'issue de ce combat » (Gustave Aimard, 1864). (1)
Dans le doute, mieux vaut prudemment parler de « complément indirect », notion fourre-tout de la grammaire moderne, qui regroupe les compléments d'objets indirects et certains compléments circonstanciels de la grammaire traditionnelle.
Mais laissons là cette question de terminologie et venons-en au cas où le COD est supprimé et le second complément maintenu. Le verbe est alors employé « absolument » (dixit Poitevin, Littré et Rey) au sens de « tirer un augure, un présage ; faire des prédictions » et, le plus souvent, modifié par un adverbe qualitatif précisant si lesdites prédictions sont bonnes ou mauvaises : quelqu'un augure / présage bien (mal, mieux, favorablement...) de quelque chose ou de quelqu'un.
(Avec de = "d'après") « J'augure bien des premiers résultats atteints jusqu'ici » (Hanse), « J'augurai bien de sa phisionomie et de ses civilitez » (abbé Prévost, 1731).
(Avec de = "à propos de") « J'augure bien du résultat définitif » (Hanse), « Augurer favorablement de l'évolution d'une maladie » (neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie), « J'augure mal de la suite de cette aventure » (Girodet), « J'augure mal de cette rousse bien faite [...], mais d'une laideur flagrante » (Colette, 1900) ; « On présage mal de ce voyage » (Edmond Jean François Barbier, 1722), « Je présage bien du jeune artiste » (Le Constitutionnel, 1818). (2)
Aucun doute cette fois pour Andreas Blinkenberg : « Combiné avec bien ou mal, le verbe [augurer] s'emploie avec un objet indirect, introduit par de » (Le Problème de la transitivité en français moderne, 1960). À tant faire que d'alimenter la querelle des grammairiens, le romaniste danois aurait dû aller au bout de son raisonnement et évoquer le cas, plus troublant encore, où ledit tour est employé sans l'adverbe attendu : augurer / présager de quelque chose. Mais non, pas un mot.
Blinkenberg, au demeurant, n'est pas le seul à être pris en flagrant délit d'omission. Le TLFi, pour ne citer que l'ouvrage le plus détaillé sur la syntaxe des verbes, n'évoque pas davantage la construction indirecte sans adverbe. Celle-ci n'est pourtant pas inconnue de nos spécialistes :(avec augurer) « Combinaison de cartes que des personnes superstitieuses essayent pour augurer du succès [pris au sens neutre de « résultat »] d'une entreprise, d'un vœu, etc. » (Bescherelle, 1846 ; Complément du Dictionnaire de l'Académie, 1847 ; Littré, 1863 ; Grand Larousse, 1875 ; à l'article « réussite »), « Jeu de cartes [...] que l'on utilisait autrefois comme procédé divinatoire, afin d'augurer du succès d'une entreprise, d'un vœu » (TLFi, à l'article « réussite ») − à comparer avec : « Les Grecs, qui s'étoient entêtés du cottabe [jeu d'adresse consistant à jeter le fond d'un verre dans un récipient], auguroient bien ou mal du succès de leurs amours, par la manière dont il leur réussissoit » (Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 1754 ; à l'article « cottabe ») ;
(avec présager) « Vivre [dans l'incertitude], sans pouvoir présager de l'avenir » (TLFi, à l'article « branche »).
N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure, le tour augurer / présager de quelque chose n'a rien que de très correct ; il ne se prête simplement pas à la même analyse que augurer / présager quelque chose : ici, le verbe est pris dans son sens transitif et suivi de l'accusatif de la chose prédite ; là, il est employé dans son sens absolu et suivi d'un complément indirect indiquant la chose sur laquelle porte la prévision (plus fréquemment, soit dit en passant, que la chose à l'origine de la prévision). Seul le sens permet donc de déterminer si la préposition est requise ou non : est-il question de concevoir des espérances ou des craintes sur une chose ? ou bien de la prédire, de l'annoncer ? Comparez :
« Il n'étoit pas difficile d'augurer [= prédire, annoncer] ce qui arriva par la suite » (Charles-Jean-François Hénault, avant 1770) et « Ce n'est pas une raison pour que désormais le médecin ne tienne compte que de la dynamoscopie pour augurer de [= faire des conjectures, bonnes ou mauvaises, sur] ce qui arrivera du malade » (Léo Collongues, 1862).
« J'augurois sa gloire et ses succès » (Charles Frey de Neuville, 1776) et « Interroge tes cartes. Tu t'en sers bien pour augurer du succès d'un vœu, d'une entreprise ! » (Bernard Waller, 1980).
« Elle augurait un avenir favorable [= tel était son pressentiment] » (Anatole France, 1899) et « Il est trop tôt pour augurer de l'avenir [= pour savoir de quoi l'avenir sera fait] » (Bernadette Cailler, 1988).
« J'ose présager un brillant avenir à [telle] méthode » (Alphonse Toussenel, 1872) et « Je ne pouvais présager de l'avenir, mais d'ici une trentaine d'années, quand j'aurais atteint l'âge de Jansen, je ne répondrais plus au téléphone » (Patrick Modiano, 1993).
« Je présage des choses très extraordinaires en Hollande » (Charles-François de Bonnay, 1805) et « Le voicy Qui praesagist de toutes choses [= qui fait des prédictions sur toutes choses] » (Rabelais, avant 1553). (3)
Mais là n'est pas le seul écueil que nous réserve notre duo infernal. Selon la commission du Dictionnaire de l'Académie, augurer et présager « sont synonymes mais n'admettent pas les mêmes sujets. Présager peut avoir comme sujet des personnes ou des choses, contrairement à augurer, dont le sujet ne peut être qu'une personne [seule douée d'une faculté de prédiction] ; Littré écrivait d'ailleurs : "Les choses n'augurent pas" » (Dire, ne pas dire, 2016). C'est, me semble-t-il, aller un peu vite en besogne...
Que dit exactement Littré ?
« Le présage est également le signe qui est dans la chose considérée, et le pronostic que nous en tirons. L'augure n'est que le pronostic. Nous présageons, et les choses présagent ; nous augurons, mais les choses n'augurent pas. Ainsi, en parlant du temps, on dira : les présages visibles au ciel, et les présages qui nous viennent à l'esprit en le considérant ; mais, en parlant d'un événement, on dira bien : l'augure que j'en tire ; mais on ne dira pas : l'augure qui y est manifeste. C'est en cet emploi qu'est la différence entre augure et présage » (Dictionnaire de la langue française, 1863).
À y regarder de près, cette distinction, établie dès 1785 par l'abbé Roubaud (4) et reprise par plus d'un spécialiste au XIXe siècle (Laveaux, Bescherelle, Lafaye, Littré...), paraît bien artificielle, quand on songe que, en latin déjà, augurium comme praesagium possédaient les deux acceptions : « Augurium, (en général) prédiction, prophétie ; le présage lui-même, le signe qui s'offre à l'augure » (Dictionnaire latin-français de Félix Gaffiot), « Praesagium "connaissance anticipée, prévision, pressentiment" et, par métonymie, "signe permettant de prévoir l'avenir" » (Dictionnaire historique). La métonymie latine est passée en français, au plus tard au milieu du XVIe siècle comme l'attestent les exemples suivants : « Le bon heur d'un augure Venant du ciel pour signe tres heureux » (Ronsard, 1572), « L'augure est visible et manifeste [n'en déplaise à Littré !] » (Nicolas Gueudeville traduisant Plaute, 1719), « Jupiter lui avait manifesté sa volonté par un augure manifeste (expressions de Julien dans sa Lettre aux Athéniens) » (Émile Lefranc, Histoire romaine, 1846), « On y voit [dans ces applaudissements] l'augure de l'union du pouvoir et du peuple » (Alphonse de Lamartine, 1847), « Cet astre souverain [...], c'est l'augure, l'augure manifeste des destinées glorieuses de Rome » (Eugène Fallex, Anthologie des poëtes latins, 1878). Depuis lors, le sens de « signe annonciateur » est consigné dans la plupart des ouvrages lexicographiques : « Augure, pour signe ou presage, augurium » (Dictionnaire françois-latin de Jean Thierry, 1564 ; de Jean Nicot, 1573), « Il se dit et du signe et de l'interprète » (Dictionnaire critique de Féraud, 1787), « Le signe lui-même. Synonyme auspice » (TLFi), « Ce qui semble présager quelque chose ; signe par lequel on juge de l'avenir » (Robert en ligne) et − un comble ! − « Présage, signe par lequel on juge de l'avenir » (Dictionnaire de l'Académie, depuis 1740).
De la même époque datent les plus anciennes attestations que j'aie pu relever du verbe augurer employé avec un sujet non humain, au sens de « être le signe de, annoncer (une chose à venir) » :
« Par un vol trop frequent d'orfrayes, de corbeaux, De huppes, de chahuants, qui sinistres oiseaux N'augurent rien de bon » (Pierre de Brach, 1576), « Ainsi que la comete, en un ciel obscurcy, Presage la ruyne, augure le tonnerre » (Loÿs Papon, 1588), « Mais tout si tu vois clair du malheur nous augure » (Antoine de Montchrestien, 1604), « Tel changement n'augure rien de bon au public » (André de Nesmond, avant 1616), « Cela auguroit la grande calamité qui arrivoit en suitte » (Claude Malingre, 1630), « [Un mortel accident] de nostre famille augure la ruine » (Jean Mairet, 1636), « Cela n'augure rien de bon » (Louis de Fontenettes, 1652), « Tout ceci n'augure rien de bon » (Guy Miège, 1688), « Il crut que cet événement auguroit quelque chose de grand » (Edme Baugier, 1721), « Les presages des mots et des noms étoient lorsque le nom qui se presentoit auguroit quelque chose de bon ou de sinistre » (Bernard de Montfaucon, 1722), « Cela nous augure telle chose » (Grégoire de Rostrenen, 1732), « Cette espece de dévotion sévere et misantrope, qui augure mal de son prochain » (Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts, 1735) − il est à noter qu'on retrouve là les mêmes constructions qu'avec un sujet humain.
Partant, on peine à comprendre pourquoi l'Académie, qui admet de longue date l'emploi de augure au sens métonymique de « signe annonciateur » (« Cet évènement est un bon augure, est d'un bon augure, est de bon augure », lit-on encore dans la dernière édition de son Dictionnaire), se réclame aujourd'hui de Littré pour préconiser le recours à une périphrase factitive ou au verbe présager plutôt que de construire augurer avec un nom de chose comme sujet : « On pourra donc dire : son apparition laissait (faisait, permettait d') augurer une catastrophe, on augura une catastrophe à son apparition, son apparition laissait (faisait, permettait de) présager une catastrophe ou son apparition présageait une catastrophe, mais non : son apparition augurait une catastrophe » (Dire, ne pas dire, 2016).
On ne comprend pas davantage les soupçons d'anglicisme que nos amis québécois font peser sur cet emploi de augurer : « Augurer [est] mis à tout propos pour présager [...]. On dit : "Telle chose augure bien" pour "on augure bien de..." » (Arthur Buies, Anglicismes et canadianismes, 1888), « Prêter à augurer cette acception de présager [« faire prévoir par quelque indication »], c'est commettre un anglicisme : le verbe anglais to augur exprime également l'action des personnes qui augurent et celle des choses qui présagent » (Gérard Dagenais, Dictionnaire des difficultés de la langue française au Canada, 1967) (5). Pas certain, sur ce coup-là, que les Anglais aient tiré les premiers...
Hanse, de son côté, a le mérite de reconnaître la correction séculaire d'une phrase comme : « Son attitude augure une collaboration fructueuse », mais il ajoute : « Tour vieilli. On dit plutôt : laisse augurer. » Vieilli, ledit tour ? Qu'on en juge :
« Ce début dans la vie me semble bien mal augurer de la suite » (Jean Dutourd, 1965), « Une pluie fine et molle qui n'augurait rien de bon » (Victor-Lévy Beaulieu, 1974), « Ces appréciations [...], qui auguraient assez mal des découvertes en Orient de l'archéologue et de l'historien d'art » (Jean d'Ormesson, 1982), « Voilà qui augure bien mal de la nuit de noces ! » (Juliette Benzoni, 1985), « Au moins, cela augurait bien de la nuit qui viendrait » (Claude Duneton, 1991), « La bonne grâce chanceuse qui vous caractérise, et qui augurait bien de votre venue parmi nous » (Bertrand Poirot-Delpech, 1999), « Cette solitude qui en augurait une autre » (Véronique Olmi, 2011), « Que le terme orthographe soit lui-même irrégulier, cela augure mal et fait un peu désordre ! » (Bernard Cerquiglini, 2012), « Les chuchotis d'entourage n'augurent rien de bon » (Marc Lambron, 2014), « Tout cela augurait mal du XXVIIIe Congrès » (Hélène Carrère d'Encausse, 2015), « [Il] avait goûté l'échantillon de rosé [...] sans déplaisir, ce qui augurait une commande » (Angelo Rinaldi, 2016), « Avec une jubilation qui augurait le pire » (Didier van Cauwelaert, 2016), « Cette décision symbolique augure mal des temps à venir » (Jean-Marie Rouart, 2017), « Ce message augurait le pire pour nous tous » (Éliette Abécassis, 2018), « Neuf fois sur dix, les éclipses, les étoiles filantes ou les halos bizarres augurent des désastres » (Éric-Emmanuel Schmitt, 2021), « Divorce entre le substantif [fraternité] et l'adjectif [fraternel] qui augurait bien mal de leur Révolution » (Erik Orsenna, 2021), « Cela augurait une relation plus longue que d'habitude » (Marc Dugain, 2022).
« Ce début augure mal » (TLFi, à l'article « promettre »), « Ces résultats augurent bien, mal de l'avenir » (Le Bescherelle pratique, 2006), « Tout cela n'augure rien de bon » (Larousse en ligne), « Tout ceci n'augure pas bien de la suite » (Robert en ligne).
Vous l'aurez compris : il en va, là encore, de augurer comme de présager. Autrement dit, le choix nous est laissé d'écrire, avec ou sans semi-auxiliaire : quelque chose augure / présage quelque chose (ici, le verbe est pris au sens de « être le signe annonciateur de ») ou quelque chose laisse (fait) augurer / présager quelque chose (là, le verbe est pris au sens de « prévoir »). Comparez : « Son attitude augure (ou, plus courant, laisse augurer) de bonnes relations futures » (Larousse en ligne) et « Son silence présage souvent une explosion de colère », « Cet incident ne laisse rien présager de bon » (neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie).
Est-il besoin de préciser, cela dit, que rien n'empêche ceux qui le souhaitent de se conformer aux recommandations de l'Académie et de réserver augurer aux sujets animés ? Encore leur faudra-t-il ne pas commettre d'impair au moment de construire son complément... Ils écriront donc de préférence : j'augure bien de la suite, cela présage bien de la suite, cela présage une suite favorable, cela laisse augurer une suite favorable, la suite s'annonce bien... et se garderont d'imiter les exemples suivants : « Un premier roman écrit avec une sûreté qui laisse augurer d'une très belle carrière » (Pierre Moinot, 1999), « Voilà qui augure bien les choses » (Jean Rinaldi, 2007), « Rarement en Russie succession d'un souverain à un autre se révéla plus aisée, ce qui semblait augurer d'un règne heureux » (Hélène Carrère d'Encausse, 2013), « Tout cela présageait d'un avenir meilleur, tour fautif pour Tout cela présageait un avenir meilleur » (Girodet).
Mais brisons là. De ce (saint) augure on ne va pas faire tout un fromage !
(1) On relève encore d'autres compléments, introduits par :
- à (sur le modèle de annoncer quelque chose à quelqu'un) : « Quand les Candiens vouloient augurer un grant mal à quelqu'un » (Claude Gruget, 1557), « Quoi qu'on nous augure et qu'on nous fasse craindre » (Malherbe, 1615), « J'eus droit d'augurer à la Suède une félicité [éternelle] » (Simon Arnauld de Pomponne, avant 1699), « Ce n'est pas qu'il manquât de sceptiques pour augurer à ce nouveau pacte le sort de ses aînés » (Louis Reybaud, 1848), « Je vous augure tous les biens que vous méritez » (George Sand, 1853) ; « Cette horrible catastrophe que je vous ai présagée depuis si longtemps » (Marat, 1790), « Ils ont trop beau jeu à nous présager des malheurs » (Anatole France, 1905) ;
- pour (sur le modèle de tirer un bon, un mauvais augure de quelque chose pour quelqu'un) : « Je n'ai garde d'augurer une si glorieuse destinée pour le glossaire françois » (La Curne de Sainte-Palaye, 1763), « Il se fait une maligne joie d'augurer pour moi un échec » (Balzac, 1849), « C'est donc un avenir de loyauté et de fidélité que j'augure pour vous » (R. P. Constant, 1885) ; « Je présageais pour nous un avenir fort triste » (Augustin Boyer d'Agen, 1896).
De là des constructions complexes à trois compléments : « Je félicite M. Bochart de l'achèvement de son travail et lui en augure un grand accroissement de réputation » (Jean Chapelain, 1663), « Je n'augure rien de bon pour elle de ce voyage là » (Id., 1666), « Que peut-on augurer pour notre littérature de ce goût mesquin ? » (Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts, 1765), « Ce que vous dites n'est que trop vrai [...] et j'en augure un bon succès pour l'objet de ma mission » (Voltaire, avant 1778) ; « Je n'en presage rien de bon pour [...] » (Jean-Pierre Camus, avant 1652).
(2) Exemples de cette construction avec d'autres compléments : « Il n'a jamais eu l'imagination bien vive [...], mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire [= de son jugement] » (Molière, 1673), « J'augure bien pour vous du trouble de leur ame » (David Augustin de Brueys, 1699), « Chacun augure favorablement pour soi » (Jean-Baptiste Massillon, avant 1742), « Sur ce que je vois, j'augure bien de vous » (François Andrieux, 1822), « Vous me faites plaisir de me parler ainsi, et j'en augure bien pour le sort d'Edmond » (Alexandre Dumas, 1846), « Vous pouvez augurer mieux, pour vos intérêts, de l'avenir que du passé » (George Sand, 1862) ; « Il présage bien de ce choix pour cellui qui devra être fait en députés » (Archives historiques du département de la Gironde, 1791).
À l'inverse, le tour augurer / présager bien (mal...) est attesté sans complément au sens de « faire des prédictions exactes (fausses) » ou de « avoir un pressentiment (favorable, défavorable) » :
« Mais si j'augure bien [...], mardy ne sera pas Si mouillé qu'aujourd'huy » (Ronsard, 1584), « [Louys de] Bretailles n'auguroit pas mal » (Jean de Serres, 1597), « J'en ai, si j'augure bien, Un infaillible moïen » (Henri Richer, 1729), « J'étois consterné de cette prédiction [...]. Aujourd'hui, j'augure mieux » (Paul-Louis de Bauclair, 1765), « Vous avez auguré vrai » (Restif de La Bretonne, 1778), « La Fayette lui-même augurait mieux » (Denys Cochin, 1912), « Condamnés à ne voir ni ne toucher rien, nous devons augurer juste » (René Boylesve, 1924) ; « Et si je présage bien, [ils] arriveront bientôt » (Léon Boucher, 1874).
(3) Autres exemples de cette construction indirecte : « On dut augurer par la hardiesse et la force de son coup d'essai, de ce qu'il pouvait faire » (Joseph Naudet, 1825), « Ils augurent, d'après leurs cris, du succès de la bataille » (Charles Cayx, 1836), « [Je] m'en rapporte aux faits visibles pour augurer des volontés de Dieu » (Adolphe Thiers, 1848), « Ne faut-il pas examiner le présent pour augurer de l'avenir ? (George Sand, 1871), « [Des princes de la science] arrivaient sur le terrain avec des dispositions d'esprit que je trouvais profondément indépendantes, acérées, agressives même. Et j'augurais d'un beau tournoi » (Georges Duhamel, 1918), « On se gardera bien, sur le seul examen des titres, d'augurer de la nature des ouvrages » (Bernard Quemada, 1967), « On ne pouvait mieux faire que de donner à un lycée [...], pour augurer de ses succès, [...] le nom d'André Maurois » (Maurice Druon, 1970).
(4) « Le présage est également le signe, la chose même qui annonce l'avenir ; et la conjecture, le pronostic que nous tirons des objets. L'augure est simplement l'idée que nous nous formons de l'avenir d'après certaines données [...]. Nous augurons, mais les choses n'augurent pas. Les choses présagent, et nous présageons. On tire l'augure, on voit certains présages. L'augure est dans notre imagination, et non dans l'objet ; le présage est dans l'objet et dans notre esprit. Ainsi le mot présage a deux acceptions différentes, et celui d'augure n'en a qu'une » (Nouveaux Synonymes françois, 1785). Et Roubaud d'ajouter cette remarque, en forme de réponse anticipée à une objection prévisible : « Si nous disons d'une chose que c'est un bon ou mauvais augure, c'est pour dire qu'elle est d'un bon ou mauvais augure. » Bel exemple de raisonnement fallacieux, dans la mesure où l'argument métonymique vaut aussi bien (fût-ce à rebours) pour présage : si nous disons d'une chose qu'elle est d'un bon ou d'un funeste présage, n'est-ce pas pour dire qu'elle est un bon ou un funeste présage ?
(5) Et aussi, plus généralement : « Ça augure bien, ça augure mal. En France, on dit : Nous augurons, mais les choses n'augurent pas » (Sylva Clapin, Dictionnaire canadien-français, 1894), « Dites : Je n'augure rien de bon de cette affaire, et non : Cette affaire augure mal » (Raoul Rinfret, Dictionnaire de nos fautes contre la langue française, Montréal, 1896), « Augurer est un verbe transitif qui signifie "conjecturer". Il ne peut donc avoir pour sujet qu'un nom de personne » (Bulletin du parler français au Canada, 1904).
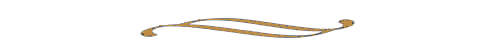
Remarque 1 : Augurer est emprunté du latin augurare (« prendre les augures, en particulier d'après l'observation du vol des oiseaux ; prédire, pressentir, conjecturer »), lui-même issu de augur (« prêtre chargé de prendre les augures »). L'origine de ce dernier mot reste floue : les uns le dérivent de augere (« augmenter ») − l'idée étant celle d'un prêtre qui fournit des présages favorables, « propres à accroître les entreprises humaines » (selon le Dictionnaire historique) − ; les autres de curare, « dont la signification propre est "regarder, voir, observer" » (selon Antoine Court de Gébelin, 1773) − de là augurare, littéralement aves curare (« observer les oiseaux ») ou ave curare (« voir d'après, par l'oiseau ») − ; d'autres encore de garrire (« gazouiller »).Remarque 2 : Sur le genre de augure, voir cet article.
Remarque 3 : On s'étonne de lire à l'article « augure » de la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie : « Conjoncture, présage qu'on tirait [dans l'Antiquité romaine] de l'observation du vol des oiseaux, de l'appétit des poulets sacrés, de l'observation du ciel, etc. » Conjecture eût été autrement congruent... à la situation !
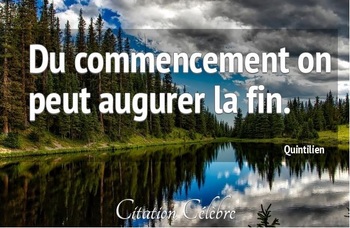
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Richesse et difficultés de la langue française



