-
Par Marc81 le 27 Juillet 2023 à 13:27
Il n'aura échappé à personne que la locution être à même de (+ infinitif) signifie « être en état, en mesure de » (selon la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie, le Larousse et le Robert en ligne), « être capable de » (selon le Grand Larousse), « être dans une situation telle qu'il existe une possibilité de » (selon le TLFi). Mais c'est affaire autrement complexe que de comprendre ce qui lui a valu son sens, tant les spécialistes de la langue qui se sont penchés sur l'origine de ce gallicisme se contredisent ou font preuve de confusion.
Commençons notre enquête par quelques rappels historiques. Selon le philologue néerlandais Kornelis Sneyders de Vogel, le latin ipse (« même, en personne ; précisément, justement ») (1) pouvait s'unir à une préposition pour former une nouvelle préposition ; « le même cas se présente en français pour à même, qui dès le moyen âge était locution prépositionnelle » (Les Mots d'identité et d'égalité, 1947). Pour preuve ces exemples anciens de la construction à même + nom concret, pronom ou adverbe de lieu (précédé ou non de la préposition de), attestée avec deux acceptions principales selon le verbe employé (ou sous-entendu) :
- « près (de), à proximité (de) » après être, se trouver, venir, voir, etc. : « A meïsmes de la cité » (Le Roman d'Eneas, vers 1160), « A meimes le li[e]u » (Ambroise, L'Estoire de la guerre sainte, vers 1195, manuscrit recopié à la fin du XIIIe siècle), « E quant a meismes d'els furent » (Id.), « A meimes de cel liu » (Vitas Patrum, manuscrit du XIIIe siècle), « Sceva l'aperçut la ou estoit a meïsmes d'un gué » (Li Fet des Romains, vers 1213), « Il vindrent a meïsmes de l'ost et de Cesar » (Id.), « A meesme d'iluec [= près de cet endroit] » (Robert de Clari, La Conqueste de Constantinople, vers 1216) et, adverbialement (par ellipse du substantif), « Iluec les veient a meesme [= à proximité, dans le voisinage, tout près] » (Le Roman d'Eneas), « Salahadins iert a meisme » (Ambroise, L'Estoire de la guerre sainte) ;
- « à la chose même (avec l'idée de contact immédiat, sans rien qui s'interpose) », d'où « directement à, dans, sur », après boire, mordre, puiser, etc. : « [La mer] tochoit a meïsmes des fondemenz dou mur » (Li Fet des Romains, vers 1213), « Touz biens puisent A meïsmes une fontaine » (Le Roman de la Rose, vers 1240), « Boire a mesme ma boutaille » (Miracle de Berthe, vers 1373), « [Ils] se siesent a mesme terre » (Recueil de diverses histoires, 1539 ; notez l'absence de déterminant) et, adverbialement, « Ilz prenoient frommages sans peler et mordoient a mesmes [= directement dedans] » (Chronique scandaleuse, fin du XVe siècle). (2)
Être à même de s'est donc d'abord entendu avec le sens local de « être près de, à proximité de (quelque chose ou quelqu'un) ». Mais très vite, quoique plus rarement, apparaissent les premières constructions avec un nom de chose abstraite (ou un pronom renvoyant à une telle chose) :
« Par tans en iert a meïsmes » (Chrétien de Troyes, Lancelot, vers 1180), « Quant ele voit son anfant ou son seignor a meïsme de la mort » (Li Fet des Romains, vers 1213), « Ce meïsmes [amour] Don chascuns peut estre a meïsmes » (Le Roman de la Rose, vers 1240).
Et c'est là que l'affaire se complique : le sens de la locution est-il toujours... le même ?
Dans le premier exemple, Chrétien de Troyes raconte qu'il n'existe aucun trésor au monde contre lequel Lancelot laisserait Méléagant en vie s'il le tenait à sa merci, car l'homme lui a fait trop de tort. Et l'auteur ajoute : « Mes li afeires a ce monte Que par tans en iert a meïsmes », autrement dit le sort fera que Lancelot sera sous peu à portée de cela (= du fait de tenir Méléagant à sa merci) (3), dans une situation où cela sera possible.
Dans le deuxième exemple, la locution est employée avec une nuance temporelle : l'enfant est tout proche de la mort, sur le point de mourir.
Dans le troisième, la Raison dit à l'Amant : « Je t'enseignerai bien autre [amour] ui. Autre, non pas, mes ce meïsmes Don chascuns peut estre a meïsmes », passage que Jules Croissandeau (1878) traduit librement par : « Autre amour te ferai connaître. Autre, non ; le même plutôt, Mais plus accessible et moins haut. » On perçoit que l'idée d'accessibilité (chacun est à portée de cet amour) sous-tend ici celle de capacité (chacun a les qualités requises pour cet amour).Ces premiers emplois figurés ont été suivis de plusieurs autres, tous sortis d'usage :
- être à même de (quelque chose), « être en état de se procurer, de faire quelque chose qu'on désire » (selon Louis-Nicolas Bescherelle), « être aussi bien placé que possible pour en contenter son désir » (selon François Génin, 1846), « pouvoir disposer librement de » (selon Wartburg et Goosse), « être à portée de » (selon Littré) :
« Je veux me faire un gendre [médecin afin] d'estre à mesme des consultations et des ordonnances » (Molière, Le Malade imaginaire, 1673) (4), « Ce n'est pas un effort commun à des matelots que de savoir se modérer sur l'usage des liqueurs fortes, lorsqu'ils s'en trouvent à même » (Élie de Joncourt, 1749) ;
- mettre (ou laisser) quelqu'un à même de (quelque chose), « mettre quelqu'un en pouvoir et en état de faire ce qu'il lui plaira à l'égard de certaines choses » (selon Richelet, 1680), « [lui] donner la libre disposition de, [lui] faciliter l'usage ou l'accès de » (selon Wartburg) :
« Je vous mettray a mesme mes biens» (Jacques Amyot, 1547), « Dequoy m'as-tu jamais requis Qu'a mesme aussi tost ne t'ay mis ? » (Jean-Antoine de Baïf, 1573), « Mettre les personnes habiles à mesme de ses manuscrits » (Jean Chapelain, 1660) ;
- à même (sans complément), « en estat de faire a ; en pleine abondance, en pleine commodité b » (selon Antoine Oudin, 1640), « dans la situation qui convient exactement a, b » (selon Gabriel Spillebout), « sur le fait c » (selon Godefroy), « aussitôt d » (d'après Giovanni Veneroni évoquant le cas de l'ancienne locution à même que) :
a. « Psaultier prens, quant suis a mesme » (Villon, 1462), « Je n'apperceois pas pourquoy [Tacite écrit cela] ; au moins lors que j'estois a mesme, je ne le veis point » (Montaigne, Les Essais, édition posthume de 1595), « Il prie le sergent d'achever la besongne, et le met a mesme de si bonne grace qu'il ne l'en put refuser » (Agrippa d'Aubigné, 1619), « Ma mère me poussa au milieu [des soldats] en les priant de me laisser manger à leur gamelle. Ces braves gens me mirent aussitôt à même » (Sand, 1855) (5) ;
b. « D'où vient que vous, qui avez été autrefois tout exprès en Sicile pour manger de bons morceaux, maintenant que vous êtes à même, vous n'en mangez point ? » (Racine, vers 1660), « Vous aimez les figues, en voilà, vous estes à mesme, vous voilà à mesme, mangez-en tant que vous voudrez. Il aime les livres, je l'ay mené dans un cabinet où il y en a quantité de bons et je l'ay mis à mesme, je l'ay laissé à mesme » (Dictionnaire de l'Académie, 1694) ;
c. « On demanda à un philosophe qu'on surprit a mesme, ce qu'il faisoit » (Montaigne, 1595) ;
d. « Nostre Seigneur respond a mesmes » (Jean de Selve, 1559).
Seules les constructions avec un infinitif complément, introduit par de et autrefois aussi par pour (6), se sont maintenues jusqu'à nous. Rares avant le XVIe siècle (7), elles ont longtemps présenté les mêmes nuances de sens (capacité, possibilité, immédiateté) que celles relevées au tournant du XIIIe siècle − quand bien même le contexte ne permettrait pas toujours de les distinguer avec certitude :
- être capable de, avoir les qualités requises pour : « Bien sont de mentir à meïsmes Cil qui vont contant tieus noées [= telles bagatelles] » (Guillaume Guiart, 1306), « Ilz sont a mesme de prendre plusieurs poissons et oyseaulx » (Recueil de diverses histoires, 1539), « [Venus] estant a mesme [...] pour choisir quelque amoureux gentil et beau [...] s'amouracha du dieu Mars [...] tout suant de la guerre » (Brantôme, avant 1614) ;
- être en position de, être en mesure de, avoir l'occasion de : « Toute republicque en temps de paix est a mesmes de choisir et faire ce qui luy semble necessaire pour contregarder la cité et communité en repoz » (Antoine Macault, 1539), « [Je] serai bientost à mesme de cognoistre les véritables gens de cœur qui se vouldront acquérir honneur pour bien faire avec moy » (Henri IV, 1576), « Encores hier je fus à mesmes de veoir un homme [se moquant de…] » (Montaigne, 1595), « Je seray à mesme pour vous caresser comme je voudray » (Molière, 1664), « La mort [de mademoiselle de Mainville] m'a laissé à même de pouvoir écrire sans contrainte » (Jean-Baptiste Boyer d'Argens, 1736) ;
- être près de, sur le point de (sens tombé en désuétude) : « De cheoir elle fut lors a mesme » (La Boétie, avant 1563), « La jalousie que nous avons de les voir [...] jouyr du monde, quand nous sommes à mesme de le quitter » (Montaigne, 1580), « Je tiens de bon lieu [...] qu'il estoit à mesme de le renoncer » (Brantôme, avant 1614).
En résumé, à même ne se rencontre plus guère de nos jours que suivi (directement) d'un substantif déterminé, avec le sens concret de « en contact direct avec », ou d'un infinitif introduit par de, avec le sens figuré de « capable de (= apte à ou ayant la possibilité de) » : dormir à même le sol, être à même de rendre un service. Damourette et Pichon inclinent à penser que les deux tours sont foncièrement le même, car dans celui avec l'infinitif « l'élément de contact intime, nu à nu, entre le sujet et l'action est toujours présent » (Des Mots à la pensée, 1930). Ce ne serait pas la seule fois, au demeurant, qu'une locution aurait glissé d'un sens propre qui connote la distance à un sens figuré qui renvoie à l'aptitude ou à la possibilité. Que l'on songe à être à portée de, être en mesure de, être à la hauteur de...
Mais venons-en aux points de désaccord entre les spécialistes. Dans un article récemment publié sur son excellent blog(ue), Bruno Dewaele nous donne matière à discussion : « Rien ne va de soi dans cette expression : comment ce même, censé souligner une identité, en est-il venu à traduire une aptitude ? Déjà que la succession d'une préposition (à) et d'un adverbe (même) ne court pas vraiment les rues dans la cité grammaticale... »
Première polémique : même a-t-il ici la valeur du latin idem ? Oui, si l'on en croit le Dictionnaire historique, qui observe qu'en ancien français « même exprimait l'identité non seulement lorsqu'il se plaçait derrière le nom mais aussi devant. Il reste un vestige de cet usage dans la locution prépositionnelle être à même de ». Non, selon Wartburg, Nyrop, Sneyders de Vogel et le TLFi, pour qui même, dans cette affaire, exprime bien plutôt un rapport d'ipséité (latin ipse).
Deuxième polémique : même est-il employé comme adverbe ou comme adjectif ? Comme adverbe, affirment le Larousse et le Robert en ligne. Comme adjectif, répondent en chœur Émile Gachet, Adolphe Hatzfeld, Léon Clédat, Philippe Martinon et Walter Renkonen, sans toutefois parvenir à s'accorder sur le substantif sous-entendu :- place : « [Être à même de] est une phrase elliptique [dont] on comprend [qu'elle] puisse signifier être à la place même de, à la place convenable pour » (Gachet, 1859), « Être à même, mettre à même (à la place même) » (Martinon, 1927) ;
- source : « Être à même de quelque chose, être à la source même de la chose » (Hatzfeld, 1890), « Autrefois l'expression être à même de qqch avait voulu dire être à la source, à la place même de qqch. » (Renkonen, 1948) ;
- point : « Le substantif sous-entendu peut être le mot point qui a eu les trois significations de moment, d'état et de lieu [...]. On peut donc considérer être à même de [(faire) quelque chose] comme équivalant à être à même le point de ou au point même de, dans les divers sens de point indiqués ci-dessus » (Clédat, 1899).
Comme « un syntagme adjectival (invariable) analogue à capable », précise de son côté Goosse dans Le Bon Usage.
Mais ce n'est pas tout. D'aucuns (Raoul de Thomasson et John Orr en tête) en viennent à rapprocher le mesme de estre a mesme de de l'ancien substantif esme de estre a esme de, locution attestée en 1309 chez Jean de Joinville (« Il estoient a esme de penre [= prendre] la ville ») avec le sens de « être en mesure, sur le point de » (selon Godefroy) ou de « avoir l'intention, le dessein de » (selon Tobler) − ce qui, convenons-en, ne revient pas au même. Et c'est là l'objet de la troisième polémique.
Vous l'aurez compris : la locution être à même de a beau avoir déjà fait couler beaucoup d'encre, elle n'est pas près de livrer tous ses secrets. Même pas en rêve !
(1) Même reprend les emplois de deux mots latins : ipse, marquant l'insistance, et idem, marquant l'identité ou la similitude. En français moderne, le sens de même (ipse ou idem) est indiqué par l'ordre des mots (le jour même, la personne elle-même ; le même jour, la même personne), mais dans l'usage ancien, l'ordre des mots n'étant pas rigoureusement fixé, de nombreux emplois sont ambigus.
(2) Seule cette seconde acception s'est maintenue en français moderne, malgré la condamnation de Thomas Corneille : « Quelquefois dans le discours familier, on employe [à même] à un autre usage qui n'est pas receu par ceux qui parlent correctement. C'est quand on dit boire à mesme la bouteille » (Remarques sur la langue françoise de M. de Vaugelas, 1687).
En voici quelques exemples :
(avec une préposition, « usage qui se fait rare » selon Goosse) « Boire à même d'une bouteille » (Chateaubriand, 1848), « [Il] mord à belles dents à même du prochain » (Sainte-Beuve, 1861), « L'or est appliqué à même sur les veines du bois » (Huysmans, 1883), « [Des arbres] poussant à même entre les gradins » (Montherlant, 1926), « Elle serait plus à l'aise [...] à même dans l'herbe » (Bernanos, 1929), « Il décroche le quartier de viande [et] mord à même dedans » (Ramuz, 1934), « Boire à même à une cruche, boire à la cruche même » (huitième édition du Dictionnaire de l'Académie, 1935 ; exemple remplacé dans l'édition suivante par : « Boire à même la cruche ») ;
(sans préposition) « Boire à même le ruisseau » (Sand, 1859), « [En se prostituant, cette femme] se vengeait à même elle, à même son corps comme à même son âme ! » (Barbey d'Aurevilly, 1874), « Il s'était allongé à même cette fraîcheur du pré » (Daudet, 1879), « L'âme s'abreuve en buvant largement à même le grand fleuve » (Rostand, 1898), « [Un vêtement] porté à même la chair » (Ramuz, 1917), « Mordre à même le fruit » (Proust, 1922), « Une porte grillée qui donnait à même la piste » (Montherlant, 1926), « Ses pauvres fesses à même le carreau » (Bernanos, 1943), « Coucher sans matelas, à même le plancher » (Dutourd, 1993).
« Dans ces phrases, précise Hanse (1949), le rapport exprimé par la préposition à n'est plus perçu. C'est ainsi qu'on en arrive [...] à employer la locution adverbiale à même avec une préposition autre que à, comme si à même ne signifiait que directement. »(3) Être à portée de quelque chose s'entend ici au sens figuré de « être dans une situation convenable pour demander, pour obtenir quelque chose » (huitième édition du Dictionnaire de l'Académie, 1935).
(4) Il me semble que l'exemple de Molière présente une nuance de maîtrise, de pouvoir, qui n'est pas étrangère à notre locution. Comparez avec : « Estre à mesmes de quelque chose, to have a thing in his power, or choice » (Cotgrave, 1611), « Estre a meisme de, maîtriser » (Wartburg ; sens que le lexicographe attribue curieusement à la citation de Chrétien de Troyes).
(5) Il est permis de supposer, dans ce type de construction, une ellipse du verbe exprimé précédemment : « Quant suis a mesme (de le prendre) », « Lors que j'estois à mesme (de m'en apercevoir) », etc.
Notons par ailleurs que le TLFi perçoit − à tort, me semble-t-il − le sens de « à égalité » dans l'exemple de Sand.(6) L'infinitif a pu aussi se construire directement : « [Il sera supplié de] fere desloger sa compagnie de ladicte ville pour mettre aultre part qu'elle sera plus a mesme fere le service du roy » (Registre des délibérations consulaires de Valence, 1579). Quant à la construction avec pour, elle découle, selon Léon Clédat, de l'emploi absolu de être à même.
(7) La notice historique du TLFi sème la confusion, en donnant à croire que la construction avec un verbe à l'infinitif est attestée dès la fin du XIIe siècle : « 1176-81 estre a meïsmes de + inf., pron. ou adv. pronom. (Chrétien de Troyes) ; 1306 (Guillaume Guiart). »
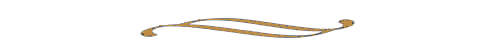
Remarque 1 : Dans l'ancienne langue, l'addition d'un s final à me(i)sme, adjectif ou adverbe, a longtemps été indifférente. Comparez : « En cel meisme an » et « Ce meïsmes jour » (Froissart) ; « Et meisme selon la philosophie de Aristote » (Oresme) et « Et meismes en si grandes matieres » (Chastelain). C'est Vaugelas qui, pour distinguer mesme adjectif de mesme adverbe, préconisa − en vain − d'écrire ce dernier sans s à côté d'un nom pluriel et avec un s à côté d'un nom singulier : les choses mesme que je vous ay dites, la chose mesmes que je vous ay dite. Drôle de règle, tout de même !Remarque 2 : Au XVIIIe siècle, les constructions avec à même ressortissaient au discours familier ou populaire : « Estre a mesme. Il est du style familier. Boire a mesme le seau. Il est populaire et bas » (Dictionnaire de l'Académie, 1718-1798), « Mettre à même et être à même de faire quelque chose sont des façons de parler qui m'ont toujours paru bien bizarres et qui ne sont pas du beau style » (Dictionnaire de Féraud, 1797). On lit encore de nos jours : « À même de suivi de l'infinitif. Tour légèrement familier » (Girodet), « La locution à même de est un substitut familier de "capable de, en situation de" » (Jean-Paul Colin). Mais pour Johan Tekfak (301 Expressions pour parler comme les Français, 2021), être à même de relève au contraire du registre soutenu.

 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Marc81 le 19 Septembre 2022 à 12:33
Certaines expressions bien connues de tous cachent, derrière leur apparente simplicité, des difficultés que les spécialistes eux-mêmes peinent à résoudre (quand ils ne feignent pas de les ignorer). Que l'on songe, par exemple, à mine de rien : doit-on dire faire mine de rien ou ne faire mine de rien ?
Renseignements pris, l'Académie ne nous est d'aucune aide sur ce coup-là. Allez savoir pourquoi, elle fait mine de ne connaître que la variante sans faire mine de rien, qu'elle range contre toute attente avec l'expression jumelle faire semblant de rien parmi les emplois où le pronom indéfini rien conserve la valeur négative de « nulle chose » sans l'aide de la négation ne :
« Sans l'adverbe ne. Faire semblant de rien, feindre l'indifférence, l'ignorance, etc. Sans faire mine de rien, sans dévoiler ses intentions, ses sentiments. Elliptiquement et familièrement. Mine de rien » (article « rien » de la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie).
Que doit-on comprendre ? Que l'adverbe ne ne saurait s'inviter dans sans faire mine de rien ? Cela va sans dire. Notre expression n'en demeure pas moins présentée dans un contexte explicitement négatif, en l'occurrence sous la dépendance de sans : « Il me semble que, s'il était légitime de se passer de la négation, c'est En faisant mine de rien qui nous serait proposé », fait observer Bruno Dewaele avec quelque semblant de raison. Partant, on peine à saisir la pertinence du parallèle suggéré entre faire semblant de rien (sans ne) et sans faire mine de rien (avec sans). Le malaise est d'autant plus grand que l'on a tôt fait de prendre les Immortels en flagrant délit d'inconséquence :
« Familier. Ne faire semblant de rien ou, abusivement, Faire semblant de rien, simuler l'indifférence ou l'ignorance, feindre l'inattention. Observez ce qui se passe sans faire semblant de rien » (article « semblant » de la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie).
Fasse semblant de comprendre qui voudra !
Le TLFi, de son côté, adopte une position qui, pour être plus claire, n'en est pas moins discutable :
« Vieilli. Ne faire semblant de rien. Feindre d'être indifférent, de ne pas savoir ou de ne pas entendre quelque chose » (article « semblant »).
« Familier. Faire mine de rien. Ne manifester aucun sentiment, aucune réaction » (article « mine »).
Pourquoi serait-il légitime de se passer de la négation ici et pas là ? Rien ne devrait-il pas se construire avec faire mine comme avec faire semblant ? Un retour aux sources s'impose.
À l'origine est la construction faire semblant de quelque chose (et aussi faire semblant de + infinitif, faire semblant que...), où semblant, participe présent substantivé du verbe sembler, s'entend au sens de « apparence, aspect ; signe, indice ». Le tour a d'abord signifié « donner tous les signes (d'un sentiment réellement éprouvé, d'une pensée, d'une intention, d'un état...), manifester, montrer, laisser paraître », avant de se spécialiser dans son acception péjorative de « donner des signes pour tromper », d'où « feindre, faire comme si » : « Semblant feseit de doel mener ["elle montrait qu'elle menait deuil"] » (Marie de France, vers 1170), « Li enfans fait semblant de joye ["l'enfant donne des signes de joie"] » (Galeran de Bretagne, vers 1210), « Mais ma bouche fait semblant qu'elle rie, Quant maintefoiz je sens mon cueur plourer » (Charles d'Orléans, milieu du XVe siècle). C'est sur ce modèle qu'a été construit (au XVIe siècle, semble-t-il) faire mine de quelque chose (faire mine de + infinitif, faire mine que...), avec mine (d'étymologie incertaine) pris au sens de « contenance que l'on a, air que l'on se donne par la physionomie ou l'attitude, et qui exprime un sentiment, une émotion » : « Faisant myne quil vouloit agrandir la berche [= berge], mais avoit autre chose en pensée » (Jacques de Mailles, 1527), « [Ilz] sen allerent lung d'un costé lautre de lautre, sans en faire mine ne semblant » (La Motte Roullant, 1549), « Ils ont esté contraincts faire mine de devotion » (Charles Du Moulin, 1564), « Apres avoir fait mine de quelque resistence » (Théodore de Bèze, 1580), « Ils ressemblent au scorpion, qui fait mine de caresse et frappe de la queuë sans qu'on s'en aperçoive » (Pierre Crespet, 1587) (1). Dès la première édition de son Dictionnaire, l'Académie donne les deux expressions comme synonymes : « On dit aussi, Faire mine de quelque chose, pour dire, En faire semblant » (à l'article « mine », 1694-1935), « On dit, Faire semblant de... faire mine de... pour dire, Feindre de... » (à l'article « faire », 1762-1798).
Mais voilà que les choses se compliquent avec l'entrée en scène de rien. Comparez : (avec semblant) « De rien ne vostrent [= voulurent] sanblant feire » (Guillaume d'Angleterre, vers 1165), « Mais ne l'en fait samblant de rien » (Li Chevaliers as deus espees, XIIIe siècle), « La damoyselle s'en alla seoir avecques les autres sans faire samblant de riens » (Perceforest, manuscrit de 1450), « En luy baillant sa lettre, dist qu'il ne feist semblant de rien, mais qu'il accomplist le contenu » (Les Cent Nouvelles nouvelles, avant 1467), « [Je] n'an ferè samblant de rien » (Jacques Peletier du Mans, 1555) et « Philippus aiant ouy ces paroles, pour la premiere fois ne feit pas semblant de rien » (Jacques Amyot, 1559), « Et ne dy mot et les regarde Faire leur faict, et fay le mien, Ne faisant pas semblant de rien » (Jean-Antoine de Baïf, 1573), « Ne faites pas semblant de rien, et me laissez faire tous deux » (Molière, 1668), « Je ne fis aucun semblant de rien » (Mme de Sévigné, 1689) ; (avec mine) « Se moquer en derriere, sans faire mine de rien » (Charles Pajot, 1658), « [Il] ne fait mine de rien, les laisse crier et remuer » (René Pageau, 1677) et « [Il] ne fit point mine de rien » (Pierre Crespet, 1604), « Il ne fait pas mine de rien, il ne fait point de responce » (Jean Boucher, 1631), « Il ne fit aucune mine de rien » (Le facetieux Resveilmatin, 1643). Ces exemples anciens prouvent assez à qui en doutait que la négation était de règle avec rien ; on découvre, un rien éberlué, que la double négation l'était tout autant, non pour affirmer, mais pour nier avec plus de force toute idée d'émotion extérieure (2). Grevisse ne voit là rien que de très courant : « Autrefois, et jusque dans le siècle classique, on mettait souvent la négation complète [ne... pas, ne... point] dans des cas où la langue moderne se sert du simple ne : On ne veut pas rien faire ici qui vous déplaise (Racine). » L'ennui, c'est que les spécialistes ne s'accordent pas toujours sur la valeur de rien combiné avec pas. Prenez la citation de Molière. Rien y est donné tantôt avec le sens étymologique de « quelque chose », hérité du latin rem, tantôt avec la valeur négative de « nulle chose », acquise au voisinage ordinaire de ne :
« Dans [Ne faites point semblant de rien], rien est visiblement un substantif au génitif, gouverné par un substantif qui le précède, semblant. Ne faites pas semblant de quelque chose, ou qu'il y ait quelque chose » (François Génin, Lexique comparé de la langue de Molière, 1846).
« "Je n'ai pas voulu faire semblant de rien" (Les Précieuses ridicules). Selon notre grammaire, la négation pas serait ici de trop. Molière n'avait pas rompu avec l'usage ancien, qui permettait de prendre rien au sens de "quelque chose" et de le construire, dans certaines phrases, avec la double négation ne, pas : "Ne faites pas semblant de rien, et me laissez faire tous les deux" (George Dandin) » (Paul Jacquinet et Émile Boully, Les Précieuses ridicules, note grammaticale, 1893).
« Au XVIIe siècle, on n'était pas bien sûr que rien renfermât en soi une idée négative. [Molière écrit en effet :] Ne faites pas semblant de rien » (M. Andréoli, Recherches sur l'étymologie et le sens du mot rien, 1861).
« La valeur négative de rien apparaît bien aussi dans les phrases où il est accompagné de la négation complète ne... pas : Ne faites pas semblant de rien (Molière) » (Grevisse, Le Bon Usage, 1964).
Cette ambiguïté sémantique du mot rien, que Goosse fait remonter au XIVe siècle, explique sans doute la tentation de s'affranchir de la négation, surtout observée dans la langue populaire (du moins à partir du XVIIe siècle) : (avec semblant) « [Il] alloit oïr messe, faisant samblant de riens » (Georges Chastellain, vers 1470, qui écrit par ailleurs avec l'adverbe ne : « Sy ne firent lesdits Anglois semblant de rien »), « Eux non seulement se taisans et faisans semblant de rien » (Jean Calvin, 1560, qui écrit par ailleurs : Nous laisserons-nous là tuer, ne faisans semblant de rien ?), « Le Roy faisant semblant de rien » (Claude Gousté, 1561), « Vous ferez samblant de rien » (Marguerite de Parme, 1564), « [Il] fit semblant de rien et avalla ceste honte » (Simon Goulart, 1578), « Faisant semblant de rien, pour sçavoir davantage » (Simon Bélyard, 1592), « Je vais faire semblant de rien » (fait dire Molière au paysan Lubin dans George Dandin, 1668), « Faites semblant de rien » (fait dire Jean-François Regnard au valet Pasquin dans Attendez-moi sous l'orme, 1694), « Faisons semblant de rien » (Louis Anseaume, dialogue de théâtre, 1761), « Mais il fallut bien faire semblant de rien » (Journal inédit du Duc de Croÿ, 1762), « [Ne dites pas :] Faisant semblant de rien... Dites : Ne faisant semblant de rien, ou mieux Sans faire semblant de rien [...]. Faire semblant de rien, sans la négation, signifierait mot à mot "faire semblant de quelque chose" » (Jean-Baptiste Reynier, Les Provençalismes corrigés, 1878) ; (plus tardivement avec mine) « Je fis mine de rien » (La Fée Badinette, 1733), « Mais faisons mine de rien » (Jocrisse au bal de l'Opéra, 1808), « Je baisse les yeux et je fais mine de rien, disait-il encore » (Notice sur la vie de M. l'abbé Imbert, 1841).
C'est au prix d'une nouvelle ellipse qu'apparaissent, dans la seconde moitié du XIXe siècle, les locutions adverbiales semblant de rien et, surtout, mine de rien avec le sens de « sans en avoir l'air » : « Et puis, semblant de rien, J'loie Etienn' l'Ecorché » (Alexandre Desrousseaux, Chansons et pasquilles lilloises, 1851), « Ce soir je mettrai la conversation sur les chiens, et, semblant de rien, je dirai que [...] » (Julie Gouraud, 1866), « Et, semblant de rien, il envoyot s' servante querre deux agents » (Catherine Lonbiec, 1909), « Et voilà comment, semblant de rien, Thérèse réagit » (Jean-François Six, 1973), « Elles allèrent s'asseoir sur le banc du fond et, semblant de rien, se mirent à jacasser » (Colette Mordaque, 2011), « Son concurrent à roulettes électriques qui, semblant de rien, zigzague et lui fait des queues de poisson » (Grégoire Polet, 2012) ; « [Il] s'était empressé, mine de rien, de prévenir les gendarmes » (Léon Séché, Contes et figures de mon pays, 1881), « Nous nous rapprochons de la porte, mine de rien » (Georges Price, 1898), « Alors, mine de rien, a m'fait signe d'veunir cheux elle » (Hugues Rebell, 1898), « Je suis allé causer − mine de rien − avec un de mes amis » (Clemenceau, 1901), « Si on rencontrait quelqu'un faudrait avoir l'air de se promener, mine de rien » (Céline, 1932), « Je ne t'ai pas expliqué comment, mine de rien, il vous envoie proprement un tabouret à la tête de son homme » (Pierre Benoit, 1933), « Mine de rien, je sors, je rentre » (Hervé Bazin, 1956), « Le mot, mine de rien, montre l'efficacité de la langue latine » (Alain Rey, 2006), « Mine de rien, chemin faisant » (Erik Orsenna, 2011), « Il essayait de les [= les pieds d'une femme] caresser, en passant, mine de rien » (Bernard-Henri Lévy, 2014).
Passées mine de rien dans la langue courante (3), ces locutions elliptiques, où rien a nettement un sens négatif par lui-même, ont pu renforcer le sentiment que leurs formes développées s'écrivaient sans ne. Que le commun des minois contemporains se soit laissé abuser, passe encore. Mais que plus d'un auteur de renom lui ait emboîté le pas sans barguigner surprend davantage : « Mais tu as pu noter que j'ai toujours fait mine de rien » (Jean Dutourd, 1950), « Faisons mine de rien » (Eugène Ionesco, 1972), « Comme si de rien n'était. Avec un air de complète indifférence, en faisant semblant de rien » (Grand Larousse de la langue française, 1973), « Elles faisaient mine de rien » (Erik Orsenna, 1988), « Mais on fera mine de rien » (Régis Debray, 1992), « Je faisais semblant de rien » (Philippe Besson, 2007), « Untel qui m'a regardée en faisant semblant de rien » (Lydie Salvayre, 2014), « Dans le studio, on fit mine de rien » (Erik Orsenna et Bernard Cerquiglini, 2022) (4). Coquille ? Étourderie ? L'explication serait trop facile ! Imitation de la langue parlée ? On peine tout de même à imaginer nos contrevenants se laisser aller à écrire Parlez de rien à côté de Faites mine de rien...
La clef de ce mystère pourrait bien nous être donnée par Jean-François Féraud :
« Boileau dit, dans sa 2e Satire : "Passer tranquillement, sans souci, sans affaire, La nuit à bien dormir, et le jour à rien faire."
La Fontaine met la négative dans son Épitaphe : "L'une à dormir, et l'autre à ne rien faire."
Boileau demanda à l'Académie laquelle de ces deux manières valait mieux. Il passa tout d'une voix que la siène était la meilleure ; parce qu'en ôtant la négative, rien faire était une espèce d'ocupation. Tout le monde ne trouvera pas peut-être cette raison trop bone, et plusieurs préfèreront la manière de La Fontaine » (Dictionnaire critique, 1787).Faire semblant de rien, faire mine de rien tendent à devenir à leur tour une espèce d'occupation, consistant à feindre l'indifférence ou à ne rien laisser paraître de ses émotions : « Tout milite donc pour faire "mine de rien" » (Annie François, 2012 ; notez les guillemets). Pour Robert Martin, cette interprétation est facilitée par le choix même du verbe faire : « Quoi que l'on fasse, on fait toujours semblant de quelque chose, c'est-à-dire qu'on extériorise toujours un sentiment même s'il est d'indifférence » (Le mot rien et ses concurrents en français, 1966). Et le linguiste de conclure : « Naturellement, l'usage régulier de rien [...] rend quasi obligatoire l'alliance avec le discordantiel [dans ces expressions]. Mais l'emploi exceptionnel sans ne, loin d'être absurde, se rattache à une logique tout à fait cohérente. » Dans le doute, mieux vaut encore s'en tenir à la position du Larousse en ligne, qui, à l'article « semblant », précise que la négation ne est de rigueur dans l'expression soignée (ne faire semblant de rien), tout en reconnaissant que son omission est habituelle dans la langue parlée (5).
Je devine à votre mine satisfaite que c'est la règle que vous appliquiez déjà par défaut à la locution jumelle avec mine.
(1) On a aussi dit, autrefois, avec l'article : « Faisans la mine de vouloir combattre » (Claude de Seyssel, 1527), « [Ils] ont fait le semblant de vouloir vivre en la reformation de l'Evangile » (Pierre Viret, 1564).
(2) Selon Robert Martin, « la locution ne pas faire semblant de rien se justifie [...] si l'on tient fortement à marquer l'impassibilité du sujet » (Le mot rien et ses concurrents en français, 1966).
(3) Cela est surtout vrai pour mine de rien, la locution adverbiale semblant de rien étant ignorée des dictionnaires usuels.
(4) Et aussi : « D'abord il a fait semblant de rien » (Maurice Bessy, 1938), « Mon père [...] fit mine de rien » (Raymond Queneau, 1944), « La petite grosse faisait, comme toujours, semblant de rien » (Henri Calet, 1947), « Elle a fait mine de rien, et quelle mine, souveraine ! » (Daniel Gillès, 1977), « Je faisais toujours semblant de rien » (Paul Emond, 1981), « Faisons semblant de rien » (Gabrielle Roy, 1984), « Ma mère faisait toujours semblant de rien » (Nicole Brossard, 1987), « Elle a fait semblant de rien » (Robert Deleuse, 1992), « Nous faisons mine de rien » (Colette Seghers, 1999), « Seulement, pour bien faire semblant de rien, il ne faut pas ralentir » (Henri-Frédéric Blanc, 2002), « Elle faisait semblant de rien » (Philippe Claudel, 2003), « Faire mine de rien, surtout faire mine de rien » (Marie Causse, 2014), « Max fait semblant de rien » (Vocalire, 2016).
(5) Même son de cloche chez Hanse : « Dans la conversation, on omet souvent ne : Il fait semblant de rien. Mieux vaut employer ne. »
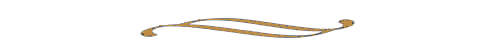
Remarque : Signalons à titre de curiosité la variante elliptique sans mine de rien : « Faire couvertement, sans mine de rien » (Charles Pajot, 1658), « Alors, en m'habillant, sans mine de rien, je tourne l'aiguille sur 5 heures » (Roger Martin du Gard, avant 1958).
 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Marc81 le 16 Novembre 2018 à 11:24
Le verbe être peut-il être conjugué à d'autres temps que l'indicatif présent dans le syntagme qui plus est, employé dans la langue soutenue ou littéraire pour renchérir sur une affirmation ? Non si l'on en croit la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie, où ledit tour et ses semblables (qui pis est, qui mieux est [1]) sont présentés indistinctement comme des « locutions figées à valeur adverbiale » (2) équivalant à « en plus, de surcroît ». En d'autres termes, ces « espèce[s] de parenthèse » − souvent précédées de et ou de mais − « par l[es]quelle[s] celui qui parle ou qui écrit interrompt la phrase pour une intervention personnelle » (dixit Goosse) se sont grammaticalisées comme coordonnants et ne varient donc plus : « La Hollande était un pays comme les autres et, qui plus est, un pays nullement primitif » (Huysmans), « Il était libertin, insolent, présomptueux, et, qui pis est, il avait de très mauvais principes » (Philippe Néricault Destouches), « Il se souviendra longtemps de cette soirée... et qui mieux est, il en parlera » (Eugène Sue).
Force est pourtant de constater que l'imparfait (3), attesté de longue date à côté du présent dans des contextes au passé, est resté en usage chez quelques bons écrivains :
(avec plus) « Mais qui plus estoit, aultant qu'il y en venoit, aultant en mettoit à fin et à l'espée » (Jean Wauquelin, vers 1447), « [Il] les mena à servitude [...], et qui plus estoit, à deport et à renoncement » (Georges Chastelain, vers 1466), « Nous trouvasmes les desertz de plus en plus austeres, sauvages, aspres et roides, et qui plus estoit, l'accoustumance ne nous diminuoit l'ennuy, ains l'accroissoit » (Jean Thenaud, vers 1508), « Homme toutesfois qui non seulement n'avoit permission d'exploicter, mais qui plus estoit on n'y en admettoit aucun qui sceut lire et escrire » (Étienne Pasquier, 1596), « Et qui plus était, toutes pièces d'or se prenaient sans peser » (Adolphe Chéruel, 1855), « En plein désert on m'adjoignait un inconnu, et qui plus était un supérieur ! » (Pierre Benoit, 1919), « Qui plus était, Satan avait encore choisi le coin de Douarnenez pour ce rendez-vous » (Henri Queffélec, 1985) ;
(avec pis) « Et avecques ce, qui pis estoit, on perdoit tout le povair de son corps » (Journal d'un bourgeois de Paris, première moitié du XVe siècle), « [Ils] les mirent hors de corage et de tout bon espoir [...] ; mès, qui pis estoit, traitoient durement et très austèrement infinité d'hommes » (Georges Chastelain, vers 1464), « Et qui pis estoit, tous ses subjects avoient fait serment audict Duc de Bourgongne » (Philippe de Commynes, vers 1490), « À peine pouvions nous parler l'un à l'autre sans nous fascher ; voire qui pis estoit [...] sans nous jetter des œillades et regards de travers » (Jean de Léry, 1578), « On mettoit une grande difference entre les affranchis [...] et ceux qui n'avoient que le droit des Latins, ou, qui pis estoit, de ceux qu'on appeloit Deditices » (Scipion Dupleix, 1636), « Y voir tant de gens si différents de ce que j'étais, et qui pis était de ce que j'y avais été » (Saint-Simon, avant 1755), « Ces grands orateurs s'ennuyaient fort à s'écouter entre eux, et, qui pis était, la nation entière s'ennuyait à les entendre » (Tocqueville, avant 1859) ;
(avec mieux) « On lui avait, l'avant-veille, scalpé quatre de ses Indiens, à lui aussi, et qui mieux était, raflé cinquante têtes de bétail » (Pierre Benoit, 1936).
À la réflexion, les deux temps se défendent, pour peu que l'on rende son autonomie à chacun des éléments qui composent ces locutions et que l'on applique la concordance des temps : dans un contexte au passé, le choix du présent confère au point de vue du locuteur une dimension de vérité générale, quand l'imparfait le rend contemporain des faits considérés.
Mais il y a plus : la syntaxe même de ces tournures archaïques − où le relatif qui, sujet pris en valeur neutre au sens de ce qui (4), renvoie de façon peu habituelle à la phrase ou au syntagme qui généralement suit − ne semble pas aussi immuable que ce que l'on voudrait nous faire croire. « Qui mieux est et qui pis est sont concurrencés, dans la langue ordinaire, par ce qui est mieux, ce qui est pis (ou pire) », lit-on dans Le Bon Usage. C'est oublier que lesdites graphies ont également subi − et subissent encore à l'occasion − la concurrence, dans la langue littéraire, de ce qui (plus, pis, mieux) est. Non seulement les constructions avec ce et attribut antéposé au verbe − bien que moins fréquentes que celles sans ce − ont toujours existé (5), mais elles les ont même parfois précédées : « Ço [= cela, ce] que plus est » (Voyage de saint Brendan, vers 1112) n'est-il pas attesté avant « Et, qui plus est, quant serez mors, Vous promet du ciel les tresors » (Miracle de saint Lorens, vers 1380), « Et qui pis est, il advenrra que [...] » (Eustache Deschamps, vers 1389), « Et en conclusion, qui mieulx vault, comment il se rendra demain au soir devers elle » (Les Cent Nouvelles Nouvelles, vers 1462), « Et qui mieux est ladite pièce de linge ne coulera sur les parties voisines » (Jacques Guillemeau, avant 1613) ? Et que dire encore de ces autres exemples de modification syntaxique, relevés au hasard de mes recherches : « Qui bien plus est, ce n'estoient pas femmes » (Montaigne, 1588), « Il en usa à l'égard de Meunier [...], et, qui beaucoup plus est, à l'égard de Quinesset » (Alphonse Karr, 1885), « Qui beaucoup plus est, [...] je dois cela à mon art » (Alain-Fournier, 1905) ; « Avec impatience, avec colère, avec inquiétude, et, qui bien pis est, avec complaisance » (Émile Faguet, 1895), « Et ainsi, qui encore pis est, elle ne reconnaissait et ne voulait reconnaître, sur terre, que Dieu seulement » (Germain Lefèvre-Pontalis, 1903), etc. ?
Avouez que l'on a connu locutions plus figées...
(1) Nettement plus rare est le tour qui moins est : « Mais c'était une masse informe et sans beauté ; sans vitesse qui moins est » (Guy Tomel, 1898).
(2) Ou, selon les sources, comme des « archaïsmes figés » (Pierre Le Goffic), des « tournures figées » (Marc Wilmet), des « propositions relatives figées » (Grevisse), des « expressions toutes faites » (Knud Togeby).
(3) Les autres temps sont rares ou inusités : « qui plus fut » (Olivier de La Marche, avant 1502), « qui pis fut » (Georges Chastelain, avant 1475 ; Jean de Serres, 1595 ; Agrippa d'Aubigné, 1626 ; Saint-Simon, avant 1755), « qui pis sera » (Jean Bégat, 1562).
(4) En ancien français, le relatif qui pouvait s'employer sans antécédent, au sens de « celui qui, ce qui, chose qui ». Cet archaïsme survit dans des emplois proverbiaux (Qui dort dîne. Qui vivra verra. Qui peut le plus peut le moins. Sauve qui peut. Embrassez qui vous voudrez...) ou littéraires (à l'instar des locutions qui plus est, qui pis est, qui mieux est, lesquelles signifient littéralement « ce qui est encore plus » − « où plus est évidemment substantif », précise Littré −, « ce qui est encore pis », « ce qui est encore mieux »).
(5) Qu'on en juge : « Les chevaulx sont vielz ferrez au talon, Ce qui pis est, sont de faim aveuglé » (Eustache Deschamps, fin du XIVe siècle), « Et ce qui plus estoit, c'estoit le dangier des principales personnes » (Georges Chastelain, vers 1464), « Mettre et susciter la guerre, la pillerie et le désordre partout (ce qui pis est) » (Louis XI, 1464), « Ce qui plus est, [ils] s'efforcent de rompre la pragmatique sanction et les libertez de l'Eglise de France » (François II de Bretagne, 1485), « Ce qui plus est, iceulx déprédeurs [...] despendirent le crucifix » (Jean Molinet, 1492), « [Il] avoit l'esprit fort bon [...], et ce qui plus est, un chacun l'estimoit » (François de Belleforest, vers 1570), « Ce nombre de sept [...] semble contenir en soy des secrets [...] admirables : et qui plus est estre le nœud et l'achevement de toutes choses » (César de Nostredame, 1614), « Et, ce qui plus est, cela seroit sans beaucoup de dépenses » (Louis Fouquet, 1656), « Vous qui faites tant de métiers à la fois, celui de conquérant, de politique, de législateur, et, ce qui pis est, le mien » (Voltaire, 1749), « Puissai-je mourir, ou, ce qui pis est, vivre chargé du mépris de tous les honnêtes gens » (Mirabeau, 1779), « [Voyez] comme ses habits sont faits, et, ce qui plus est, comme ses mains sont ensanglantées (Jacques-René Hébert, 1792), « Qui pis est, ce qui pis est » (Dictionnaire universel de Pierre-Claude-Victor Boiste, édition de 1819), « Le charbonnier est maître de se tuer aussi, ou, ce qui pis est, de jeter son argent par les fenêtres » (Balzac, 1833), « L'aîné, madame, est le comte de Castelmelhor, et, ce qui mieux est, il a l'honneur d'être votre filleul » (Paul Féval, 1844), « Le bon droit, ou plutôt, ce qui mieux est, la succession vous demeure » (Eugène Sue, 1845), « Je vous gênerais, et, ce qui pis est, vous me gêneriez » (Alexandre Dumas, 1846), « Nous avons le témoignage d'un contemporain, et, ce qui mieux vaut en pareil cas, d'un ennemi » (Anaïs de Raucou, 1847), « Pascal s'était trouvé sans défense [...] et, ce qui pis est, sans défiance » (Hector Malot, 1870), « Ce devait être un rêveur ou, ce qui pis est, un demi-rêveur » (Pierre Lasserre, 1925), « La foi est ainsi irréfutable, et, ce qui plus est et ce qui la distingue des catégories antérieures, se sait irréfutable » (Éric Weil, 1985).
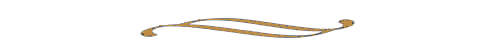
Remarque 1 : Les mêmes hésitations sont observées avec les locutions autant que faire se peut, peu (ou tant) s'en faut, etc.Remarque 2 : On se gardera d'écrire, par confusion phonétique : qui plus (pis, mieux) ait.
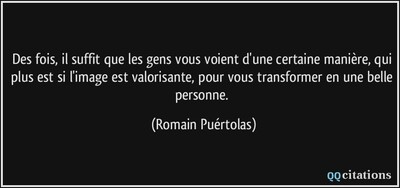
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par Marc81 le 4 Octobre 2018 à 14:14
Je ne vais pas y aller par quatre chemins : il est des fois où les ouvrages de référence ont le chic pour semer le trouble dans l'esprit du lecteur. Témoin la façon dont l'Académie traite l'expression familière ne faire ni une ni deux dans la dernière édition de son Dictionnaire : « Elliptiquement. Ne faire ni une ni deux, se décider sur-le-champ, agir immédiatement », lit-on à l'article « deux ». Mais de quel terme est-on censé avoir fait l'économie dans cette affaire ? Pas un mot. De deux choses l'une : ou bien les Immortels prennent un malin plaisir à jouer aux devinettes, ou bien le nom féminin sous-entendu tombe à ce point sous le sens que ce serait une insulte à la logique d'en dévoiler l'identité. Le rouge me monte au front ; il me faut en avoir le cœur net. Ni une ni deux, je me rue sur le Littré, lequel, quand il me mettrait de fait sur la voie, ne soulève pas moins de questions. Jugez-en plutôt : « N'en faire ni un ni deux [...]. On dit aussi, au féminin, n'en faire ni une ni deux, en sous-entendant le mot fois. » Ne (n'en ?) faire ni une fois ni deux fois ? Ou, au masculin, ni un ni deux ? Voilà, convenons-en, qui mérite un mot ou deux d'explication.
À l'origine était l'expression n'en pas faire à deux fois, attestée depuis le XVIe siècle au sens de « finir tout d'un coup » (Antoine Oudin, 1640), « faire la chose tout d'un train » (Joseph Joubert, 1710) : « Veu que je n'en devois faire a deux fois » (Claude Gruget, 1526), « [Il] le vuyda sans en faire à deux fois » (Nicolas Herberay des Essarts, vers 1550), « Pour n'en faire à deux fois » (Simon Goulart, 1589). Dans son sillage sont apparues la forme positive en faire à deux fois (synonyme du futur « s'y prendre à deux fois ») : « Si elle en faisoit à deux fois » (Farce nouvelle de frère Guillebert, début du XVIe siècle), « Il en avoit fait à deux fois » (Étienne Pasquier, 1587) et la variante elliptique en faire (ou n'en pas faire) à deux : « Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un corps qu'on dresse, c'est un homme ; il n'en faut pas faire à deux » (Montaigne, 1580), « Le Bourgeois n'en fait pas à deux » (François Salvat de Montfort, 1708), « Il n'en fit pas à deux » (Pierre Hourcastremé, 1773). À ceux que la présence du pronom en intrigue, il est généralement répondu, et plutôt deux fois qu'une, que le bougre a ici « une valeur imprécise » comme c'est le cas dans un grand nombre d'expressions rebelles à l'analyse (s'en faire, s'en prendre à quelqu'un, s'en tenir à quelque chose, en finir, etc.). Voire. Car en l'espèce, et à en croire le Dictionnaire du moyen français, faire de quelque chose (parfois de quelqu'un) se dit depuis au moins le XVe siècle au sens de « s'occuper de quelque chose, se décider sur quelque chose » : « Il advisast comment l'on pourroit faire du chastel » (Actes de la chancellerie d'Henri VI, 1427), « Saiche [...] que ne feray de son mandement [= que je ne suivrai pas son ordre] » (Raoul Lefèvre, 1464), d'où : « Il est vray qu’on fit à deux fois de ce concile » (François de Clary, 1592), « Il ne faut pas faire d'une chose à deux fois, c'est-à-dire à plusieurs reprises » (Dictionnaire de Furetière, 1690). Vous l'aurez compris, en est ici mis pour « de cela (ou de lui) » − comparez : « Les uns disoient qu'il n'en falloit pas faire à deux fois » et « On disoit qu'il ne falloit pas faire à deux fois de tous les damnez d'Heretiques » (Élie Benoît, 1695) −, quand bien même certains auteurs auraient maintenu, par erreur ou par redondance assumée, ledit pronom à côté du complément prépositionnel : « Pour n'en pas faire à deux fois de ce qu'il avoit de désobligeant à lui dire » (Maximilien de Béthune, avant 1641), « Comme je n'ai pas voulu en faire à deux fois de cette histoire » (Gatien de Courtilz de Sandras, 1688), « Du mien [= de mon cœur], vous n'en avez pas fait à deux fois, vous me l'avez expédié d'un coup d’œil » (Marivaux, 1734).
Mais voilà qu'au XVIIIe siècle entre en scène la construction avec ni... ni, d'abord dans sa version masculine : « Je n'en avons fait ni un ni deux » (Laurent Bordelon imitant le parler d'un paysan, 1722), « Et puis tout d'un coup, sans en faire ni un ni deux, le velà tombé tout droit à mes pieds » (Claude-François Lambert, 1740), puis avec une à la place de un : « Le Sr. Pasquier n'en fait ni une ni deux, demande sa voiture et vole comme un trait chez le lieutenant » (Guillaume Imbert, 1780), « Le voilà, qui n'en fait ni une, ni deux, et qui m'applique un coup de canne » (Louis Abel Beffroy de Reigny, 1786). D'aucuns, considérant à la suite de Littré que le mot fois est sous-entendu dans la version féminine, veulent croire qu'il ne s'agit là que d'une variante intensive (ou plaisante) du tour primitif : car enfin, quand on ne fait pas de quelque chose à deux fois, c'est qu'on n'en fait ni à une fois ni à deux fois ! Pour preuve de cette filiation citons l'exemple, fût-il isolé et un poil tardif, que Ferdinand Brunot donne dans son Histoire de la langue française (1939) : « [Il] n'en fit ni à une, ni à deux » (Jacques-René Hébert, 1791). Mais comment expliquer l'antériorité de la graphie au masculin ?... D'autres, s'affranchissant du tour primitif, font observer que, si l'on dit un, deux, trois... en comptant, c'est bien plutôt une, deux que l'on entend quand il est question de marquer les premiers temps d'un mouvement, d'un commandement : « Les deux manières de compter : un, deux ! et une, deux ! pourraient être des survivances d'emplois anciens [on trouvait autrefois dire d'un et d'autre à côté de parler d'unes et d'autres]. La même dualité d’expression se retrouve dans ne faire ni un ni deux et ne faire ni une ni deux [...]. Le masculin peut s'expliquer sans ellipse par le simple emploi du nom de nombre. Littré explique [le féminin] par l'ellipse du mot fois, ce qui nous parait peu probable », écrit Kristoffer Nyrop en 1925. Sauf que le linguiste danois semble oublier un détail : le pronom en, présent dans les premières attestations et encore sous la plume de Balzac (1). Mon sentiment est que n'en faire ni un(e) ni deux est bien issu de n'en pas faire à deux fois, mais a été déformé − à partir de 1750 ? (2) − en ne faire ni un(e) ni deux : l'ancien tour faire de quelque chose n'étant plus compris, l'expression a été d'autant plus facilement réinterprétée en « ne pas prendre le temps de compter un(e), deux » (3) − comme cela se fait quand on hésite à se lancer dans une entreprise hasardeuse ou quand on prend son élan − que l'idée principale reste la même : se décider sur-le-champ, agir sans hésiter.
Toujours est-il que l'usage s'est établi d'écrire ne faire ni une ni deux : « Ma foi, je ne fis ni une ni deux : je laissai mes souliers à la porte, et j'entrai comme chez moi » (Alexandre Dumas, 1836), « Chassagnol ne fait ni une ni deux : il offre sa main » (frères Goncourt, 1867), « Mais le paysan ne fit ni une ni deux, et saisit un gros bâton » (Grand Larousse du XIXe siècle, 1869), « Tout à coup, elle ouvre les bras, ne fait ni une ni deux, court à moi et s'écrie [...] » (Jules Verne, 1889), « Il ne fit ni une ni deux » (Aristide Bruant, 1892), « Je n'ai fait ni une ni deux » (Huysmans, 1902), « Je n'ai fait ni une ni deux, j'ai sauté dans l'auto » (Henri de Régnier, 1914), « À voir toutes ces choses militaires, notre observateur n'eût fait ni une ni deux » (Henry de Montherlant, 1934), « Je savais que Zio Giuseppe ne ferait ni une ni deux qu'il me tuerait » (Louis Aragon, 1936), « Je n'ai fait ni une ni deux » (Henri Troyat, 1965), « Il ne fait ni une ni deux : il tire son couteau et coupe la corde » (Jean Dutourd, 1967), « Je n'ai fait ni une ni deux, j'ai pris la photo » (Romain Gary, 1974), « Il n'a fait ni une ni deux. Il a sauté » (Henri Queffélec, 1980), « Vous ne faites ni une ni deux » (Katherine Pancol, 1990), « Il ne fait ni une ni deux et passe au service de son ennemi » (Jean d'Ormesson, 1997) ou, plus succinctement, ni une ni deux : « Moi, d'abord je lâche, ni une ni deux » (comtesse de Ségur, 1865), « Ni une ni deux je me dis : ça y est ! » (Céline, 1957). Vous voilà prévenu. Et Dieu sait qu'un homme averti en vaut deux...
(1) Chez Balzac, l'hésitation porte sur un(e), pas sur en : « Oh ! oh ! je n'en ai fait ni un ni deux ! je me suis rafistolé, requinqué » (Le Père Goriot, 1835), « Ah ! il n'en a fait ni une ni deux ! Du premier coup, il a deviné nos pensées » (César Birotteau, 1837), « Crevel, comme il le disait dans son langage, n'en avait fait ni eune ni deusse, quand il s'était agi de décorer son appartement » (La Cousine Bette, 1846), « Je n'en ferais ni un ni deux, je vendrais sept ou huit méchants tableaux » (Le Cousin Pons, 1847).
(2) C'est, semble-t-il, à partir de cette date que les graphies avec en commencèrent à être concurrencées par celles sans en (lesquelles finirent par s'imposer) : « Je ne fis ni un ni deux » (Éléazar de Mauvillon, 1753), « Et les avocats [...] de ne faire ni un ni deux, de vite retourner chez eux une requête fabriquer » (Ange Goudar, 1780), « Un confesseur, sans faire ni une ni deux, insistera à propos » (Séraphin d'Ostende, 1789), « Ne fesant ni un ni deux, il va droit à l'appartement » (traduction d'un livre de Johann Gottfried Gruber, 1803), « Ils ne font ni une ni deux » (Jean Chatton, 1820). De là la mise en garde de Jean Humbert dans son Nouveau Glossaire genevois (1852) : « En, préposition, est retranché a tort dans l'expression suivante : Il ne fit ni un ni deux et lui appliqua un soufflet. Dites : Il n'en fit ni un ni deux. » L'Académie elle-même s'y est prise à plusieurs fois pour orthographier ladite locution dans son Dictionnaire ; comparez : « N'en faire ni un ni deux » (sixième édition, 1835), « N'en faire ni une ni deux » (septième édition, 1878) et « Ne faire ni une ni deux » (depuis la huitième édition, 1932). Quant à Littré, force est de constater, une fois n'est pas coutume, qu'il n'a fait qu'ajouter à la confusion en écrivant : « Ne faire ni un ni deux » (à l'article « faire » de son Dictionnaire) et « Familièrement. N'en faire ni un ni deux, n'en pas faire à deux fois, se décider sur-le-champ. Il ne fit ni un ni deux et croqua la poire [mais où est donc passé le pronom en dans cet exemple ?] » (à l'article « deux »).
(3) Témoin ces exemples : « Il n'a dit ni une ni deux... il s'est jeté après toi comme un perdu » (Xavier de Montépin, 1884), « Mais dès que je m'aperçois qu'il boude, je ne compte ni une ni deux, je saute à son cou » (Jules Renard, 1909).
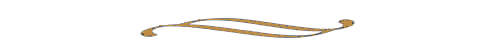
Remarque : Les spécialistes de la langue ont du mal à s'accorder sur la nature de un(e) dans notre locution : adjectif numéral ordinal, selon le Grand Larousse et le Dictionnaire historique de la langue française ; adjectif numéral cardinal, selon le Larousse en ligne ; adjectif numéral cardinal employé comme nom, selon l'Académie, le Robert et le TLFi. Comprenne qui pourra...
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Marc81 le 13 Septembre 2018 à 17:49
C'est en toute discrétion que l'Académie a modifié, à l'article « pouce » de la dernière édition de son Dictionnaire, une définition qui n'avait pas varié d'un... pouce depuis 1835 : de « Figuré et familier. Manger, déjeuner sur le pouce, À la hâte, sans prendre le temps de s'asseoir », on est passé à « Figuré et familier. Manger, déjeuner sur le pouce, à la hâte et légèrement ». Exit l'idée de se tenir debout, au profit de celle de faire un repas léger. Seulement voilà : Larousse ne mange pas de ce pain-là et s'en tient au traditionnel « à la hâte et sans s'asseoir », tandis que Robert donne à la variante manger un morceau sur le pouce le sens de « sans assiette et debout ». Quant au précieux site de l'ATILF, il n'y a aucun coup de pouce à attendre de sa part ; n'écrit-il pas d'une main : « Prendre un repas debout et sans couvert ; par extension, consommer à la hâte » (côté TLFi) et de l'autre : « Manger peu et vite » (côté Base historique du vocabulaire français) ? Avouez qu'il y a de quoi perdre son latin en plus de l'appétit... Mais au fait, me demanderez-vous les mains écartées en signe d'incompréhension, que vient faire le pouce dans cette affaire ? Selon Alain Rey et Sophie Chantreau, qui connaissent les locutions françaises sur le bout des doigts, l'expression fait sans doute référence « au rôle des pouces dans le maniement du couteau et du pain tranché, et très probablement à la nourriture rapidement poussée ». Vous, je ne sais pas, mais moi, je reste sur ma faim...
Renseignements (de première main) pris, l'expression employée à l'origine est, contre toute attente, morceau sous le pouce ; on la trouve, avec un degré de figement plus ou moins élevé, dans une lettre datée de 1777 et attribuée à Jean-Marie Roland de La Platière : « [Une omelette] dont chacun tiroit son morceau sous le pouce », puis dans Le Bonheur champêtre (1782) de Nicolas de Bonneville : « On vous prend sous son pouce un bon morceau de lard » et, surtout, sous la plume réputée légère du romancier Pigault-Lebrun : « Je mangeai un morceau sous le pouce » (1792), « Allons, à table, un morceau sous le pouce, une bouteille à la régalade » (1794), « Après le morceau sous le pouce, on s'était remis à patiner » (1799), « ll demanda qu'on lui apportât un morceau sous le pouce » (1804). Dans son Voyage de Bourgogne (1777), le poète Antoine Bertin nous donne une description pittoresque de cette pause-déjeuner : « Dépourvus de fourchettes, je m'imagine qu'on aurait pu très plaisamment nous peindre, pressant du pouce une cuisse ou une aile de poulet sur un morceau de pain, taillé en forme d'assiette. » Deux siècles plus tard, la même scène est évoquée de main de maître par l'écrivain Georges Bordonove dans Les Tentations (1960) : « Jean se mit à manger comme les paysans : le pain dans le creux de la paume, un morceau de grillon sous le pouce, le couteau dans la main droite. Il se coupait une bouchée. » (1) Vous l'aurez compris, le morceau sous le pouce − ellipse pour « morceau (de poulet, de jambon, de lard, d'omelette, de fromage...) (posé sur une tranche de pain faisant office d'assiette et tenu) sous le pouce » − désigne proprement (si j'ose dire) la nourriture (généralement froide) mangée à la façon des milieux populaires, c'est-à-dire saisie avec les doigts et coupée en tranches ou en bouchées avec un couteau, par opposition à celle servie dans une assiette individuelle et piquée à l'aide d'une fourchette : « C'est un morceau sous le pouce : nous n'avons pas de vaisselle » (Pigault-Lebrun, 1794), « Je me fais donner [...] un morceau sous le pouce » (Alphonse-Aimé Beaufort d'Auberval, 1803), « Un morceau sous le pouce ne vous ferait pas de tort » (Jean-Toussaint Merle, 1813), « − Si vous voulez prendre quelque chose, en attendant le dîner... − Très volontiers, un morceau sous le pouce, une tranche de jambon » (Armand Gouffé, 1817), « Je mangerai un morceau sous le pouce » (Prosper Mérimée, 1833), « Vivre à ton aise, avec un morceau de lard sous le pouce et un verre de vin devant toi » (Émile Souvestre, 1835). C'est au prix d'une seconde ellipse qu'apparut, au début du XIXe siècle, le tour manger sous le pouce pour « manger un morceau sous le pouce » : « Il met à l'abri ses couverts en faisant manger sous le pouce » (Antoine Antignac, 1807), « [Il] se livrait, en mangeant sous le pouce, à de joyeuses saillies » (Georges Touchard-Lafosse, 1838) (2).
Figurez-vous que ledit morceau, prenant son courage à deux mains, chercha de bonne heure à se hisser sur le pouce. Quelle drôle d'idée ! s'exclameront les beaux esprits avec des airs de sainte nitouche. Car enfin, comment manger avec la viande ou le fromage sur le pouce ? C'est aussi stupide que vouloir se mettre quelque chose sur la dent ! À la réflexion, je vois bien trois explications à pareille acrobatie. La première est d'ordre mécanique : d'aucuns arguent que, si le morceau se situe sous le pouce quand on le presse sur une tranche de pain, la lame du couteau, elle, vient buter sur le plus gros doigt de la main qui s'apprête à tailler l'ensemble en bouchées (3) ; autrement dit, on maintient sous le pouce d'une main ce que l'on coupe sur le pouce de l'autre − question de point de vue. La deuxième, avancée par Éman Martin dans Le Courrier de Vaugelas (1874), est d'ordre historique : attendu que le r ne se prononçait pas, dans l'ancienne langue, à la fin des mots en our, il n'était pas rare que sour et souz (ancêtres de nos actuels sur et sous) soient employés l'un pour l'autre ; nous pourrions donc nous trouver devant un cas analogue (quoique inversé) à celui des locutions sous condition, sous peine, autrefois concurrencées par les variantes sur condition, sur peine. La troisième est d'ordre analogique : l'influence de l'expression voisine manger sur le poing, attestée à la fin du XVIe siècle (et depuis tombée en désuétude) au sens de « être très familier », par allusion aux rapaces dressés à venir manger sur le poing du fauconnier, n'est peut-être pas à exclure. Toujours est-il que c'est la graphie sur le pouce qui finit par l'emporter sur sa concurrente, malgré les protestations d'une grosse poignée de spécialistes : « Ne dites pas : Manger un morceau sur le pouce, dites : sous le pouce » (Florimond Parent, 1831 ; Félix Biscarrat et Alexandre Boniface, 1835 ; Mesdemoiselles Clair, 1838 ; D. Gilles, 1858 ; George Verenet, 1860), « L'expression sur le pouce est inintelligible, car le pouce qui tient le morceau de viande sur le pain est dans une position telle que la viande, elle, se trouve dessous » (Benjamin Legoarant, 1858), « On dirait mieux peut-être : sous le pouce » (Dictionnaire analogique de Prudence Boissière, 1862), « Du pain et du fromage sur le pouce ou plutôt sous le pouce » (Alexandre Dumas, 1864), « M. Théodore Braun [a] copieusement traité la grave question de savoir s'il faut dire manger sur le pouce ou, comme il le propose et soutient envers et contre tous les lexicographes, manger sous le pouce » (Joseph Coudre, 1887), « Littré dit, sans le corriger, un morceau sur le pouce. Il faut dire : sous le pouce, l'objet est pris entre le pouce et le pain » (Édouard Le Héricher, 1888), « Sur le pouce est pour sous le pouce » (Dictionnaire des locutions proverbiales, 1899), « [Ils] se faisa[ie]nt servir le matin quelque morceau de viande qu'ils mangeaient sous le pouce (ainsi disait-on, et l'expression était juste) » (Germaine et Georges Blond, 1960), « En breton, on mange sous le pouce ce qui est plus logique que l'expression française "manger sur le pouce" » (Patrick Hervé, 1994).
Pourquoi l'Académie (et à sa suite Gattel, Landais, Bescherelle, Poitevin, Littré, Larousse et Robert [4]) a-t-elle fait la sourde oreille, balayant ces objections d'un revers de la main ? (5) Je donne ma langue et mes pouces au chat. Quant à ceux qui, à l'instar de Louis Lamy, soutiennent mordicus que « les travailleurs peu fortunés, obligés de se contenter d'un morceau de pain et d'un peu de fromage, tiennent leur couteau dans la main droite, le pain de la main gauche, et le fromage placé sur le pouce de cette dernière » (Le Pêle-Mêle, 1899), je les invite à se demander pourquoi les attestations de morceau sur son pouce (avec le possessif indiquant un emploi littéral) ou posé (placé, mis, découpé...) sur le pouce ne se comptent que sur les doigts d'une main (6). Peu importe la préposition, en vérité, dans la mesure où l'idée reste la même, à savoir manger avec les doigts, sans façon, sans cérémonie (comme le paysan dans son champ, l'ouvrier sur son chantier ou le soldat dans sa tranchée), en se contentant le plus souvent de ce qui tombe... sous la main : « N'faut pas faire de façon ; c'est sans cérémonie. À la cuisine, là, un morceau sur le pouce » (Louis Tolmer, 1798), « Vous êtes ben cérémonieuse, je vas prendre un morceau sur le pouce avec lui » (Joseph Aude, 1804), « Tu te passeras de serviette et d'assiette aussi. Un morceau sur le pouce, sans façon » (Maurice Ourry, 1811), « Je n'ai pas d'assiettes, [...] mes pensionnaires ont la complaisance de manger sur le pouce » (Alphonse Martainville et Théophile Dumersan, 1812), « Nous dînâmes sans nappe, c'est-à-dire, morceau sous le pouce » (Philippe Petit-Radel, 1815), « Mais, pas de façon : un morceau, là, sous le pouce » (Jacques-Francois Ancelot, 1830), « Il vit de pain et de cervelas ; et il mange sur le pouce » (François-Vincent Raspail, 1831), « L'acheteur les [= des brochettes de mouton] emporte sur une [galette de pain] et les mange sur le pouce » (Lamartine, 1835), « [Ces demoiselles] ne firent aucune façon pour les [= des morceaux de pâté] prendre et les manger sous le pouce avec les tranches de pain que le bourgeois taillait » (Alexis Eymery, 1838), « Le jeune prince [...] n'a pas été habitué à se servir de ses doigts comme d'une fourchette, et à manger sur le pouce » (Étienne Rousseau, 1862), « − Comment voulez-vous que je déjeune ? je n'ai ni serviette, ni fourchette, ni assiette. − Nous non plus ! On mange avec son couteau, sur le pouce » (Victorien Sardou, 1862), « La servante [...] n'avait point d'assiette, recevait sa part sur son pain et mangeait sous le pouce, avec la pointe du couteau qui lui servait de fourchette » (Henri-Edme Bouchard, 1867), « La société mangeait sur le pouce, sans nappe et sans couverts » (Zola, 1876), « On ne dressait pas la table ; on mangeait "sous le pouce" » (Laurent Tailhade, 1905), « Gambaroux mange sans assiette, sur le pouce, son morceau de pain dans la main gauche, avec la viande ou le fromage par-dessus, son couteau à grande lame pointue dans la main droite » (Jules Romains, 1934).
De ce sens primitif on est facilement et rapidement passé à celui de « repas pris en vitesse » : car à moins de partir pique-niquer, pourquoi irait-on manger avec les pouces, sans prendre la peine de dresser la table, si ce n'est parce qu'on n'a pas trop le temps de se les tourner ? (7) Cette extension de sens (selon le TLFi) ou cette acception figurée (selon l'Académie) s'est manifestée avant 1829, date à partir de laquelle apparaissent les premiers emplois de sur le pouce à propos d'une boisson, d'un potage ou de tout autre mets liquide : « Je suis déjà en retard, tout ce que je puis c'est de prendre un petit verre sur le pouce » (Mémoires de Vidocq, 1829), « − Voulez-vous [...] une chopine, sur le pouce ? − Sur le pouce ? volontiers, car je n'ai pas le temps » (Ibid.), « On vidait sur le pouce une feuillette [= tonneau de vin] » (Pétrus Borel, 1840), « Boire plus d'un canon sur le pouce » (Lamothe-Langon, 1840), « J'ai pris un potage sur le pouce, au Café de Paris » (La Presse, 1848), « Vous accepterez bien un verre d'eau de cidre sous le pouce ? » (Lucien Thomin, 1885), « Versez, père Maluron, et sur le pouce [...], j'veux pas prendre racine ici » (Jean Lorrain, 1904), « Nous soupons vite, sur le pouce, pas très intéressés par la mangeaille » (Jean Giono, 1951), « Un coup sur le pouce et on y va » (Jean-Noël Blanc, 1988). Il n'est que trop clair, dans ces exemples, qu'il ne s'agit plus de jouer des pouces plutôt que des couverts, mais de boire rapidement un coup. C'est cette idée secondaire de hâte − plutôt que celles, absconses, parfois avancées : « Manger sous le pouce, antiphrase qui veut dire sur les pieds » (Le Figaro, 1831), « Si le pouce désigne un doigt de la main, il désigne tout autant un doigt de pied. Et si sur le pouce voulait tout simplement dire "debout" ? » (Jean-Damien Lesay, 2013) − qui a pu induire celle d'être debout. Et pourtant... Qui ne verrait que la position du morceau de viande par rapport au pouce ne nous renseigne en rien sur celle de la personne qui s'apprête à l'avaler ? Manger avec les doigts, convenons-en, peut s'envisager debout ou assis (quoique rarement sur une chaise, il est vrai), avec ou sans table (8) ; aussi se félicitera-t-on du récent revirement de l'Académie sur ce point. Pour autant, était-elle fondée à mettre en avant l'idée de repas léger ? Je vous laisse en juger : « Un lord qui venait de manger un homard sur le pouce » (Joseph Méry, 1840), « J'ai déjeuné sous le pouce avec trois maquignons ; j'ai mangé pour ma part quatre livres d'aloyau, la moitié d'une poule d'Inde de Lisieux, un fromage de Livarot et six pommes de reinette de Caux » (Charles Jobey, 1866), « Une ample provision de viandes et volailles froides, de jambon, de fromage, d'oranges et de bon vin forment le déjeuner, exécuté, comme on dit vulgairement, sur le pouce » (Alfred Guillemin, 1867), « Il y a des estomacs délicats qui s'accommoderaient mal des copieux dîners au lard mangé sous le pouce » (Alphonse Desjardins, 1870), « Des litres, des quarts de pain, de larges triangles de Brie sur trois assiettes, s’étalaient à la file. La société mangeait sur le pouce » (Zola, 1876), à côté de « Il prendra seulement un morceau sous le pouce, on lui servira la première chose venue » (Charles Polycarpe, 1833), « Permets-moi de manger un petit morceau sous le pouce » (Ferdinand Laloue, 1843), « [Ils] mangeront un fruit, un morceau sur le pouce, peu de chose » (Champfleury, 1849), « [Il] dédaigne ce que l'on appelle le morceau sur le pouce ; il lui faut du solide » (Anne Raffenel, 1856), « Comme nos plats n'ont jamais été bien compliqués, toute place nous était bonne pour les manger sous le pouce » (Hector Malot, 1870), « Ce déjeuner spartiate [...] n'était guère qu'un morceau de pain pris sur le pouce » (Mathieu-Jules Gaufrès, 1873), « Prendrez-vous un petit morceau sur le pouce ? » (Flaubert, avant 1880), « Se contenter d'un morceau mangé sous le pouce » (Jules Beaujoint, 1888), « Il filait comme un chien à la cuisine, friand des restes du garde-manger ; déjeunait sur le pouce d'une carcasse, d'une tranche de confit froid, ou encore d'une grappe de raisin et d'une croûte frottée d'ail » (François Mauriac, 1927). Ce qui est sûr, c'est que l'interprétation littérale du tour avec sur favorise l'idée d'un repas modeste (et acrobatique) : « Le déjeuner fini, pris sur le pouce − et sur le pouce de ces demoiselles vous pensez ce qu'il peut tenir » (Alphonse Daudet, 1877), « Manger sur le pouce : manger en vitesse, sans prendre le temps de se mettre à table devant une assiette. Il s'agit en général d'un repas frugal car le morceau qu'on peut mettre sur le pouce n'est pas bien gros... » (Colette Guillemard, 1990). Sans rire...
Voilà donc une expression que l'on ne sait plus par quel bout prendre : la logique plaide en faveur de sous, l'usage, en faveur de sur. « Les trois quarts de nos [...] ouvriers ne déjeunent que sur le pouce ou sous le pouce, je ne sais pas au juste », confessait Raymond Brucker en 1860 ; même hésitation sous la main d'Ernest Billaudel (1875) : « Chacun apportera son couteau de voyage et l'on mangera sur ou sous le pouce. » De fait, les auteurs ne s'accordent ni sur sa forme (même si la graphie sur le pouce est de loin la plus fréquente aujourd'hui) ni sur sa signification. Aussi ne manquera-t-on pas de mettre la main sur quelques formulations malheureuses ou ambiguës, du genre : « À dix heures la collation, prise sur le pouce [sens étendu ou figuré], le morceau de viande posé sur une tranche de pain est maintenu sous le pouce [sens propre] » (Catherine Grisel et André Niel, 1998). Est-ce une raison pour mettre ledit tour à l'index ? Faudrait pas pousser !
(1) Nombreux sont les témoignages (relevés notamment chez les chroniqueurs des usages populaires) qui vont dans le même sens : « Il donne un bon morceau de pain à son compagnon, en coupe un pour lui-même [...], ajoute au sien un morceau de volaille froide et s'assied tenant son dîner sous son pouce » (Jean-Baptiste Gouriet, 1811), « Il mangeait un morceau de poulet, debout, et le tenant sous le pouce ; un gros morceau de pain lui servait d'assiette » (Journal des débats politiques et littéraires, 1841), « Le nôtre [d'ouvrier] avait tenu à faire ce repas en plein air, et, carrément assis, jambes pendantes, le couteau en main, il rognait petit à petit un énorme croûton couronné d'une forte tranche de lard maintenue sous le pouce » (Eugène Chavette, 1869), « Lamelle de pain que l'on interpose entre le pouce et le fricot [= nourriture bon marché], lorsqu'on mange sous le pouce » (Anatole-Joseph Verrier, à l'article « tapon » de son Glossaire étymologique et historique des patois et des parlers de l'Anjou, 1908), « Toutes viandes rôties que l'on mange sous le pouce, sur un morceau de pain de froment » (La Revue du Mortainais, 1933), « Le cousin Jules serrait à pleine main une tranche de pain bis sur laquelle son pouce maintenait un cube de jambon gras » (Joseph Malègue, 1933), « [C'est] une "collation sous le pouce", ainsi nommée parce que, dédaignant assiettes et fourchettes, chaque convive maintient sous le pouce, mais séparé de celui-ci par un petit carré de pain, le morceau de chai [= viande] placé sur la tranche de pain » (Revue de l'Avranchin et du pays de Granville, 1937), « Assis à l'ombre des haies, fâneurs ou laboureurs, faucheurs ou moissonneurs, devisaient en riant, un croûton à la main, la viande sous le pouce » (Gilbert Gensil, 1958), « La "deusse" est toujours accompagnée d'un morceau de lard salé cuit posé sur la tartine et tenu sous le pouce, mais le doigt est séparé du lard par une taille de pain » (Marie-Louise Heren, Folklore picard, 1966), « Vers 9 heures, on s'arrêtait pour faire une "collation sous le pouce" (cette expression vient du fait que chacun maintenait sous son pouce le morceau de viande posé sur une tranche de pain) » (Daniel Lacotte, Traditions et légendes en Normandie, 1980), « Elle se tait, le couteau au poing, une tranche de pain et un morceau de viande sous le pouce gauche » (Louis Costel, 1982), « Uniquement préoccupé à tailler, sur une épaisse tartine, un morceau de lard qu'il tenait sous le pouce » (Glenmor, 1995), « Chacun se coupa une nouvelle tranche de pain, posa dessus un gros morceau de fromage, bien calé sous le pouce » (Edmond Verlhac, 2000). D'autres mettent plutôt en avant l'action coordonnée du pouce et du couteau pour saisir les aliments : « Pas d'assiettes. Padellec coupe d'épaisses tranches de pain et, l'un après l'autre, chacun se lève pour prendre un poisson entre le pouce et le couteau » (Juliette Lartigue, 1929), « En claquant, les couteaux s'ouvrirent. Entre le pouce et la lame chacun se tailla sa part qu'il emporta sur une tranche de pain » (Yvonne Posson, conte breton, 1939), « Il ne pouvait empêcher que les rustauds ne prélèvent les mets [...], en les saisissant entre le pouce et la lame de leur couteau et qu'ils ne les écrasent ensuite sur l'épais chanteau coupé à la grosse miche du pain » (Guy Enoch, 1963). Citons encore cette variante trouvée chez Pierre-Robert Leclercq (1979) : « Il était à jamais de ceux qui tiennent leur pain sous le pouce et leur fromage sous le petit doigt, la paume tailladée comme un hachoir servant de table. »
(2) Les tours déjeuner, dîner, souper sous (ou sur) le pouce, quant à eux, sont attestés avec le premier terme employé comme verbe (à l'instar de manger) ou comme substantif (à l'instar de morceau) : « Elles déjeunèrent, comme on le dit, sous le pouce » (Nicolas-Pierre-Christophe Rogue, avant 1830), « Le déjeuner sur le pouce aura lieu sous une magnifique tente » (Balzac, 1844), « C'est joyeusement, notre déjeuner sous le pouce, que nous allâmes nous installer devant la porte » (Émile Gaboriau, 1871), « Leur dîner sous le pouce, ils vont s'appuyer à la balustrade » (Thérèse Bentzon, 1877), « Ils ont improvisé un petit souper sur le pouce » (Albéric Second, 1878), « Je soupai sur le pouce » (Georges Duhamel, 1925).
(3) Ainsi de Sylvie Claval et de Claude Duneton dans Le Bouquet des expressions imagées (1990) : « Manger sur le pouce, manger du pain accompagné de viande que l'on tranche, bouchée après bouchée, "sur le pouce". » L'argument paraît sérieux, il est surtout spécieux, car en toute rigueur la lame du couteau, quand elle viendrait buter sur le pouce, ne s'en situe pas moins sous le doigt (côté pulpe) : « Ce n'est que lorsque le morceau de viande se découpe à même le pain, sous le pouce, que l'on trouve le temps de parler » (Léon Allard, 1885), « [Des] saucisses découpées sous le pouce » (Pierre Desmesnil, 1985), « Ceci ne l'empêchait pas [...] de couper de cette même main, sous le pouce, le pain et le lard gras de son petit déjeuner » (Roger Le Taillanter, 1995), à côté de « Le lard accompagnait la soupe ; ils le taillaient sur le pouce » (Jules Vidal, 1885), « Nous savourons un bout de viande froide que l'on découpe sur le pouce avec une tranche de pain » (Les Missions catholiques, 1933).
(4) Il est à noter que le tour avec sous n'est pas inconnu du Grand Larousse du XIXe siècle (1869) : « [Il] mange son saucisson sous le pouce, tout en bûchant » (à l'article « concours »).
(5) En 1888, dans un article de la Revue de l'Avranchin et du pays de Granville, Édouard Le Héricher pointa du doigt la responsabilité de l'Académie dans la confusion de l'usage : « Il y a bien des cas où nos paysans en remontreraient à l'Académie et même à ce perspicace observateur de la réalité que fut Honoré de Balzac. [...] Balzac a beaucoup puisé dans la langue du peuple, mais il semble n'avoir pas osé dire, comme lui, "manger sous le pouce", ce qui est conforme à la nature : il aura cherché dans le Dictionnaire de l'Académie et lui, si osé pourtant, a accepté "manger sur le pouce". »
(6) Citons : « Même elle est rousse Et sur son pouce Mange une gousse D'ail ou d'oignons » (Eugène Scribe, avant 1820), « Un vieux en lunettes qui découpait une charcuterie rose placée sur son pouce et la mangeait, tout en lisant son journal » (Jules Claretie, 1882), « Le père Baptiste mange sur son pouce [...]. Je le vois qui mange sur le pouce, du pain et du lard, qu'il coupe, avec son couteau de poche, en petits cubes très réguliers » (Eugène Ionesco, 1960).
(7) Témoin ces exemples : « Un repas exquis doit être savouré à table, et non dépêché sur le pouce comme fait de sa provende un vilain » (Charles de Bernard, 1838), « Je n'ai [...] que le temps de rentrer manger un morceau sous le pouce, et de courir » (Xavier Veyrat, 1841), « Les dîners sur le pouce, telle est la nouvelle institution rêvée par les nourrisseurs du genre humain. [...] On dîne à la minute, à la vapeur. Pas de table, pas de couvert, pas de garçon, mais un buffet tout dressé où vous choisissez les tranches de votre goût » (Achille Eyraud, 1855), « Ce repas sera léger et les enfants s'habituent à le faire rapidement, sur le pouce comme on dit » (Louis Chandelux, 1856), « Il mangea un morceau sous le pouce ; ce repas dura juste cinq minutes » (Paul Féval, 1863), « Nous allons expédier un petit déjeuner sur le pouce » (Albert Robida, 1883), « [À l'usine,] les aliments sont pris sur le pouce : [...] le repas du milieu de la journée dure quelques minutes, aussitôt chacun se remet à l'œuvre » (André-Émile Sayous, 1901), « C'est le repas rapide pris sur le pouce, qui n'a pas besoin d'être laborieusement digéré » (Georges Daremberg, 1905), « Après un court repas froid, avalé sur le pouce » (Maxence Van der Meersch, 1936). Force est toutefois de constater, n'en déplaise aux spécialistes de la langue, que la rapidité de l'action n'est pas toujours de mise : « Il mangeait tranquillement un morceau sur le pouce en attendant qu'on reprît la danse » (Octave Feuillet, 1850), « On soupa sur le pouce, mais de bon appétit, et si longuement que le soleil était couché quand on but le dernier coup » (Paul de Musset, 1866), « [Il] se mit à manger sur le pouce sans se presser » (Zénaïde Fleuriot, 1874), « Il avait déjeuné sur le pouce, tout en flânant le long des terrasses, d'un bout de saucisson et d'un morceau de pain » (François Coppée, 1888), « Arno tira son couteau de sa poche, coupa posément un petit cube de pain, l'assortit d'une miette de jambon et commença à mastiquer, sur le pouce, sans se presser » (Jean Raspail, 1993) ou ne va pas forcément de soi : « Ils mangeaient [...] un petit morceau sous le pouce, et à la hâte, pour perdre le moins de temps possible » (François-Victor Vignon, 1822), « Nous avons mangé un morceau sous le pouce, mais vite et mal » (Louis Énault, 1869).
(8) Qu'on en juge : « Une ample et vaste omelette mangée debout, dont chacun tiroit son morceau sous le pouce » (Roland de La Platière ?, 1777), « [Il] s'assied tenant son dîner sous son pouce » (Jean-Baptiste Gouriet, 1811), « Ces messieurs [...] se tiendront debout et mangeront sur le pouce » (Paul de Kock, 1821), « Il déjeune debout à huit heures du matin, son morceau de pâté froid sous le pouce » (Henri de Latouche, 1836), « Chacun des convives rangés debout des deux côtés de la table recevait un petit morceau de salé sur son pain, et le mangeait ainsi sans assiette, et comme l'on dit sous le pouce » (François Richard-Lenoir, 1837), « Il était dans un coin, assis sur un escabeau, mangeant, sous le pouce, un morceau de lard et du pain bis » (Saintine, 1839), « [Ils] mangèrent un morceau sur le pouce tout debout dans la rue » (Alexandre Dumas, 1844), « Je sais ce que c'est que manger sur le pouce (nous n'avions pas de chaises) » (Albert Pruvost, 1853), « Le grand Empereur s'étant assis lui-même sur le gazon [...] mangea sous le pouce avec la simplicité du soldat une tranche de jambon » (Jacques Bidot, 1860), « [Ils] mangeaient du fromage sur le pouce, assis tout le long de la vieille halle » (Émile Erckmann et Alexandre Chatrian, 1864), « À l'heure du déjeuner, sur les bancs, ils mangent leur fromage sous le pouce » (Jules Claretie, 1867), « La plupart du temps on ne se met pas à table, on ne s'assied pas, et, comme on dit vulgairement, on mange sous le pouce » (Edme Jean Leclaire, 1868), « Les voilà assis devant la commode, mangeant sous le pouce » (Julie Gouraud, 1873), « [Les officiers] se résignent [...] à manger sur le pouce, l'espace ne permettant pas de dresser de table » (Casimir Pradal, 1875), « Manger sur le pouce, le coude sur la table » (Alexis Bouvier, 1877), « Prouesse mangeait sur le pouce, et ne se mettait à table que lorsqu'il allait dîner chez les autres » (Adolphe Racot, 1882), « À midi ses hommes avaient déjeuné à la hâte, sur le pouce, debout sur le trottoir ou assis sur les coussins de leur fiacre » (Xavier de Montépin, 1883), « Donnez-moi un morceau sur le pouce, je mangerai sur le coin de la table de cuisine » (Hugo, 1887), « On s'assied alors devant le feu qui déjà s'éteint et le pique-nique est attaqué avec un appétit robuste [...]. On mange sous le pouce » (Jules Lecoeur, 1887).
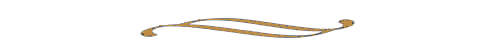
Remarque 1 : Employé comme locution adverbiale au sens de « à la hâte, rapidement », le tour sur le pouce s'est construit avec d'autres verbes que manger, déjeuner... : « On y mange comme on y vit... sur le pouce » (Albéric Second, 1844), « Entamons là, sur le pouce, un petit dialogue de circonstance » (Albéric Second, 1855), « Il dormait comme mangent les gens pressés, sur le pouce » (Alexandre Dumas, 1857), « Ce livre écrit au courant de la plume et "sur le pouce" si l'on veut bien nous passer cette expression » (Oscar Comettant, 1865), « La question n'est pas de celles qui se traitent sur le pouce » (George Japy, 1877), « Je me mis à parler sur le pouce, comme ça, de la campagne de 1816 » (Céline, 1932). Cet emploi est qualifié de « vieilli » par le TLFi.Remarque 2 : On notera avec intérêt que l'équivalent anglais de notre locution est under the thumb (« sous le pouce ») : « [Food] was eaten "under the thumb", so called because the men held it and cut off pieces with a "shut" knife » (Sarah Butler, 1975).

Livre de Marie-Laure André 1 commentaire
1 commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Richesse et difficultés de la langue française



